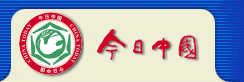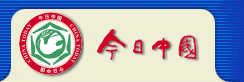|
Ethnies de Chine
Les Bonan
La nationalité bonan est l'une de celles
qui comptent le moins de personnes, soit quelque 11 700. Son langage
appartient à la branche mongole et est proche de celui des
Tu et des Dongxiang. Les nombreux contacts des Bonan avec les Han
et les Hui ont résulté en de nombreux emprunts au
chinois commun. Les Bonan utilisent les caractères chinois
dans leur écriture.
 Si
l'on en juge par les caractéristiques de leur langage et
de leurs coutumes dont beaucoup sont identiques à celles
des Mongols, la nationalité bonan semble avoir pris forme
après plusieurs années d'échanges, durant les
dynasties des Yuan et des Ming (1271-1644), entre les Mongols islamistes
qui s'étaient établis en garnison dans le district
de Tongren de la province du Qinghai, les Hui, les Han, les Tibétains
et les Tu. Les Bonan vivaient pour la plupart dans trois villages
importants de la région de Baoan situés le long des
rives de la rivière Longwu, district de Tongren. Durant les
premières années du règne de Tongzhi des Qing
(1862-1874), ils ont fui l'oppression des seigneurs féodaux
du monastère Longwu. Après être demeurés
quelques années à Xunhua, ils se sont déplacés
dans la province du Gansu et se sont établis finalement aux
pieds du mont Jishi, district de Linxia. Ils se sont de nouveau
regroupés en trois villages -Dadun, Ganmei et Gaoli- auxquels
les Bonan donnent le nom de " trois villages tripartites de
Baoan ", en souvenir de leurs racines. Les Bonan se concentrent
surtout à Dahejia, dans la partie ouest du district de Linxia,
à l'est du mont Jishi et au sud du fleuve Jaune. La région
est très boisée et bénéficie d'un climat
tempéré; l'eau et le gazon y sont abondants, ce qui
en fait un endroit propice pour l'élevage et la culture. Si
l'on en juge par les caractéristiques de leur langage et
de leurs coutumes dont beaucoup sont identiques à celles
des Mongols, la nationalité bonan semble avoir pris forme
après plusieurs années d'échanges, durant les
dynasties des Yuan et des Ming (1271-1644), entre les Mongols islamistes
qui s'étaient établis en garnison dans le district
de Tongren de la province du Qinghai, les Hui, les Han, les Tibétains
et les Tu. Les Bonan vivaient pour la plupart dans trois villages
importants de la région de Baoan situés le long des
rives de la rivière Longwu, district de Tongren. Durant les
premières années du règne de Tongzhi des Qing
(1862-1874), ils ont fui l'oppression des seigneurs féodaux
du monastère Longwu. Après être demeurés
quelques années à Xunhua, ils se sont déplacés
dans la province du Gansu et se sont établis finalement aux
pieds du mont Jishi, district de Linxia. Ils se sont de nouveau
regroupés en trois villages -Dadun, Ganmei et Gaoli- auxquels
les Bonan donnent le nom de " trois villages tripartites de
Baoan ", en souvenir de leurs racines. Les Bonan se concentrent
surtout à Dahejia, dans la partie ouest du district de Linxia,
à l'est du mont Jishi et au sud du fleuve Jaune. La région
est très boisée et bénéficie d'un climat
tempéré; l'eau et le gazon y sont abondants, ce qui
en fait un endroit propice pour l'élevage et la culture.
Les Bonan sont surtout musulmans mais se divisent en deux différentes
sectes : l'ancienne et la nouvelle. Au cours de l'histoire, les
chefs religieux ont exercé un contrôle répressif
sur les Bonan et ont parfois extorqué jusqu'à 30 %
du revenu des paysans. Dans ce contexte d'exploitation brutale,
la production agricole est longtemps restée arriérée.
Le rendement céréalier n'a jamais dépassé
750 kg l'hectare. Pour subvenir à leurs besoins, les paysans
devaient mendier, faire du charbon, vendre des herbes médicinales
ou conduire des radeaux sur le fleuve Jaune pendant la basse saison.
Une occupation qui a fait la réputation des Bonan est la
fabrication des couteaux. Ceux-ci sont réputés dans
toute la Chine pour leur robustesse et leur beauté.
En 1951, le district autonome Jishishan, Bonan, Dongxiang et Salar
fut établi dans la province du Gansu, ce qui a permis aux
Bonan de s'émanciper. En 1958, ils ont réussi à
abolir les privilèges féodaux du clergé islamique
et le système d'oppression. Depuis des générations,
les Bonan rêvaient de construire des canaux pour irriguer
leurs terres et ils ont concrétisé ce rêve sur
les versants de montagne et les terres de la région de Dahejia.
Ces dernières années, les Bonan ont pris des mesures
pour développer leurs habiletés traditionnelles :
fabrication de couteaux, réparation d'instruments aratoires,
et ils ont fondé bon nombre de petites entreprises de traitement
de produits agricoles. Il faut mentionner plus particulièrement
l'émancipation qu'ont connue les femmes bonan. Elles ont
acquis le droit de prendre part à la politique, aux activités
sociales, culturelles et récréatives sur un pied d'égalité
avec les hommes.
La culture des Bonan est profondément influencée
par l'islam qui dicte les formes du mariage, des funérailles
et des autres cérémonies, tout comme la vie familiale
et les coutumes. Ces dernières ressemblent à celles
des Dongxiang et des Salar, tout comme leur parure. Les Bonan ont
également conservé certaines coutumes typiques des
tribus nomades et identiques à celles des Mongols. Par exemple,
les Bonan adorent la lutte, l'équitation et le tir. Les Bonan
aiment chanter et danser. Ils excellent à jouer des instruments
à cordes et à vent et, comme les Dongxiang et les
Salar, leurs ballades sont appelées Hua'er. Les chants impromptus
durant les fêtes sont une forme typique de divertissements.
Les Yugour
 Près
de 90 % des quelque 12 300 Yugour vivent dans le district autonome
yugour de Sunan, et les autres dans la région de Huangnibao,
près de la ville de Jiuquan, dans l'ouest de la province
du Gansu. Pour des raisons historiques, cette nationalité
utilise trois langages : une branche turque (Raohul) employée
surtout dans la partie occidentale du district autonome; une branche
mongole (Engle) employée par ceux qui vivent dans la partie
est du district, et le chinois par ceux de Huangnibao. Le chinois
est la langue de communication entre les différents Yugour. Près
de 90 % des quelque 12 300 Yugour vivent dans le district autonome
yugour de Sunan, et les autres dans la région de Huangnibao,
près de la ville de Jiuquan, dans l'ouest de la province
du Gansu. Pour des raisons historiques, cette nationalité
utilise trois langages : une branche turque (Raohul) employée
surtout dans la partie occidentale du district autonome; une branche
mongole (Engle) employée par ceux qui vivent dans la partie
est du district, et le chinois par ceux de Huangnibao. Le chinois
est la langue de communication entre les différents Yugour.
Histoire
La nationalité yugour remonterait aux anciens nomades ouïgours
de la vallée de la rivière Erhun, durant la dynastie
des Tang (618-907). Au milieu du IXe siècle, les anciens
ouïgours fuyant les tempêtes de neige, l'oppression des
groupes dirigeants et les attaques des Kirghizes, se sont déplacés
vers l'ouest en groupes distincts. Un de ces groupes a émigré
vers Guazhou (l'actuelle région de Dunhuang), Ganzhou (l'actuelle
Zhangye) et Liangzhou (l'actuelle Wuwei) dans le corridor Hexi,
la région la plus fertile de la province du Gansu, et ils
se placèrent sous le régime de Tufan, un royaume tibétain.
Ils furent donc appelés les Ouïgours de Hexi. Plus tard,
ils capturèrent la ville de Ganzhou et y établirent
un khanat, d'où le nom de Ouïgours de Ganzhou.
Les Ouïgours du Hexi ont maintenu des liens très étroits
avec l'empire central. Durant la dynastie des Song du Nord (960-1126),
le khan des Ouïgours de Ganzhou a souvent demandé à
des envoyés de se rendre dans la capitale impériale
pour présenter un tribut à l'empereur, et, en retour,
la cour des Song a donné des produits spéciaux de
la Chine centrale. Les envoyés offraient surtout des chameaux,
des chevaux, des coraux et de l'ambre en tribut.
Au milieu du XIe siècle, le royaume des Xia de l'Ouest a
conquis Ganzhou et renversé le régime ouïgour.
Les Ouïgours de Hexi devinrent donc dépendants des Xia
et se déplacèrent dans les régions pastorales
à l'extérieur de la passe Jiayu. En 1227, les Mongols
conquirent le royaume des Xia de l'Ouest et soumirent les Ouïgours
du Hexi. Une partie des Ouïgours du Hexi furent assimilés
aux groupes ethniques avoisinants, et ils développèrent
une communauté qui formera les actuels Yugour. Ils vivent
autour de Dunhuang et dans la région de Hami au Xinjiang..
Les Yugour de la région de Huangnibao apprirent au fil des
siècles la culture et l'élevage, alors que ceux de
la région de Sunan s'adonnèrent à l'élevage
et à la chasse. La dynastie des Qing (1644-1911) divisa les
Yugour en sept tribus et nomma un chef héréditaire
pour chacune, lequel était appelé An et supervisé
par le surintendant Huangfan des sept tribus. Chaque année,
en vertu de la loi, les Yugour devaient offrir 113 chevaux en échange
du thé. Ils offraient également des fourrures, du
musc et des bois de cerfs.
L'organisation de ces tribus appartenait au système féodal.
Les chefs de tribus s'occupaient des affaires courantes et l'argent
et les propriétés des tribus devaient être partagés
avec le chef. Les surintendants des échelons inférieurs
étaient désignés par le chef après consultations
avec les dirigeants des monastères lamaïstes. Chaque
tribu tenait plusieurs réunions par année pour le
prélèvement des taxes. En apparence, ces réunions
semblaient démocratiques puisque chaque ménage y participait,
mais tout était en fait décidé par le chef..
Il existait aussi un poste influent de Qian Hu et des anciens que
l'on respectait. Le titre de Qian Hu était conféré
par le monastère Taer du Qinghai et ce titre jouissait d'une
grande influence dans le règlement des affaires de la tribu.
Les pâturages étaient la propriété de
la tribu en tant qu'unité, mais la majorité des pâturages
et des troupeaux étaient aux mains des chefs tribaux, des
lamas puissants et des grands éleveurs. La religion a été
un autre pilier de ce régime tribal.
Avant leur migration vers l'est, les Yugour croyaient dans le lamaïsme
et avaient aussi gardé leur ancienne religion : le Han Dian
Gel ( la vénération du Khan céleste). C'était
en fait un héritage de chamanisme primitif et la liturgie
s'effectuait dans une langue appelée Raohul, encore parlée
par certains Yugour. Le lamaïsme a été particulièrement
important durant les dynasties des Ming et des Qing. Chaque tribu
avait son propre monastère et les lamas travaillaient main
dans la main avec les chefs dans le règlement des questions
tribales. Ce régime fut particulièrement oppressif,
les dons au clergé, les corvées gratuites et l'enrôlement
forcé des enfants à la vie religieuse étaient
chose courante. Peu avant 1950, la population des Yugour atteignait
à peine 3 000 personnes. En 1954, le district autonome yugour
de Sunan et la commune autonome yugour Jiuquan Huangnibao ont été
établis et dans les années qui suivirent, une série
de réformes furent menées, dont la propriété
des pâturages. On mis en place diverses coopératives.
Les coutumes changèrent également : l'époque
des mercenaires des mariages arrangés et des enfants achetés
pour devenir des serviteurs de riches propriétaires se termina.
Aujourd'hui, les Yugour travaillent surtout dans la culture, les
industries liées à l'élevage et à la
machinerie agricole, les industries de tapis, de fourrure et de
transformation alimentaire.
Culture
Les Yugour ont une riche tradition littéraire qui s'est transmise
oralement : légendes, contes, proverbes et ballades. Les
chants folkloriques présentent des airs gracieux et vivants.
Les Yugour sont habiles dans les arts plastiques, le tissage sur
sac, tapis et attelage. Ils décorent également les
cols, les manches et les bottes de motifs de fleurs, d'insectes
ou d'oiseaux. On utilise des coquillages, des éclats de pierre,
des fils de soie pour décorer les cheveux. Les Yugour ont
une façon typique de se vêtir. Un homme bien habille
porte un chapeau de feutre, un longue tunique à collet haut
boutonnée à gauche, une ceinture rouge ou bleue et
des bottes hautes. Une fille en âge de se marier coiffe ses
cheveux de plusieurs petites queues de cheval qui sont ensuite nouées
en trois plus grosses : deux sont portées sur la poitrine
et une dans le dos après le mariage. Les femmes portent habituellement
un chapeau de feutre blanc en forme de trompette avec deux lisières
noires au devant.
|