Les
trésors du quotidien chinois
 |
| La
qipao. |
Le vent de l'Est souffle sur l’Occident. Ne devient-il pas
alors urgent de s'interroger sur les fondements d'un XXIe
siècle qui s'annonce singulièrement chinois? Pour tenter de répondre
à cette interrogation, l'exposition « Chine : trésors
du quotidien », propose une traversée de la société chinoise
au fil du XXe siècle.
En suivant le peuple d'une
Chine rurale, l’exposition s'attache à mettre en lumière la permanence
de l’histoire au quotidien.
L’historien et commissaire d’expositions sur la Chine François
Dautresme (1925-2002) est notre guide. Pendant quarante ans, cet
homme a parcouru le pays dans son immensité et sa diversité et
a patiemment réuni plusieurs milliers d'objets. Cette fructueuse
collecte est d’autant plus riche qu’elle semble unique en Occident
et constitue, aujourd’hui, les archives matérielles d'un XXe
siècle en voie de disparition. Cet esprit curieux à l'œil exercé
affectionnait autant les marchés que les humbles échoppes de village.
Des œuvres provenant du musée Guimet répondent à cet ensemble
hors du commun qui n'appartient guère aux cantons traditionnels
des collectionneurs. François Dautresme demeure avant tout un
pionnier, un découvreur. La présentation d’une si grande abondance
se fait à partir d'exemples concrets et suit les âges de la vie.
Ainsi, l'enfance, la jeunesse, la vie au travail et la vieillesse
permettent de fédérer nombre d'éléments significatifs des us et
coutumes.
Du
berceau au tombeau…
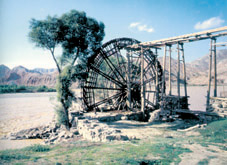 |
| Une
noria près de fleuve Jaune, une vue encore familière dans
certaines campagnes. |
L'enfance est abordée grâce
à une iconographie modelée ou imprimée. Un ensemble de statuettes
en céramique offre un panorama des Han aux Qing (206 av. J.C.-1911).
On prend ainsi conscience que l’enfant n'a jamais été conçu comme
un simple adulte en réduction, mais qu'il requiert une façon d'être
bien à lui, avec un code spécifique riche en emblèmes de toutes
sortes. Les estampes, le mobilier, les vêtements et les jouets
participent de cet univers magique qui, semble-t-il, a pour vertu
essentielle non seulement de créer un monde singulier, mais aussi
de conjurer les forces maléfiques qui pourraient attenter à l'équilibre
de l'enfant.
La jeunesse est évoquée en suivant les deux modalités chinoises
traditionnelles yin
et yang, féminin et masculin. Le portrait de la jeune Chinoise est retracé
depuis la fin de l’Empire jusqu’à l’établissement de la République
populaire. Sobre ou sophistiquée, l’image de la femme épouse le
siècle ou s'impose en fonction des aléas d'un statut en permanente
évolution. Au début du XXe siècle, le corps est gommé
sous le carcan hiératique de la robe mandchoue. À partir des années
vingt, avec la recrudescence de l'influence occidentale, la qipao
exalte la silhouette. Enfin, à la fin des années cinquante, le
retour à l'uniforme tente d'abolir non seulement le corps, mais
aussi le sexe, l'âge et le milieu social.
 |
| Vase
à pied de la dynastie des Ming (1368-1644) avec motif
d'enfants jouant au ballon. |
La seconde partie du XXe
siècle est consacrée à son compatriote masculin. La prise du pouvoir
en 1949 par les troupes communistes projette le héros révolutionnaire
au premier plan. La reconstruction du pays est à l'ordre du jour,
paysans, ouvriers et soldats constituent les fers de lance de
la nouvelle société. La caserne représente un modèle social, le
soldat, un idéal.
Le corps principal de l'exposition est dédié au monde du travail
à la campagne, sur la mer et les rivières, et au village. L’exposition
insiste sur les moyens de production : outillage, traités
techniques, machines plutôt que sur les produits manufacturés.
En avant-propos du travail de la terre, ont été réunis des mingqi,
ces modèles réduits en céramique disposés dans les tombes. Ils
témoignent de l'ingéniosité des paysans de l'époque Han (206 av.J.C.-221
apr.), tout en illustrant les liens qui existent encore aujourd'hui
avec certaines des techniques. Trois manuels classiques d'agronomie
voisinent avec des petits outils.
La présentation des métiers de la pêche procède de la même logique.
Boussoles et cartographie attestent de la précocité de la Chine
dans le domaine de la navigation. Nasses, filets, casiers, épuisettes,
hameçons de toutes sortes renseignent sur les méthodes en usage.
Un radeau pour la pêche aux cormorans, ainsi qu'une jonque entièrement
équipée, permettent de matérialiser une activité installée principalement
en Chine centrale et méridionale. Poissons ou coquillages ont
été l'objet d'une abondante iconographie et certaines de ces représentations,
la plupart en porcelaine, ponctuent cette évocation du monde des
eaux.
En ce qui concerne le travail au cœur du village, il s'agit essentiellement
de celui de petits artisans qui pourvoient au quotidien, assurant
localement une réelle autonomie par rapport aux grands centres
urbains. Le fabricant de sandales, le forgeron, le tisserand ou
le médecin appartiennent au paysage familier du village. La part
belle revient au potier où de nombreux éléments ont été rassemblés
à proximité du tour : ouvrages techniques, outils et créations
témoignages d’un savoir-faire unique et que les Chinois ont porté
au plus haut niveau.
Dans tout l’Extrême-Orient,
la vieillesse est synonyme à la fois de sagesse et de liberté.
Le vieillard est un homme serein qui bénéficie de loisir important.
Il vit la plupart du temps, protégé par les siens, dans la droite
ligne de l'éthique confucéenne et savoure les moments passés avec
les gens de sa génération. Bonnets, lunettes, pipes, flacons à
tabac, cages à oiseaux, cages à souris, arènes à grillons constituent
son quotidien. Ces objets de confort et de plaisirs voisinent
avec l’autel des ancêtres. Il est ici suggéré par une grande peinture
et achève cette traversée d'une Chine rurale du XXe
siècle.
Provence Alpes Côte d'Azur
– Monaco, Grimaldi Forum
Du 10 avril au 16 mai 2004











