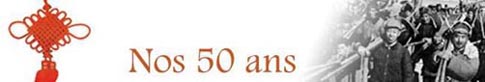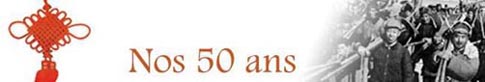|
Depuis les années
80: la réforme et l'ouverture, le sujet de toujours
La réforme et l'ouverture, commencées
en 1978, constituent la deuxième révolution
de la Chine. Elles sont étroitement liées à
la vie de chaque Chinois et ont eu une influence considérable
sur le développement du pays. Elles ont permis d'élever
grandement la puissance globale du pays, de sorte qu'il a
bondi au septième rang des puissances économiques
mondiales. Notre revue a toujours suivi de près, avec
grand enthousiasme, cette révolution qui a profondément
changé le destin de la Chine. À chaque étape
du développement, nous avons publié des articles
sur le sujet, et c'est par l'intermédiaire de notre
revue que de nombreux lecteurs étrangers ont pu connaître
la réforme et l'ouverture en Chine.
Fixer le quota de production
à l'échelon du foyer
Le système de responsabilité
intégrale de la production, commencé à
la fin des années 70, a marqué le prélude
de la réforme et de l'ouverture de la Chine. C'est
cette réforme à la campagne qui a permis à
l'économie chinoise de s'engager progressivement dans
la voie d'un développement sain et rapide. À
l'époque, notre revue a envoyé des journalistes
dans l'Anhui, province qui a été la première
à appliquer le système de responsabilité
intégrale de la production, afin de transmettre les
nouvelles de la réforme en Chine à l'intérieur
et à l'extérieur du pays.
"(...) 'Tu m'as demandé ce que
fait un chef d'équipe sous le nouveau système
de responsabilité intégrale de la production,
dit Chen Qixin. Tout d'abord il faut que je te raconte ce
que j'ai fait avant l'application du nouveau système.
Chaque jour, rien que pour distribuer les tâches aux
membres de l'équipe et les faire travailler aux champs,
cela me donnait déjà des maux de tête.
Le soir, il fallait penser au travail de chacun le lendemain,
sinon, ce serait un beau gâchis. Le matin, nous sonnions
la cloche pour appeler les paysans au travail. Parfois, personne
n'était sorti, même après le second appel.
-- Maintenant, tu n'as plus besoin de la cloche, n'est-ce
pas ? lui demandai-je.
-- Non, ce n'est plus nécessaire. Chaque famille s'occupe
de tout elle-même. Je ne me fais plus de mal pour tout
cela, et je peux me concentrer sur mon travail de direction.
'
Chen m'énumère les responsabilités qu'il
doit assumer. Au début de l'année, signer avec
chaque famille un contrat qui fixe la quantité de terre
à cultiver et ce qu'elle doit remettre à l'équipe.
Après la moisson, inviter les paysans à vendre
à l'État selon les normes fixées, grains,
coton, oléagineux, porcs, œufs et volailles. D'ordinaire,
il se charge de transmettre aux paysans les instructions du
gouvernement et de rendre compte au gouvernement des demandes
et des propositions des paysans ; d'assurer l'utilisation
rationnelle de l'eau et des buffles ; d'encourager les membres
à cultiver la terre par des méthodes scientifiques
; d'aider les familles en difficulté à entretenir
les champs. Il a le droit de mobiliser ses membres pour participer
aux travaux d'aménagement des champs, à la construction
hydraulique et aux occupations industrielles et auxiliaires
de l'équipe. Il s'occupe également de la mise
en vigueur du planning familial et de la solution des conflits
entre voisins et au sein des familles. (...)"
-- Extraits de " Reportage sur les campagnes de l'Anhui
(II) ", écrit par Deng Shulin et publié
dans le numéro de novembre 1981.
Changements sociaux
Zhou Enlai, ex-premier ministre, avait déterminé
le cadre conceptuel des reportages de notre revue : la construction
socialiste et, comme contenu, la vie. Depuis 50 ans, notre
revue est toujours restée fidèle à sa
mission et a formé la spécificité de
ses reportages : sur la société et l'économie
et les aborder sous l'angle de la vie courante. Dans la dernière
étape des années 80, notre revue a publié
une série de reportages intitulée " Les
Chinois, de la maternité aux funérailles
", qui ont raconté les expériences différentes
de vingt-quatre gens du commun, de la naissance, en passant
par l'enfance, la fréquentation scolaire, la jeunesse,
l'âge mûr jusqu'à la vieillesse. Des scènes
vivantes en sont sorties.
(...) Dans la société chinoise,
réunir en un tout cohérent les éléments
de deux familles brisées est une tâche délicate.
Les liens familiaux y sont extrêmement solides. Chaque
membre dépend de tous les autres, si bien que le remariage
d'un père ou d'une mère est souvent perçu,
par les enfants, comme une menace à l'unité
familiale.
Avant de convoler, ma seconde femme et moi-même mirent
donc les choses au point. Nos foyers respectifs demeureraient
exactement en l'état où ils se trouvaient. Nous
y vivrions alternativement, afin de permettre à nos
enfants de conserver leurs habitudes. Nous décidâmes
également d'épargner à nos enfants l'obligation
d'appeler " papa " ou " maman " leur nouveau
beau-père et leur nouvelle belle-mère, ce qui
est l'usage dominant, en pareil cas, dans la société
chinoise. Aujourd'hui encore, ils nous appellent " mon
oncle " et " ma tante ". (...)
-- Extraits de " La vie se construit à soixante
ans ", écrit par Shen Shuru et publié
dans le numéro d'août 1989.
Séries de reportages
sur la réforme
 |
| Vue nocturne de Shenzhen. |
À la fin des années 80 et
au début des années 90, notre revue a publié
des séries de reportages sur le Yangtsé, les
provinces, municipalités et régions autonomes,
reportages qui ont présenté à fond la
situation générale, les caractéristiques,
le développement économique, les ressources
touristiques et d'autres documents sur ces régions.
Ces articles ont donné de bons résultats, et
des hommes d'affaires étrangers ont découvert,
en se fiant à ces informations, des provinces, municipalités
et régions autonomes pour y investir et y fonder des
usines.
En 1998, à l'occasion du 20e anniversaire de la réforme
et de l'ouverture, notre revue a publié une série
de reportages faisant une rétrospective complète
de ce changement. Voici des extraits de " Mon histoire
", l'un de ces reportages publiés dans le numéro
de décembre 1998 :
"(Liu Guixian, une femme âgée
de plus de 60 ans, ne pensait pas, il y a 18 ans lorsqu'elle
a ouvert son propre restaurant, qu'après la réforme
et l'ouverture de Chine, elle deviendrait la patronne du premier
restaurant de propriété privée à
Beijing. Mais aujourd'hui, partout à Beijing, on voit
des restaurants de ce genre.)
(...) J'ai transformé ma maison en restaurant et les
membres de ma famille constituèrent les effectifs de
mon personnel. À cette époque, c'était
difficile de tenir un restaurant : d'abord, je n'avais pas
suffisamment d'argent et j'ai été obligée
d'emprunter quelque centaines de yuans à d'autres personnes.
C'était une grosse somme pour moi. Que faire pour honorer
cette dette si jamais mon restaurant s'avérait déficitaire
? En outre, il me manquait beaucoup de choses ; maintenant,
on peut acheter tout ce qu'on veut, mais à l'époque
de l'économie planifiée, on pratiquait le système
de rationnement. On ne pouvait pas se procurer tout ce qu'on
voulait avec l'argent. Si on voulait acheter de la viande,
des œufs, des légumes, du poisson, en somme tout
ce dont on avait besoin pour ouvrir un restaurant, on devait
se rendre loin de Beijing. Je me suis souvent levée
à 4 ou 5 heures du matin et j'ai perdu beaucoup de
temps en déplacement ; mais tout ce que j'avais réussi
à acheter suffisait bien souvent à peine à
préparer les dîners d'un seul jour au restaurant.
Toutefois, être le premier restaurant de propriété
privée avait aussi ses avantages. Cela attirait beaucoup
de journalistes chinois et étrangers. Leur curiosité
a fait affluer bon nombre de clients. Les ambassadeurs et
conseillers de 74 pays sont venus dîner dans mon restaurant.
En ce temps-là, ce n'était pas facile de venir
prendre un repas chez moi. Je me souviens, qu'une fois, la
réservation des places devait être faite 48 jours
d'avance.
Cela fait 18 ans que je tiens un restaurant. Aujourd'hui,
mon restaurant a pris de l'envergure (...) Âgée
de 65 ans, j'ai un espoir qui ne s'est pas encore réalisé
: celui d'acheter un véhicule de livraison. Nous pourrions
alors livrer les repas sur demande. Ceci permettrait aux clients
de bien manger sans dépenser beaucoup d'argent et de
temps."
Sur le Bainqen : ...les écrits
restent

Le Tibet est une unité administrative
d'échelon provincial de la Chine, et il n'y a rien
de différent entre lui et d'autres unités du
même échelon. Pourtant, vu son histoire et sa
localisation géographique particulières, il
reste, depuis des années, le point de mire du monde.
Dès sa fondation, notre revue a toujours fait, avec
grand intérêt, des reportages sur le Tibet. Elle
a publié des articles sur chaque événement
d'importance et chaque grande activité ; citons, entre
autres, la répression de la rébellion de la
clique de l'échelon supérieur du Tibet, les
40 ans de la réforme démocratique du Tibet,
les 50 ans de la libération pacifique du Tibet, ainsi
que les changements considérables survenus dans l'économie
et la vie culturelle du peuple tibétain. Parmi ces
reportages, ceux qui traitaient du grand maître Bainqen
ont eu de fortes répercussions à l'intérieur
et à l'extérieur du pays. Voici des extraits
du discours du Xe Bainqen Erdeni, lorsqu'il a reçu
des journalistes de notre revue :
"(...) Je voudrais dire à ceux
qui ont forgé des rumeurs à l'étranger
qu'ils ont inventé certains problèmes ; les
autres existaient auparavant. Pour le moment, ils sont déjà
résolus ou ils vont l'être. La politique actuelle
du gouvernement central sur le Tibet est bonne. Les masses
tibétaines en sont satisfaites. Tout le monde s'affaire
à la construction du pays. Je propose à ceux
qui nous critiquent, qu'ils soient Chinois ou étrangers,
de nous aider. Le Tibet est une région sous-développée.
De 1952 jusqu'à nos jours, le gouvernement central
a accordé au Tibet 12 milliards de yuans de subventions.
Le vice-président Ngapo Ngawang-Jigme et moi sommes
à l'origine de la Fondation d'assistance pour le développement
du Tibet en vue d'accélérer son développement
économique. Pourquoi nos critiques, qui prétendent
tant aimer le Tibet, n'y contribuent-ils pas ? J'ai parlé
avec des compatriotes tibétains résidant maintenant
à l'étranger. D'après eux, nombre de
Tibétains à l'étranger y ont obtenu des
diplômes universitaires. Je leur ai dit que, s'ils aiment
réellement leur pays natal, ils doivent y revenir et
participer à sa construction. Nous avons aujourd'hui
quatre universités au Tibet, avec chaque année,
des centaines de diplômés. Pourtant cela est
loin d'être suffisant. Tous ceux qui désirent
rentrer seront les bienvenus. Mais il est à noter que,
ici, il n'y a pas de hauts salaires. Ceux qui rentreront devront
vivre et travailler comme les intellectuels tibétains
et han, toucher le même salaire, manger du tsampa (aliment
tibétain fait de farine d'orge torréfiée
et du thé au beurre de yack) et loger dans des constructions
de fortune. Quand tout le monde travaille d'arrache-pied sur
le plateau tibétain pour renforcer et embellir notre
pays, seuls des propres à rien peuvent se laisser aller
à inciter à des manifestations et à composer
des articles calomnieux à l'étranger dans des
maisons confortables, le ventre bourré de viande et
de vin. Nous, Tibétains, disons que ces hommes-là
sont comme le seigneur incapable mais pointilleux. (...)"
-Extraits de " Le Bainqen Lama parle du Tibet
", écrit par nos journalistes et publié
dans le numéro de janvier 1988.
Témoin de la rétrocession
de Hongkong et de Macao
 |
| Le 24 septembre 1982 , M. Deng Xiaoping
rencontre la première ministre anglaise Margaret
Thatcher à Beijing et déclare officiellement
que la Chine a décidé de recouvrer sa souveraineté
sur Hongkong à compter du 1er juillet 1997. |
En 1840, avec l'opium, les colonialistes
britanniques ont suborné le corps du peuple chinois
et ils ont empoisonné son âme. Par la suite,
ils ont canonné les portes de la Chine et, petit à
petit, ont occupé toute la région de Hongkong.
Le peuple de la Chine et les gouvernements chinois successifs
n'ont jamais reconnu les traités illégaux imposés
au peuple chinois. Dès le premier jour de l'occupation,
sans relâche, les gens n'ont cessé de lutter
contre les colonialistes britanniques pour recouvrer Hongkong,
afin de laver cette honte nationale et de réaliser
la réunification du pays. Pourtant, dans l'ancienne
Chine, ce n'était qu'un rêve. Le 1er juillet
1997, Hongkong est enfin revenue dans le giron de la patrie.
L'humiliation nationale subie depuis une centaine d'années
a été finalement lavée. Notre revue suit
depuis longtemps de très près les changements
de Hongkong et a publié quantité d'articles.
Rien qu'en 1997, elle a publié nombre de reportages
faisant autorité et a ouvert une rubrique sur Hongkong
pour présenter des thèmes qui intéressaient
ses lecteurs, par exemple, l'origine des problèmes
de Hongkong.
La cérémonie de signature de la " Déclaration
conjointe sino-britannique " n'a duré que 15 minutes,
mais sa négociation a été longue et âpre.
Un journaliste de notre revue a eu l'honneur d'assister à
la cérémonie de signature et a couvert l'événement
sur place.
"Le 19 décembre 1984 est un
jour qui marquera l'histoire. À cinq heures de l'après-midi,
Deng Xiaoping, président de la Commission centrale
des conseillers du Parti communiste chinois, Li Xiannian,
président de la République populaire de Chine,
et d'autres dirigeants chinois sont entrés dans une
salle du Palais de l'Assemblée du peuple pour participer
à la cérémonie de signature de la déclaration
conjointe sino-britannique sur le problème de Hongkong.
Assis derrière une longue table recouverte de velours
vert foncé, en face des drapeaux nationaux des deux
pays, Zhao Ziyang, premier ministre chinois, et Madame Margaret
Thatcher, premier ministre de la Grande-Bretagne, signèrent,
au nom de leurs gouvernements respectifs, la déclaration
conjointe dans un silence solennel. On n'entendait que le
déclic des appareils photographiques qui fixaient ce
moment historique pour l'éternité. La signature
à peine achevée, 101 invités, venus spécialement
de Hongkong pour la cérémonie, applaudirent
chaleureusement. Les deux dirigeants ont échangé
les documents signés, se sont serrés la main
et ont porté un toast de félicitations.
En quinze minutes, une question historique épineuse
a été réglée. Cet accord a, d'une
part, assuré à la Chine l'exercice du pouvoir
total sur Hongkong en 1997 et, d'autre part, jeté une
base solide pour une longue prospérité et stabilité
de l'île. Ainsi a commencé une nouvelle page
dans les annales de l'amitié entre la Chine et la Grande-Bretagne.
(...)"
-Extraits de " Quinze minutes historiques ",
écrit par Wang Yongyao et publié dans le numéro
de mars 1985.
Suivre de près le processus
de démocratisation
Depuis la réforme et l'ouverture,
la Chine a réalisé un grand bond dans l'édification
de son pouvoir. Les rôles de l'APN et de la CCPPC ont
été davantage déployés, ce qui
a accéléré le processus de démocratisation.
Nos journalistes ont suivi toutes les sessions de l'APN et
de la CCPPC depuis les années 80. Voici des paragraphes
publiés dans le numéro de juillet 1988 :
 "Sans
la démocratisation, la modernisation paraît compromise.
La Chine, tout en se modernisant, a commencé sa démocratisation
(...) "Sans
la démocratisation, la modernisation paraît compromise.
La Chine, tout en se modernisant, a commencé sa démocratisation
(...)
Auparavant, lors des sessions de l'Assemblée populaire,
les projets et résolutions étaient " approuvés
à l'unanimité " ou "adoptés
à l'unanimité ". Cela n'a pas été
le cas de la VIIe APN. Du début à la fin, aucune
résolution n'a été approuvée à
l'unanimité et, parmi les nouveaux dirigeants, aucun
n'a obtenu tous les suffrages, même lors du vote du
Rapport sur les activités du gouvernement présenté
par Li Peng. Cela est sans précédent dans l'histoire
de la Chine nouvelle.
Le 28 mars, les députés ont élu les membres
de sept commissions spéciales. Le vote des membres
des quatre premières a eu lieu normalement, bien que
quelques-uns aient voté contre. Mais lors du vote des
membres de la commission de l'éducation, des sciences,
de la culture et de la santé publique, les déclarations
de Huang Shunxing, député de Taiwan, ont animé
l'atmosphère. Selon lui, le président de la
commission est trop vieux, il doit céder la place à
un expert compétent et plus jeune. Il avait à
peine fini qu'un autre député se lève
et prend la parole. Il réclame la candidature d'un
représentant des travailleurs médicaux. Résultats
: la liste des membres proposés a été
adoptée à la majorité, mais avec 8 votes
contre et 69 abstentions (...)
Ye Xuanping, 63 ans, fils du défunt maréchal
et président de l'APN Ye Jianying, a été
nommé sous-préfet de la province du Guangdong
en 1980. Il est maintenant chef de cette province et il déclare
: " Ceux qui ont un poste comme le mien ne doivent pas
craindre les critiques. Les critiques et les suggestions permettent
aux dirigeants de connaître la population. À
condition de dire la vérité et de travailler
avec honnêteté, un dirigeant obtiendra la compréhension
et la confiance du public. Après délibérations,
les opinions divergentes pourront se concilier.
Cette session est plus dynamique et plus démocratique
que les précédentes. Naturellement, certaines
pratiques sont encore imparfaitement au point. Pourtant un
pas décisif a été fait vers la démocratisation."(...)"
-- Extraits de " En route vers la démocratisation
", écrit par Deng Shulin et Xu Yaoping et
publié dans le numéro de juillet 1988.
Condamner sévèrement
la corruption
La corruption est un fléau opiniâtre
qui existe depuis l'Antiquité. Le Parti communiste
chinois n'a jamais fermé les yeux sur la corruption
et sévit toujours contre elle. Beaucoup de lois et
règlements efficaces ont été promulgués
à cet égard, et la lutte a donné des
résultats. Pourtant, la corruption perdure encore.
Notre revue a publié à plusieurs reprises des
articles en vue de contrer la corruption. Les analyses pénétrantes
et logiques du professeur Fei Xiaotong semblent encore plus
prophétiques aujourd'hui.
"(...) Certains estiment que les phénomènes
de corruption sont dus à l'effet corrosif de l'idéologie
bourgeoise des pays occidentaux. Depuis la proclamation de
la Chine nouvelle en 1949, surtout pendant les années
50 et 60, très peu de gens cherchaient uniquement à
satisfaire leurs besoins matériels. Et aujourd'hui,
nombreux sont ceux qui donnent la priorité aux considérations
pécuniaires. C'est ainsi que des analystes arrivent
à cette conclusion : l'apparition et la multiplication
de ces phénomènes indésirables sont liées
à la mise en vigueur de la politique d'ouverture de
la Chine vers l'extérieur et de réactivation
de l'économie nationale.
Le professeur Fei Xiaotong a dit que cette conclusion était
bien simpliste. Il estime que si l'on analyse le problème
sous un angle historique, on s'aperçoit que l'apparition
de ces phénomènes de corruption est due à
des causes internes héritées de l'ancienne société
féodale et à des conditions externes particulières.
Selon Fei Xiaotong, les phénomènes de corruption
et de concussion, et l'abus de l'autorité pour acquérir
des privilèges étaient monnaie courante autrefois.
Un dicton était répandu dans l'ancienne société
depuis plus de deux mille ans : " un préfet au
pouvoir pendant trois ans peut acquérir 100 000 taels
d'argent ", ce qui reflétait réellement
ce qui se passait dans l'ancienne Chine.
Sous la direction du Parti communiste chinois, la Chine a
remporté une victoire totale lors de la révolution.
Le nouveau pouvoir a apporté un nouveau style de travail.
Dans les années 50, l'esprit de dévouement complet
au service du peuple était en vogue. Cela ne signifie
pas que les influences néfastes ont été
totalement extirpées. En réalité, les
longues années pendant lesquelles la Chine est restée
fermée aux étrangers ont empêché
la Chine de connaître le monde extérieur, et
les dix ans de troubles de la " Révolution culturelle
" ont semé la confusion dans les esprits. Dans
ces circonstances, la mise en vigueur de la politique d'ouverture
sur l'étranger, le système de réforme
non encore parachevé et le manque d'éducation
idéologique entraînent la réapparition
de phénomènes de corruption de toutes sortes.
C'est inévitable et il n'y a rien d'étonnant
à cela.
Il ne faut pas négliger le fait que de nombreuses personnes
ont subi l'influence des idées traditionnelles chinoises.
Les parents se préoccupent presque tous de l'avenir
de leurs enfants. De nos jours, les délits économiques
commis par les enfants de hauts fonctionnaires sont plus ou
moins liés aux erreurs de leurs parents, ce qui soulève
l'indignation du public.
D'après Fei Xiaotong, il faut lutter contre tous les
phénomènes de corruption. Cependant, toutes
les ordures accumulées au cours des millénaires
ne pourront être éliminées du jour au
lendemain. L'apparition de ces phénomènes de
corruption a donné à certains étrangers
une mauvaise idée de la Chine. C'est imaginable. Face
à ces phénomènes de corruption, nous
ne devons pas relâcher notre vigilance et nous ne devons
pas trop nous en faire. La mise en vigueur de la réforme
économique et de la politique d'ouverture vers l'étranger
a permis à la Chine d'obtenir des résultats
remarquables. En outre, la Chine a pris des mesures d'organisation
et d'éducation idéologique dans tous les domaines
pour éliminer toutes les anomalies. Si l'on met fin
à la réforme économique et à la
politique d'ouverture sur l'extérieur du fait de l'apparition
de phénomènes de corruption, cela constituera
une régression historique. (...)"
-Extraits de " La lutte contre la corruption ",
écrit par Yi Xu et publié dans le numéro
de mai 1986.
Célébration du
cinquantenaire de la RPC
La fondation de la RPC a marqué le
commencement d'une nouvelle ère. Selon les dires de
Mao Zedong : " Les Chinois se tiennent debout depuis
lors ". En 1999, la RPC a fêté ses 50 ans.
Notre revue a ouvert, pour l'occasion, une rubrique intitulée
" 50 ans en 1999 " et a publié un numéro
spécial sur la Fête nationale. Elle a aussi envoyé
des journalistes pour couvrir sur place le grand défilé
et la soirée du 1er octobre. Ces mots, tirés
d'un article de M. Israël Epstein, rédacteur en
chef honoraire de notre revue, vous permettront de découvrir
les impressions d'une personne âgée sur l'ancienne
et la nouvelle Chine.
"(...) Le rythme et la portée
des avancées de la Chine, aux plans de l'économie,
de la technologie et de la vie de son peuple, ont été
vraiment remarquables. Dans l'ancienne Chine, lorsque j'étais
jeune, on ne produisait pratiquement rien en acier, on importait
même les becs de plume et les punaises d'Angleterre
et d'Allemagne. Les produits pétroliers, connus comme
" le pétrole étranger ", étaient
principalement achetés de l'étranger, tout comme
l'étaient les allumettes que l'on appelait " le
feu étranger ". Aujourd'hui, la Chine est le premier
producteur d'acier, de charbon, de céréales
et de textiles, et est l'un des dix premiers producteurs de
nombreux autres produits, dont les produits pétrochimiques.
Ces derniers vingt ans plus particulièrement, sous
les réformes incitées par Deng Xiaoping, la
vie du peuple s'est améliorée. L'électricité
et les électroménagers ont fait leur apparition
dans les foyers chinois. Il n'y a pas longtemps, les téléviseurs
étaient seulement des postes en noir et blanc, et c'était
surtout dans les endroits publics qu'on regardait la télévision.
Maintenant, en moyenne, il y a un téléviseur
par ménage, habituellement en couleurs, et l'écran
est de plus en plus large. Neuf foyers urbains sur dix possèdent
une machine à laver électrique; 76 % des ménages
possèdent un réfrigérateur; le téléphone
privé, considéré jadis comme un signe
de classe supérieure et de pouvoir, est présent
dans 64 % des foyers, et les climatiseurs, dans 20 % de ceux-ci.
Les ordinateurs personnels, que l'on trouve maintenant dans
4 % des foyers urbains, connaissent une croissance fulgurante.
La possession d'une voiture, bien qu'encore rare, est en croissance.
La plupart de ces articles sont achetés au comptant,
à partir des économies qui ont augmenté
de beaucoup. Enfin, le " Fabriqué en Chine "
est ce qui est le plus populaire parmi ces articles, et certaines
marques de biens durables ont pénétré
les marchés étrangers.
Ce ne sont que des exemples d'une myriade de réalisations.
Il y a cependant des problèmes et des difficultés
: la corruption, le déclin des idéaux et de
l'éthique, la mise au rancart des travailleurs par
la technologie, les ajustements du système social de
bien-être et les effets adverses des avancements technologiques
sur l'environnement. Les principaux médias étrangers
tablent quasi exclusivement sur ces points négatifs,
alors que les mesures prises par la Chine pour les régler
sont ignorées ou sous-estimées. (...)"
-- Traduction d'extraits de " The New China and I:
Looking Back and Forward ", écrit par Israël
Epstein et publié dans le numéro de décembre
1999 (édition anglaise).
Saluer l'entrée de
la Chine à l'OMC
L'entrée de la Chine à l'OMC signifie que la
réforme et l'ouverture en Chine sont entrées
dans une nouvelle étape et marque un nouveau tournant
du développement social du pays. Comme tous les Chinois,
nous suivons de près cet événement.
"(...) Mais à travers les quinze ans qu'ont duré
les négociations, les Chinois ont acquis des connaissances
approfondies sur l'impact de l'OMC et les obligations auxquelles
ils doivent s'engager. Depuis un certain temps, les experts
et les spécialistes chinois commencent à prêter
attention aux changements que connaîtront les conjonctures
politique, législative, du marché et de la main-d'œuvre,
une fois que le pays sera entré à l'OMC, et
parallèlement, ils proposent que la Chine se prépare
à fond dans ces domaines pour satisfaire aux exigences
de cette adhésion. On voit ainsi que les Chinois, en
particulier les fonctionnaires et les experts, sont bien conscients
des réalités concrètes. (...)"
-Extraits de " La Chine s'affaire aux préparatifs
d'entrée à l'OMC ", écrit par
Yi Da et publié dans le numéro de novembre 2001.
Note : Les auteurs des extraits non signés sont des
journalistes de notre revue.
|