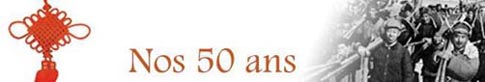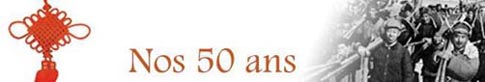Littérature de la Chine ancienne
En
Chine, la frontière entre l’histoire et la fiction semble inexistante.
Si l’épopée n’y a pas pris forme, peut-être est-ce qu’à la différence
des cours royales d’Occident où la geste des aïeux était transformée
par les trouvères, la Chine, dès l’aube de sa littérature, a laissé
les lettrés transformer le mythe en leçon d’histoire.
La mythologie ancienne était riche, mais il n’en reste
aujourd’hui que ce que les philosophes ont sauvé pour illustrer
leurs doctrines. Soumises à l’histoire et à la morale, les œuvres
d’imagination ont mis des siècles pour conquérir leur indépendance.
La
prépondérance de l’histoire
     |
| Les
classiques préférés des Chinois. |
Même
après que des érudits comme Sima Qian eurent entrepris de séparer
l’histoire de la mythologie, on vit croître, dans l’ombre des
premières histoires dynastiques, des chroniques qui y puisaient
leur substance, quitte à mêler le faux au vrai. Le roman se contentait
d’enjoliver l’histoire et restait sous sa dépendance. Même les
récits fantastiques qui fleurirent un peu plus tard sous les Six Dynasties (222-589), ne passaient
pas pour imaginaires à leur époque, selon Lu Xun ― le plus
grand écrivain de la Chine moderne qui fut aussi le premier historien
du roman. Car en cette période troublée, l’une des plus brillantes
dans l’histoire des religions chinoises, l’épanouissement du taoïsme
et du bouddhisme invitait à la méditation du monde surnaturel.
De bons auteurs collectionnaient les anecdotes, relevaient les prodiges des
alchimistes, les métamorphoses des génies, les miracles des divinités
bouddhiques, les apparitions des revenants. Ils furent les précurseurs
du conte fantastique, l’une des formes du récit romanesque les
plus vivaces en Chine.
Les
hauts et les bas de la prose
Un
autre genre d’avenir, l’étude de mœurs et la satire sociale, tire
sa source à cette même époque des conversations et des joutes
d’esprit où se réfugiaient les cercles intellectuels. Plusieurs
recueils d’anecdotes nous ont conservé les observations ou les
critiques qui faisaient le charme de ces cercles.
C’est
à l’époque des Tang (618-907) que s’épanouit vraiment la prose
romanesque. Les meilleurs lettrés cultivent alors l’art de la
nouvelle. Les contes fantastiques sont désormais matière d’agrément
et l’imagination des narrateurs se donne libre cours. On écrit
aussi des biographies romancées ou des histoires d’amour, dont
les héros romanesques revendiquent contre la société le droit
de se choisir librement. Malheureusement cet apogée sera suivi
d’un long déclin. Les lettrés des dynasties suivantes perdront
la liberté d’inspiration et la vigueur des Tang, et il faudra
attendre les Qing (1644-1911) pour que se produise « in extremis »
un dernier réveil de la
nouvelle et du conte en langue écrite.
L’une
des gloires de la dynastie des Song (960-1279) est d’avoir découvert
un remède à la carence des lettrés et permis l’apparition du roman.
Cette période, célèbre pour ses peintures, ses vases et ses poèmes
raffinés, est aussi celle des conteurs publics. Non pas que la
Chine ancienne n’ait pu avoir des conteurs de rues, mais nous
ne connaissons un peu que ceux des Song qui se multiplièrent dans
les villes prospères du sud et dont le répertoire se spécialisait
dans les contes fantastiques, les récits historiques, les légendes,
les histoires d’amour, les anecdotes pieuses, etc. Ces conteurs
utilisaient des aide-mémoire rédigés en langue vulgaire qui ont
fourni la trame des grands romans ultérieurs. À propos de leurs
origines, les fameux manuscrits découverts au début du XXe
siècle dans les grottes de Dunhuang (Gansu) nous ont appris qu’à
la fin des Tang les missionnaires bouddhistes, qui s’adressaient
à des illettrés, entreprirent de populariser leur message et adaptèrent
en langue vulgaire les textes bouddhiques sacrés. Dans leurs prédications
alternaient la prose et la poésie, le discours et le chant. Les
manuscrits donnent non seulement le texte de certains de ces sermons,
mais des imitations laïques qui en furent faites à des fins récréatives,
tant cette technique avait de succès. Que l’art des prédicateurs
bouddhistes ait suscité ou simplement stimulé celui des diseurs
profanes, le genre connut une grande vogue sous les Song, au point
que dès cette époque des aide-mémoire furent imprimés puis imités
par les lettrés qui s’en amusaient. Le roman en langue vulgaire
s’en inspira donc.
Les
grands classiques du roman
Nous
ne citerons ici que les plus célèbres de ces romans, ceux dont
il existe une ou plusieurs traductions en Occident. Ces ouvrages
ont été maintes fois remaniés selon le bon plaisir de leurs éditeurs
successifs, et il est parfois impossible d’en découvrir sinon
l’auteur du moins le principal compilateur, ni d’en déterminer
le texte original.
Plusieurs
grands romans ont une base historique, notamment le plus célèbre
d’entre eux sinon le meilleur, le Roman des Trois Royaumes
qui suit de près l’une des histoires dynastiques. Une foule de
conteurs et de dramaturges avaient enrichi peu à peu la « geste »
des Trois Royaumes. L’ouvrage est attribué à un auteur du XIVe
siècle, mais il a subi depuis lors de profonds remaniements. Grand
roman de guerre et d’aventure, il relate les luttes des héros
du temps, les preux et les félons, les stratèges et les têtes
brûlées. Chaque personnage incarne les vertus ou les vices d’un
type simple. Dans un roman de la même époque, intitulé Au bord
de l’eau, sont venues se fondre de multiples traditions et
légendes. Les historiens ont gardé le souvenir d’une bande de
brigands du XIIe siècle : l’imagination populaire
et le roman ont fait d’eux des hors-la-loi de génie, des chevaliers
errants, des redresseurs de torts. Dès la fin des Tang, les amateurs
de récits fabuleux, d’épreuves surnaturelles et de magie avaient
fait entrer dans la légende le pèlerin Xuan Zang, qui était allé
chercher en Inde, au VIIe siècle, les écritures sacrées.
Le Pèlerinage vers l’Ouest est un roman du XVIe siècle, un éblouissant enchaînement d’épisodes merveilleux,
de métamorphoses et de combats contre les démons que le pèlerin
traverse sans dommage grâce à l’aide de ses compagnons, dont un
singe fameux. Avec les deux titres précédents, le Jin ping
mei, qui date peut-être du XVIe siècle, forme une
triade célèbre. Le héros de cette histoire, qui apparaît également
dans le roman Au bord de l’eau, sombre dans une vie de
plaisirs, de débauches et d’illégalités et porte malheur aux femmes
qu’il approche, avant de succomber lui-même à une trop forte dose
d’aphrodisiaque. Étude sombre et géniale de la vie privée et de
la corruption de la haute classe, cet ouvrage mérite sa réputation
pour de meilleures raisons que ses descriptions pornographiques,
de mode à l’époque des Ming. Non moins remarquable, non moins
original est le Rêve du Pavillon rouge écrit au XVIIIe
siècle par deux auteurs dont le second prétendit achever
l’œuvre du premier. Le jeune héros, fils d’une grande famille
dont la fortune décline, grandit au milieu d’un essaim de jeunes
filles. Dans la grande et luxueuse maison, l’auteur analyse avec
une subtilité encore inconnue en Chine les joies et les tourments,
les impulsions et les manœuvres de ces adolescents. L’œuvre a
plu mais a tellement surpris qu’on lui a cherché des clés ou du moins une portée satirique pouvant rendre
compte d’un effort si nouveau. Dans une veine différente, le plus
grand roman de satire sociale semble être la Forêt des lettrés
du XVIIIe siècle, âpre dénonciation de l’hypocrisie
et de la malhonnêteté des fonctionnaires-lettrés.
En
dépit de son apparition tardive, le roman s’est développé en Chine
dans plusieurs directions, avec autant de variété qu’en Occident.
Le récit toutefois l’emporte en général sur l’analyse. L’étude
en profondeur des caractères intéresse moins que la poésie des
descriptions, la satire des mœurs, l’agencement de l’intrigue
et les prouesses de l’invention dramatique. Il ne faut pas oublier
les origines populaires du roman et que, jusqu’à la fin de l’empire,
il fut considéré officiellement comme un genre mineur, exclu de
la littérature.