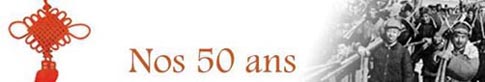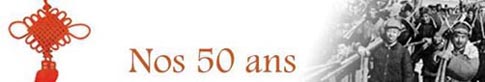Beijing
et ses «Waidiren»
HUANG
CAI
Beijing est
depuis toujours une ville ouverte, un lieu magique où les ambitieux
peuvent réaliser leur rêve.
 |
| Le
seul rêve des jeunes ambitieux : la réussite sociale. |
Au temps des dynasties des Ming et des
Qing, Beijing étant la capitale, les intellectuels s’y rendaient
pour participer aux concours impériaux, le moyen principal
pour recruter les fonctionnaires qui tentaient d’obtenir leur
premier poste officiel.
Depuis la fondation de la Chine nouvelle, Beijing
est devenue la capitale politique, économique et culturelle du
pays, et elle regroupe des élites venues d’un peu partout.
Cependant, c’est avec la réforme économique
et l’ouverture, qui ont relativement libéralisé la circulation
de la main-d’œuvre en Chine, que s’est produit le plus grand afflux
« d’immigrants ». Parmi les plus de dix millions de
personnes qui vivent actuellement à Beijing, plus de trois millions
sont des « Waidiren », c’est-à-dire des gens
venus de l’extérieur de la ville et qui n’ont pas le permis de
résidence de Beijing.
Dans les rues de la capitale, on entend donc
tous les dialectes de la Chine ou un Putonghua (la langue
standard de la Chine, basée sur le dialecte de Beijing) avec des
accents provinciaux. Pour les Pékinois d’origine, le phénomène
est loin d’être négligeable, parce que ces voix ne s’entendent
pas seulement dans les rues et dans les sites touristiques, mais
aussi dans leur lieu de travail et dans leur quartier d’habitation.
Ces Waidiren sont leurs collègues, leurs voisins, leurs
clients, et très possiblement leurs amis, leurs concurrents, et
pourquoi pas leur gendre ou leur belle-fille.
Heureusement, les Pékinois ne sont pas comme
leurs cousins de Shanghai, réputés
pour leur attitude hautaine envers les provinciaux. En
général, les Pékinois sont beaucoup plus tolérants. Peut-être
se souviennent-ils des premiers temps de l’installation à Beijing
de leurs ancêtres...
Il faut cependant dire que ces Waidiren
ne sont pas tous issus de la même couche sociale, et l’attitude
des Pékinois varie selon le cas.
Les
Mingong, indispensables mais
peu aimés
 |
| Waidiren est le plus souvent associé aux travailleurs manuels. |
La majorité
des Waidiren sont les Mingong (travailleurs paysans)
qui s’adonnent au travail manuel. Nés dans les campagnes ou les
zones montagneuses, ayant reçu une éducation primaire ou tout
au plus secondaire, ces jeunes viennent en ville pour se faire
une idée de ce monde bien différent du leur. Ils travaillent dans
la construction, dans les usines, dans les petits commerces de
légumes ou de fruits. À Beijing, 90 % des livraisons quotidiennes
de lait à domicile sont faites par ces paysans devenus citadins,
et plus de la moitié des gratte-ciel sont construits par eux.
Beaucoup de vendeurs ou vendeuses que les Pékinois côtoient tous
les jours dans leur supermarché préféré ont un accent provincial.
On doit dire que ces Mingong apportent une grande contribution
au développement de Beijing, mais quelquefois, ils sont négligés
ou même méprisés par certains, parce qu’ils font les petits boulots
que les Pékinois dédaignent, les travaux dangereux, salissants
et fatigants. Mais ces mêmes Pékinois changent vite d’idée après
une fête du Printemps pendant laquelle ils ont enduré des difficultés
dans leur vie courante, tout simplement parce que les Waidiren
étaient rentrés chez eux, à la campagne. Quand d’autres Pékinois
perdent leur poste lors de la restructuration de leur entreprise,
ils respectent parfois davantage ces Mingong qui gagnent
leur vie et font le bonheur de leur famille en travaillant avec
assiduité aux petits boulots.
Certains
autres Pékinois imputent le problème de l’insécurité sociale aux
Mingong. Par exemple, quand leur vélo ou leur porte-monnaie
est volé, certains Pékinois disent souvent : « il y
a trop de Waidiren chez nous », tout en oubliant que,
vous aussi peut-être, êtes venu de la province, bien que vous
ne fassiez pas de travaux manuels, parce qu’à Beijing, Waidiren
est le plus souvent associé à Mingong. Toutefois, selon
une enquête effectuée par le Journal de la jeunesse de Chine,
le taux de criminalité chez les Mingong ne serait pas plus
élevé que dans les autres couches de la population urbaine, et
l’attitude des Pékinois à leur égard tient du préjugé. Cela montre
bien l’attitude différente adoptée par les Pékinois envers les
provinciaux, selon qu’ils sont des intellectuels ou des travailleurs
manuels.
Des
jeunes ambitieux
Le deuxième
type de Waidiren à Beijing est formé des jeunes diplômés
qui ont suivi leur études supérieures à Beijing ou ailleurs, l’endroit
ne différenciant point leur ambition. Plus fortunés que leurs
compatriotes Mingong, ces jeunes ambitieux peuvent assez
facilement se trouver un emploi rémunérateur à Zhongguancun (la
Silicon Valley de la Chine) ou dans les gratte-ciel du fameux
CBD (Central Business District) où nichent les grandes multinationales. Ce sont des cols blancs respectés, voire même
enviés par les Pékinois. Ils jouent un rôle important dans la
vie économique de Beijing, surtout dans de nouveaux secteurs tels
que l’informatique, la biotechnique, l’immobilier. Les jeunes
gens qui ont réussi, qui ont acheté des appartements spacieux,
voire même des grandes maisons à prix exorbitant en ville, ou
qui ont réussi à créer leur propre entreprise ne manquent pas ;
toutefois, la plupart sont en train de préparer leur avenir dans
de petits logements loués, lisent du vocabulaire anglais dans
le métro, et cherchent partout à Beijing des restaurants au goût
de leur région. Quand ces provinciaux tentent de minimiser les
différences qui les séparent des Pékinois, ces derniers les considèrent
déjà comme faisant partie des leurs.
Les
artistes itinérants : à la poursuite de leur rêve de star
 |
| Des
stars de demain ? |
Le troisième
groupe de Waidiren est formé d’artistes itinérants, les
Waidiren du secteur culturel. Comme les membres des deux
autres groupes, ils n’ont pas la citoyenneté de Beijing, mais
c’est surtout eux qu’on nomme itinérants, un terme qui décrit
la grande différence qui les sépare des cols blancs. N’ayant guère
de travail ou de logement stable, ces artistes vont d’une rue
à l’autre, d’un bar à l’autre, s’arrêtent dans le métro et les
passages souterrains, pour chanter ou danser, n’accordant pratiquement
aucune importance aux quelques sous qu’ils peuvent gagner, car
ils cherchent surtout à faire connaître leur talent. La première
chose qu’ils veulent de Beijing, ce n’est pas l’argent, mais la
célébrité. À Beijing, centre culturel national et siège de CCTV,
avec sa dizaine de chaînes qui couvrent toute la Chine, son milliard
de téléspectateurs et les plus célèbres studios de film de la
Chine, ces jeunes gens ont plus de chance d’être repérés par un
imprésario que dans n’importe quelle autre ville du pays. De 1990
à 2001, le nombre de ces jeunes est rapidement passé de 20 000
à 300 000 et continue d’augmenter. La grande vedette Zhou Xun,
dont la photo paraît dans presque toutes les revues chinoises
sur la culture, chantait encore il y quelques années dans un bar
de Sanlitun, une rue de Beijing très connue où se trouvent beaucoup
de bars et de restos. Peut-être parce qu’ils sont relativement
moins nombreux que les deux autres groupes de Waidiren,
et qu’ils ne concurrencent pas les demandeurs d’emploi pékinois,
ces derniers regardent ces jeunes comme des vedettes, tout en
se réjouissant de la couleur que ces jeunes ajoutent au tableau
de la ville. Ils sont fiers de vivre dans cette métropole culturelle.
En conclusion, c'est grâce aux efforts de tous, Pékinois
de souche comme Waidiren, que Beijing a pu réaliser un
développement remarquable ces dernières années.
.