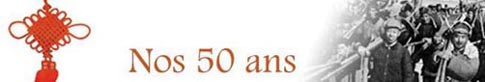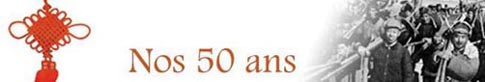Les
thés de l’Anhui, des connus et des moins connus
LIU KAI
 |
| Fresque
des Liao qui présente le traitement du thé. |
LA province de l’Anhui se trouve
dans l’est de la Chine et s’étend de 29°41´à 34°38´de latitude
Nord et de 114°54´à 119°37´de longitude Est. Elle est divisée
en trois parties par les fleuves Yangtsé (traverse le sud de la
province) et Huaihe (s’étend au nord de la province) : le
Huaibei, le Jianghuai et le Jiangnan. Le Huaibei offre l’aspect
d’une vaste plaine à perte de vue, le Jianghuai se compose de
nombreuses collines basses, tandis que le Jiangnan se caractérise
par des montagnes noyées de brumes et de nuages. Les deux dernières
régions sont connues non seulement pour leurs merveilleux paysages,
dont les monts Huangshan, site classé par l’UNESCO comme patrimoine
culturel et naturel mondial, et le mont Jiuhua, un des quatre
monts célèbres de l’histoire bouddhique, mais aussi comme des
régions importantes de production des thés de l’Anhui. En effet,
la topographie, le climat et la nature des sols dans le sud montagneux
de l’Anhui concourent à former un terroir qui convient parfaitement
à la croissance des théiers qui préfèrent les zones au climat
chaud et humide avec alternance de soleil et de pluies régulières
au cours d’une année.
Historiquement, le théier était
cultivé dans les provinces suivantes : Anhui, Fujian, Guangdong,
Guizhou, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi Shanxi, Sichuan,
Yunnan et Zhejiang. Ces zones étaient subdivisées en quatre :
zone sud, zone sud-ouest, le sud de la région du Yangtsé et le
nord de cette région.
De nos jours, les plantations de
thé se répandent largement dans l’Anhui. Les zones productrices
de thés couvrent principalement les régions suivantes : celles
des monts Huangshan et Dabieshan et les basses collines du sud
du Yangtsé qui jouissent d’un climat subtropical typique.
D’hier
à aujourd’hui
L’histoire du thé de cette province remonte à très loin
dans le temps. C’est au règne de Han Xiandi (192-219) que le thé
fut introduit du sud-ouest de la Chine, via le Shanxi et le Henan,
à l’ouest de l’Anhui. À
l’époque des deux Jin (265 – 420), la culture et la fabrication
des thés étaient tellement florissantes qu’apparurent les tributs
en thé. Sous les Tang (618 – 907), on y produisai des thés tels
que le thé Huangya (manufacturé avec des bourgeons jaunes), le
thé Tianzhu, qui doit son nom aux monts Tianzhushan, le thé Yashan,
le thé Niueling et le thé Fangcha, etc. Depuis la dynastie des
Song du Sud (1127-1279 ), la fabrication des thés célèbres a pris
son essor dans la zone montagneuse du sud de l’Anhui et elle a
connu son apogée sous les Ming et les Qing (1368-1911)
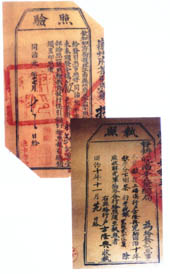 |
| Licence
commerciale de thé délivrée au règne de l’empereur Tongzhi
des Qing à la Maison Fang Longxing dans le sud de l’Anhui
et Bon de commerce et d’écoulement du thé délivré aux commerçants
de thé de l’Anhui par la dynastie des Qing. |
La technologie de traitement du thé Songluo de Xiuning,
créé au début des Ming, a été renommée à l’échelle des zones productrices
de thé, peu après le milieu des Ming, et ce thé est devenu le
thé renommé d’alors. Le thé noir Qimen, créé en 1875, s’est démarqué
parmi les grands crus chinois, et il s’est imposé comme l’un des
trois grands thés noirs au parfum le plus persistant du monde.
Grâce à sa qualité, différente des autres thés de la même catégorie,
le thé Huoshanya, manufacturé à partir des bourgeons ayant une
seule feuille et cueillis avant la chute des « gouttes de
pluies » , est devenu le thé réservé exclusivement à l’usage
des familles impériales des Ming et Qing. À la fin de la dynastie
des Qing, les thés en provenance de Huizhou et Luan ont bénéficié
d’une grande réputation, tant en Chine qu’à l’étranger, et ils
furent appelés communément « les grands thés Huilu ».
C’est à l’époque couvrant la fin des Ming et le début
des Qing que la commercialisation et l’exportation des thés vers
l’Europe commencèrent. Les thés exportés en grande quantité étaient
les thés de Wuyi et de Songluo. Au milieu des Ming, alors que
la demande de thé augmentait en Europe de l’Ouest, des commerçants
de thé, venus de l’Anhui, ont été les premiers à faire le commerce
du thé avec les étrangers, et c’est eux qui ont exploité le « Tunlü »
et le thé noir « Qimen », qui ont écrit l’époque glorieuse
du thé de l’Anhui. Il est clair que l’Anhui a joué un rôle principal
dans les thés de Chine depuis les dynasties des Ming et des Qing.
Cela s’explique tant par la meilleure qualité du thé de cette
province que par l’influence favorable qu’a exercée l’administration
des pouvoirs et du marché d’alors. En d’autres mots, le développement
des thés offerts en tribut a été promu et stimulé par les gouvernements
anciens, tandis que leur commercialisation a été accélérée par
la demande accrue et les bénéfices tirés des opérations commerciales
des commerçants de thé de l’Anhui. À la fin du XIXe
siècle, les thés provenant de l’Anhui vendus à l’intérieur du
pays ne représentaient que 10-20 %, mais le volume de leur exportation
occupait 80-90 %.
Les thés spéciaux
Trois thés sur les dix grands thés renommés en Chine
proviennent de l’Anhui : Huangshan Maofeng, Luan Guapian et le
thé noir Qimen.
Le Huangshan Maofeng est originaire des monts
Huangshan, site touristique très connu pour ses forêts verdoyantes,
ses eaux limpides, son climat tempéré et son sol fertile.
Dans ces lieux, les théiers vivent dans un vrai paradis :
nuages, brumes, air frais, pluies abondantes et léger ensoleillement
qui donnent des feuilles épaisses, résistantes au vieillissement
et qui développent un parfum exceptionnel.
Au début, le Huangshan Maofeng était originaire des
sommets du Sourcil (en chinois, Meimao). Dans les Notes sur
le thé de Xu Cishu des Ming, on peut lire : « Huangshan
Maofeng rivalise avec le thé Longqing ». En 1959, il est
devenu un des dix grands thés de Chine.
Le Luan Guapian a plus de 300 ans d’histoire. Il fut,
durant les dynasties des Ming et des Qing, un thé de tribut. Sur
la liste des aliments destinés à l’impératrice douairière Cixi,
il est écrit expressément qu’il fallait lui fournir 700 g de Luan
Guapian à chaque mois. En chinois, le nom de ce thé signifie « graines
de melons » auxquelles ressemblent le thé fini. Les régions
productrices de ce thé se répartissent sur les pentes des monts
Dabieshan, d’une altitude moyenne de 500 m ; à cet endroit,
la couverture forestière atteint 50 %, la température annuelle
moyenne, 15,3 ºC et les pluies, de 1 200 à 1 400 mm. De nombreuses
plantations se trouvent sur des flancs qui sont noyés en permanence
par les brumes et les nuages, ce qui donne de grosses feuilles
épaisses qui donnent plusieurs infusions. La caractéristique principale
de ce thé tient à ses feuilles « robustes », prêtes
à utiliser, alors que dans le cas des autres thés verts, on recherche
des feuilles « tendres ». Par exemple, le Huashan Yinhao
(Aiguilles d’argent de la montagne Jiuhuasha) fait sa renommé
grâce à ses 147 000 (au maximum 170 000) bourgeons terminaux les
plus tendres contenus dans un 500g.
Le Luan Guapian a été classé en 1949 parmi les dix grands
thés de Chine et est souvent servi par le gouvernement chinois
aux hôtes étrangers. On distingue trois niveaux de qualité :
le « Tipian », le meilleur, manufacturé avec des bourgeons
terminaux plus tendres et cueillis avant le 5 avril ; le
« Guapian », la deuxième qualité, fabriqué avec des
feuilles situées à proximité des bourgeons terminaux et cueillies
avant le 20 avril (gouttes de pluies) et le « Meipian »,
la troisième qualité, produit avec des troisièmes ou quatrièmes
feuilles cueillies avant le mois de juin (Meiyu ou « pluies
des prunes »).
Le thé noir Qimen provient du district Qimen. Au cours
de l’histoire, il a été un thé rare de Chine que l’on exportait,
et on le surnommait l’un des trois grands thés noirs les plus
profonds et les plus parfumés du monde. Les deux autres proviennent
de Darjeeling en Inde et de Uva au Sri Lanka.
Le thé noir Qimen, une variété de thé fermenté,
est réputé pour la couleur ambrée de ses infusions, ses feuilles
noires délicates et luisantes, et son goût malté et chocolaté,
subtile original. En 1915, il a remporté la médaille
d’Or à l’occasion d’un Salon international qui a eu lieu à Panama.
En 1980, il a gagné la médaille d’Or nationale. En 1987, il a
remporté pour la deuxième fois une médaille d’Or internationale.
L’apparition du thé noir Qimen remonte à plus de cent ans et est
devenu un thé d’élite.
La dernière
décennie
 |
| Des
feuilles fraîchement cueillies prêtes à subir le traitement. |
Actuellement, dans l’Anhui, les
plantations de thé couvrent 0,2 million hectares, le quatrième
rang du pays. Sa production de thé atteint 50 000 tonnes par an,
soit 9 % du rendement total du pays ou le sixième rang de Chine.
Il y a cinq millions de cultivateurs et un million d’opérateurs
s’affairant dans la plantation, la production et la distribution
du thé, lesquels se répartissent dans 50 villes et districts de
l’Anhui. Le volume d’exportation annuel représente de 20 à 30
millions de dollars US.
Le thé noir se vend principalement sur les marchés de
l’Europe de l’Ouest, des États-Unis, du Canada et des pays du
Sud-Est asiatique. En ce qui concerne le commerce du thé vert,
dont le volume commercial mondial est de 80 000 tonnes, la Chine
réalise l’exportation de 70 000 tonnes, soit plus de 80 % du volume
mondial du thé vert ; pour sa part, la province de l’Anhui
exporte 10 000 tonnes par an, soit 15 % du volume d’exportation
totale du pays, et les principaux marchés se répartissent sur
le continent africain et au Proche-Orient.
Stratégie
de développement et mesures adoptées pour le Xe Plan
quinquennal
Dans le but de mieux répondre aux
exigences de l’évolution du marché mondial et de garder sa position
sur les marchés mondiaux, l’Anhui continuera à déployer de grands
efforts pour généraliser la culture des théiers de bonnes espèces
dans de vastes régions productrices de thé, sur la base de modèles
appliqués ailleurs avec succès. La province possède maintenant
29 des meilleures espèces de théiers, dont 19 espèces clonées,
lesquelles jouent un rôle déterminant dans le développement de
l’industrie du thé. Cependant, pour l’heure, la vulgarisation
des espèces clonées en Chine est très modeste (à peine 16 %).
 |
| Le
16 septembre 1958, le président Mao Zedong visite l’Usine
de thé de la commune Shucha de l’Anhui. |
Dans les plantations de théiers,
l’Anhui procédera à la culture mixte, ce qui permet non seulement
d’assurer l’approvisionnement des feuilles fraîches de thé de
bonne qualité, mais aussi de maintenir l’équilibre écologique,
de contrôler et d’éliminer efficacement certaines maladies des
plantes et ravages des insectes nuisibles. Par exemple, dans la
région productrice des monts Huangshan, on a établi un système
bio-écologique à trois niveaux : la culture des arbres aux
sommets, la création des plantations de thé sur les pentes et
la culture céréalière aux pieds des montagnes.
« Les montagnes renommées
produisent des grands thés », dit le proverbe chinois. Le
thé préféré du président Jiang Zemin provient des monts Huangshan.
Il a demandé au premier ministre Zhu Rongji, d’offrir des thés
fabriqués dans ces monts à M. Gu Yuxiu, son ancien professeur
de l’Université Jiaotong de Shanghai, au cours de sa visite officielle
effectuée en 1999 aux États-Unis.
La province développera vigoureusement
les thés organiques et non polluants, mettra en oeuvre une stratégie
verte afin d’offrir des denrées alimentaires saines. Ces dernières
années, l’Anhui s’est aperçu à ses dépens que les consommateurs
des pays importateurs ne sont nullement disposés à accepter la
présence de résidus de pesticides dans les thés, et la province
a mis en place une série de mesures à cet effet : faire prendre
conscience aux cultivateurs et aux producteurs de thé de l’importance
et du rôle de la stratégie verte, renforcer le contrôle et la
surveillance de l’utilisation de pesticides par une mise à jour
de la législation et de la réglementation
au niveau provincial.
Dans le district Xiuning relevant
de la ville de Huangshan, on a l’objectif d’y implanter, à l’essai,
la culture de thé organique de la plus grande envergure, autant
au niveau provincial que national. Le district est maintenant
le plus grand cultivateur de thé organique du pays avec ses 206
hectares de plantations de théiers organiques, certifiés par le
Centre de certification du thé organique au sein de l’Institut
national de recherche sur les thés de Chine. Finalement, pour
garder à l’Anhui sa position sur le marché mondial du thé, outre
ces mesures, on y applique le système international de certification
de la qualité pour mieux contrôler la qualité dans les divers
processus, de la production à la distribution.
Liu Kai travaille
à la Société générale d’importation et d’exportation des thés
de l’Anhui.