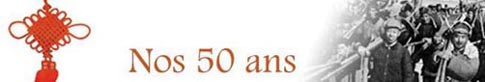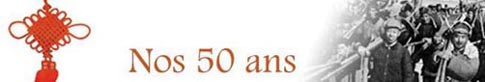La
Chine, une inconnue? Pas pour Victor Hugo
LOUISE
CADIEUX
EN avril
dernier, l’Université des langues étrangères de Beijing célébrait
le bicentenaire de la naissance de Victor Hugo. Diplomates de
la France et de certains pays de la Francophonie et personnalités
du monde littéraire de la Chine et de la France étaient présents
pour l’occasion. Ils ont salué, selon leur intérêt respectif,
les diverses facettes du génie de ce grand maître. Des étudiants
ont récité des poèmes. On a même pu admirer, grâce au Musée français
de Victor Hugo, soixante-trois grandes photos
de l’homme. Mais pour les personnes, dont je suis, qui
aiment tant Hugo que la Chine, la surprise de cette journée commémorative
a été d’apprendre que ce pays ne l’avait pas laissé indifférent.
Aujourd’hui, les Chinois le lui rendent bien.
Hugo, une image qui parle à la
Chine
Depuis un siècle, « on peut dire que Victor Hugo est
l’un des écrivains les plus lus en Chine », a déclaré Mme
Chen Naifang, présidente de l’université. En effet, « par l’intermédiaire
des premiers traducteurs chinois, c’est en 1903, soit moins de
vingt ans après sa mort, qu’est apparue la première traduction
de Les Misérables, et le nom de son auteur est connu de tout un chacun
chez nous », a-t-elle poursuivi. Mais pourquoi donc? Le discours
de M. Pierre Morel, ambassadeur de France en Chine, a fourni quelques
éléments de réponse. « L’image de Hugo qui parle le plus à la
Chine est celle du lettré qui, retiré du monde, admoneste l’empereur
», a-t-il dit. Quand on connaît l’engagement politique de Hugo
et ses déboires, on ne peut que saluer ce génie de la conscience
universelle et cet homme épris de justice qui a su inspirer génération
après génération de lecteurs. Mais plus particulièrement, les
Chinois n’oublieront jamais la dénonciation qu’a faite Hugo du
saccage du Palais d’Été par les forces occidentales, exemple type
de l’exploitation et du pillage des nations faibles par les puissants.
Comme l’a présenté M. Chen Haosu,
président de l’Association du peuple chinois pour l’amitié
avec l’étranger, cette prise de position de Hugo, citoyen du monde,
a en quelque sorte préparé les relations amicales entre la Chine
et la France. Pour les Chinois, Hugo est non seulement un monument
littéraire, mais aussi un combattant pour la justice, un exemple
de courage.
La Chine, un autre pôle de la
beauté suprême
Hugo n’est jamais venu en Orient mais il était assez
renseigné sur la région qui ne lui semblait pas étrangère, a déclaré
M. Franck Laurent, lors de sa conférence Hugo
et l’Orient. « Ce que je voudrais voir, je le rêve si beau
» a écrit Hugo dans Les Orientales (une œuvre poétique de 1829). Quelle que soit l’impression
que laissent ces lignes, l’intérêt de Hugo pour l’Orient (surtout
le monde arabo-musulman et l’Inde) puis la Chine, n’était pas
teinté d’un exotisme romantique, comme c’était souvent le cas
à son époque, mais faisait partie d’un imaginaire qui n’était
ni irréel ni mensonger mais source de création, a souligné le
professeur Laurent. Les
Orientales ne sont pas une description de l’Orient, une litanie
sur les ruines, mais une image poétique d’un monde ardent, rempli
de bruits et de couleurs, un monde vivant. L’Orient est l’occasion
d’une poésie nouvelle qui renoue avec la couleur, qui parsème
son vocabulaire de vocables orientaux, qui s’imprègne d’un style
imagé. Avec Hugo, l’Orient
et l’Occident se croisent et se rapprochent, l’Orient est l’altérité
intime nécessaire à la création.
Cependant, pour Hugo, l’Orient n’est pas qu’un ailleurs
littéraire. Il a aussi pressenti la naissance d’une nouvelle donne
géopolitique, le nouveau rôle que l’Orient sera appelé à jouer.
En fait, Hugo considérait plutôt la Chine comme un autre pôle,
avec la Grèce, comme un autre goût de la beauté suprême. À cet
égard, on ne peut que souligner l’intuition visionnaire de Hugo,
celle de la nécessité d’une réorganisation du monde.
La Chine apparaît d’abord dans la préface de Cromwell dans laquelle Hugo qualifie la
Chine d’ébauche de ce que la civilisation fera plus tard….en Occident.
Elle est une zone du monde qui a perdu les prémisses de la modernité,
une Chine éternelle et immuable, statique, qui s’endort. Ce jugement,
selon le professeur Laurent, tient, sans aucun doute, à la donne
géopolitique de l’époque : une Chine qui refuse l’expansionniste
anglais. En 1842, Hugo dénoncera la 1re guerre de l’Opium,
puis en 1861, dans une lettre au capitaine Butler, le sac du Palais d’Été, l’impérialisme européen.
Sur le Palais d’Été, Hugo dira : « Il y avait dans
un coin du monde, une merveille du monde ». Pour les Chinois, cette description que Hugo fait du Palais d’Été,
s’applique également à son œuvre.