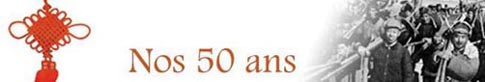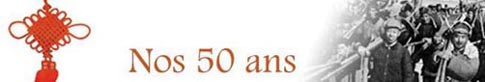VOYAGER
SANS TROP S’ÉLOIGNER
LISA CARDUCCI
CE qui est bien, quand on vit à Beijing, c’est de pouvoir
visiter plein d’endroits intéressants sans avoir à aller trop
loin. Dans la ville même, on peut sortir tous les week-ends et
encore faudra-t-il des années avant qu’on ait exploré tous les
parcs, les monuments, les sites liés à l’histoire ou à la mythologie,
les temples, etc. De plus, ville immense et immensément culturelle,
Beijing compte une centaine de musées dont le tiers au moins présentent
des expositions itinérantes. Il en va de même pour les galeries
d’art non gouvernementales et pour les institutions d’État, qui
à tour de rôle permettent à toutes les formes d’art de s’exhiber
devant un public novice ou connaisseur.
Le temple de
la Grande Cloche
 |
 |
| Cérémonie
de dévoilement de la « cloche de Lisa », coulée
par la célèbre Fonderie Marinelli d’Italie, au temple de la
Grande Cloche. |
Le
temple de la Grande Cloche, en réalité un musée, est un de mes
lieux de prédilection, peut-être à cause d’une contribution dont
je ne suis pas peu fière. Quelques semaines après mon arrivée
en Chine, j’ai commencé à établir des relations entre ce musée
et celui des cloches anciennes de Agnone, dans la Molise, région
de mes ancêtres, en Italie. Le 12 avril 1994, une cloche spécialement
coulée par la fonderie millénaire Marinelli, la plus ancienne
d’Italie, cloche dont il n’existe que deux exemplaires au monde,
était remise officiellement aux autorités du musée de Beijing
par mon intermédiaire. On l’appelait « la cloche de Lisa ».
Le musée chinois offrait en échange la reproduction d’un carillon
à neuf cloches de l’époque des Ming.
Le temple
de la Grande Cloche fut construit en 1733. Dix ans plus tard,
on y installa « la reine des cloches » (un de ses surnoms)
qui est, par sa taille, la deuxième au monde après celle de Moscou.
Fondue en 1406 sous le règne de Yongle, elle était une des six
qui devaient être suspendues aux six angles de la muraille de
Beijing; mais seule est-elle parvenue jusqu’à nous.
De 5,6 m
de haut (corps et anse) et 3,3 de diamètre, elle pèse 46,6 tonnes.
Elle fait deux étages de la salle où elle est exposée. D’une galerie
suspendue où l’on accède difficilement par un escalier fort étroit
et irrégulier, on peut jeter dans l’orifice qu’elle porte au sommet
des pièces de monnaie « afin d’obtenir la chance ».
Sur la panse de la cloche est gravé le Sûtra du Diamant et sur
sa paroi intérieure, le Sûtra du Lotus, 227 000 caractères
impeccablement tracés par Shen Du, célèbre calligraphe de la dynastie
des Ming. Malgré son âge, cette cloche ne présente aucune marque
d’usure ou de corrosion. Elle témoigne de la haute qualité du
travail des fondeurs du XVe siècle.
La cloche
se trouvait d’abord dans le temple de la Longévité (Wanshou),
à 8 km environ. Pour la déplacer, on versa de l’eau sur tout
le chemin reliant les deux temples, l’hiver, puis on la fit glisser
sur la glace. Elle fut installée sur un tertre. On bâtit autour
d’elle une salle destinée à l’abriter, de façon à ce que la cloche
fût librement suspendue quand on enlèverait la terre du tertre.
Depuis 200 ans, la cloche n’a pas bougé d’un centimètre, et même
le tremblement de terre de 1976 ne l’a pas ébranlée.
La reine
des cloches est célèbre surtout par la qualité de sa résonance.
En 1980, les conclusions de l’Institut d’acoustique de l’Académie
des sciences de Chine n’ont fait que confirmer ce qu’on avait
préalablement reconnu.
Il existe
trois différences fondamentales entre les cloches occidentales
et les cloches orientales. La première réside dans leur fonction.
Essentiellement religieuse, la cloche occidentale est ajoutée
comme un accessoire aux tours et églises, tandis qu’en Chine on
construit généralement un temple autour de la cloche pour la célébrer,
la protéger et la garder, car la cloche est coulée en vue de marquer
ou commémorer un événement historique ou culturel.
La deuxième
concerne la forme: évasée au bas en Occident, la robe de la cloche
descend tout droit en Orient, ou est même légèrement recourbée
vers l’intérieur.
Je voyais
un jour au temple du Bouddha couché, dans les collines de l’Ouest
de Beijing, des étrangers examiner une cloche chinoise et dire
qu’on avait dû enlever le battant pour empêcher que les curieux
fassent résonner la cloche à tout moment. Ils avaient tort. Il
s’agit là de la troisième différence : on sonne les cloches
occidentales au moyen d’un marteau suspendu à l’intérieur, tandis
que la cloche orientale résonne sous le coup d’une poutre de bois
dont on la frappe de l’extérieur, sur un point de résonance idéale
déterminé.
Temples
 |
| Le temple Wanshou de Beijing. |
Les temples
bouddhiques semblent faire partie de la nature, c’est-à-dire que
leur emplacement et leur architecture se confondent avec l’environnement.
Souvent au cours de l’histoire, d’anciennes résidences furent
transformées en temples, entourés de jardins et de cours. Puis
les temples furent établis hors des grandes villes, ce qui resserra
les liens entre l’homme et la nature. Les bouddhistes construisaient
leurs temples sur des sites très attrayants, même très haut dans
les montagnes ou dans les profondeurs des forêts, près de sources
ou de cascades. Parfois les temples semblent se perdre dans les
nuages et la brume, car leur fonction est de permettre à l’âme
d’échapper au quotidien. En y accédant pas à pas, de la confusion
de la ville au sommet d’une colline, le pèlerin doit « mériter »
la paix qu’il y trouvera. Au long du parcours, on jouit du murmure
du vent dans les arbres et du repos dans de petits pavillons avant
d’arriver à la porte qui s’ouvre sur un monde de paix.
Certains
temples, enfouis dans les montagnes, ne sont visibles qu’au moment
où l’on y parvient, après avoir traversé une forêt de bambous,
grimpé, redescendu, parcouru un sentier qui serpente en s’harmonisant
avec le lever ou le coucher du soleil, les pics, les nuages suspendus,
sentier qui permet de contempler des scènes magnifiques et inoubliables.
Car, pour
avoir l’air tout à fait naturels, les chemins et les plates-formes
d’observation du paysage n’en sont pas moins le dessein de l’homme,
en harmonie avec l’environnement, abaissant une à une ses cartes,
levant le voile sur ses mystères, réservant des surprises, révélant
ses secrets aux seuls initiés capables de patience.
Ce qui est
souvent étonnant pour nous, Occidentaux habitués aux espaces ouverts,
c’est de découvrir tout ce qui se cache comme merveilles dans
un parc ou un temple, derrière la haute et épaisse muraille qui
les entoure. Ce n’est qu’une fois qu’on a acheté un billet et
qu’on a passé l’entrée principale qu’on peut se rendre compte
du nombre de salles, de cours et même de jardins d’un temple,
ou de la présence d’un lac agrémenté de canards et de poissons
rouges, ou sur lequel on peut se promener en bateau, d’espaces
verts, d’une aire de jeu, de restaurants, de boutiques de souvenirs,
etc. qui se trouvent dans un parc.
Beidaihe
 |
| La plage de Beidaihe : pour les
baigneurs…et les rêveurs. |
Mai a été
torride, juin est infernal. Pour fuir un peu ce soleil sec et
poussiéreux de la ville, je m’évade à Beidaihe quelques jours.
La mer! La mer enfin retrouvée, c’est l’Italie retrouvée. J’ai
peine à croire que je suis en Chine. Le sentier qui descend de
notre hôtel à la plage ressemble comme un frère jumeau à celui
de mon ancienne résidence dans le Latium. La petite ville ne vit
que de tourisme: hôtellerie, restauration, boutiques de souvenirs,
des objets en coquillages surtout et qui ont conservé l’odeur
saline de la mer, des poissons et des algues séchés, de luxueuses
villas.
Le
soir, le marché s’anime, et le long des rues, des dizaines de
petits restaurants invitent les passants à choisir leurs fruits
de mer vivants dans des bacs à l’extérieur et à les savourer à
l’intérieur, à un prix dérisoire. Une fois fini l’été, Beidaihe
ferme ses portes pour l’hiver. Ici, l’on jouit des mêmes avantages
que dans toutes les stations balnéaires d’Europe à un prix dix
fois inférieur. Selon les années, on peut y revenir jusqu’à la
fin d’octobre, histoire d’entretenir son bronzage...
Trois
ans plus tard (1995), la petite ville est devenue un endroit touristique
et commercial, incroyablement modernisé en si peu de temps. Partout
de grands magasins, de nouveaux hôtels et des restaurants de luxe.
Cet endroit était fréquenté uniquement par les étrangers, autrefois.
Maintenant, c’est le lieu où l’État envoie ses fonctionnaires
en vacances, dans des villas de type méditerranéen, et les simples
citoyens y vont aussi. C’est là aussi que, depuis plusieurs décennies,
les chefs d’État se reposent et reçoivent leurs invités de marque
pendant la saison chaude. Mais avec la modernisation, fini l’Hôtel
Diplomatique avec ses chambres à quatre lits pour 60 yuans
par jour! Par contre, depuis 1996, uniquement pendant l’été, un
train rapide à deux étages et des plus confortables, parcourt
la distance en deux heures et demie seulement. De plus, on peut
acheter les billets aller-retour (sur ce trajet seulement). Bien
sûr, il en coûte environ dix fois plus qu’auparavant. C’est la
rançon du progrès.
Tianjin
Éloignons-nous
maintenant (bof! à peine!) de la capitale, vers la première ville
au sud-est, Tianjin, qui avec Shanghai, Beijing et, depuis 1997,
Chongqing, relèvent directement de l’administration centrale.
La première
fois que j’y suis allée, en 1992, j’avais été frappée par la propreté
de la ville, alors que je m’attendais à énormément de pollution,
puisque c’est une ville industrielle.
 |
| Une église catholique fait partie du
paysage architectural différent de Tianjin. |
En entrant
à Tianjin, on remarque une surprenante architecture: des maisons
coloniales de style français, anglais, hollandais et de somptueux
édifices à colonnes carrées ou rondes. Les façades sont ornées
de fenêtres marquises et de volets de bois. Les tuiles vernissées
qui ornent les magasins et les pavés rouges, verts et jaunes me
faisaient remarquer, toujours il y a dix ans, que Beijing était
toute grise. Comme elle a changé depuis !
On va à Tianjin
pour se procurer (même au détail) des vêtements au marché de gros,
et pour sa « Cité alimentaire ». Il s’agit d’un immense
marché couvert avec des restaurants sur la mezzanine, tandis qu’au
rez-de-chaussée on vend de nombreuses spécialités locales: des
cacahuètes et des fèves enrobées de sucre à la menthe, de miel,
de sel ou de piment, glacées à l’orange ou au chocolat, etc.;
des pâtisseries frites appelées « da ma hua’r »,
parsemées de graines de sésame; des baozi,
petits pains à la vapeur farcis de viande qu’on appelle ici « gou
bu li », c’est-à-dire « les chiens ne regardent
pas », tellement était laid, dit-on, le cuisinier qui les
lança sur le marché. Mais les légendes affluent autour de ce nom.
« Gou bu li » pourrait être le surnom du patron
qui était tellement occupé à confectionner ses baozi et à servir sa clientèle qu’il n’avait le temps de regarder
personne.
Tianjin est
aussi célèbre pour ses manufactures de tapis, ses estampes du
Nouvel An et ses figurines en terre de la famille Jiang, et sa
Gu Wenhua Jie (rue de la Culture ancienne).