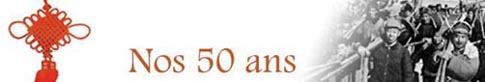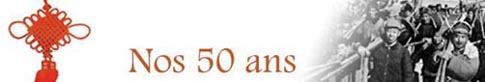Le
Fujian, pourquoi pas?
LOUISE
CADIEUX
 |
| Les
eaux calmes du lac Shiman dans les monts Guanzai. |
Province
côtière du Sud-Est de la Chine, le Fujian ne fait pas partie des
destinations les plus courues par les touristes étrangers, malgré
la longue histoire d’ouverture sur l’extérieur de ses ports de
mer. J’y étais déjà allée en 1999, pour visiter les monts Wuyi,
au moment de leur inscription au Patrimoine mondial de l’humanité.
J’avais alors été particulièrement impressionnée par la richesse
naturelle et culturelle de l’endroit et sa bonne conservation.
C’est donc avec empressement que j’ai saisi l’occasion de visiter
une autre partie de cette province, celle qu’on appelle Minxi,
(Min, ancienne appellation
du Fujian et Xi signifiant
ouest), en espérant l’apprécier autant que la première.
Les
impressions de la première heure
De
Beijing, le train nous a conduit à Zhangping en quelque 30 heures,
mais dès notre arrivée, nous repartions vers la ville de Longyan,
notre première destination, sans toutefois que notre guide n’eût
oublié de mentionner (peut-être pour que nous ayons le goût d’y
revenir?) que Zhanpping était surnommée « Ville des fleurs » et
qu’elle était fort renommée pour l’exportation des azalées. En
effet, sur la route, en dépit du nombre surprenant de motos (200 000
dans la région) qui zigzaguaient pour dépasser notre bus et qui
ne pouvaient manquer d’attirer notre attention, tantôt par leur
vitesse, tantôt par leur charge, il était impossible de ne pas
remarquer le grand nombre de serres.
Puis,
peu à peu, c’est la région de Longyan qui s’est dévoilée :
montagneuse, avec une couverture boisée atteignant 79 %, alors
qu’en Chine, elle n’est en moyenne que de 13 %. C’est donc dire
l’importance qu’on y attache. Autrefois pauvre, la région base
aujourd’hui son économie sur l’exploitation d’une mine d’or, la
culture du tabac et les produits naturels comme les cacahuètes,
les patates et la transformation des pousses de bambou. D’ailleurs,
au cours du voyage, chaque repas sera un délice car on nous servira
de ces pousses, apprêtées de mille et une façons savoureuses.
Les
monts Guizan et Gutian
Ces
monts, qui s’étendent sur 123 km2, sont renommés pour
leurs rochers aux formes bizarres auxquels on a donné divers noms
évocateurs, ainsi que pour leurs eaux tranquilles, comme celles
du lac Shimen. Une excursion en bateau sur ce lac nous a permis
d’admirer ces bizarreries rocheuses, les cascades et la végétation
luxuriante. Mais rien n’a été mieux que la bonne escalade que
nous avons faite pour sentir toute la vitalité de ces monts et
admirer les crevasses étroites et les vallées profondes. Et quel
panorama s’offre à la vue de quiconque veut bien se donner l’effort
de grimper jusqu’au sommet! Inscriptions rupestres et pavillons
divers agrémentent la montée qui s’accomplit généralement en deux
heures, sans trop se presser. On peut y constater que l’écosystème est bien préservé et diversifié,
et fort important, que le commerce n’a pas envahi chaque détour
de sentiers. La visite est donc agréable et reposante.
Pour
les Chinois, Gutian est un nom chargé d’histoire, et nous n’avons
pas manqué de nous y arrêter. En effet, c’est là, qu’en décembre
1929, Mao Zedong, Zhu De et Chen Yi ont tenu une réunion, connue
sous le nom de Conférence de Gutian, qui a conduit à la formation
de la quatrième armée rouge du Parti communiste chinois. Les bâtiments,
agencés selon la disposition d’un siheyuan
(cour carrée traditionnelle), sont situés au milieu de champs
entourés de montagnes. Nous avons pu y voir, entre autres, les
salles où Mao a tenu ses réunions, son bureau et sa chambre. C’est
là aussi qu’il a écrit la phrase célèbre : «Une seule étincelle
peut allumer le feu d’une prairie entière.» Il va sans dire que
les appareils photos étaient au rendez-vous car tout un chacun
voulait immortaliser sa venue dans ces hauts lieux.
Peitian,
le monde des officiels hakka
 |
| Vieille
dame de l’ethnie hakka à Peitian. |
C’est
probablement l’ethnie des Hakka qui, grâce à ses coutumes particulières
et à l’architecture des maisons, attire le plus de touristes dans
la région. Les ancêtres de cette ethnie étaient originaires de
la région du fleuve Jaune; au fil des inondations et des guerres
d’antan, les Hakka se sont déplacés vers le sud et les montagnes
du Fujian où ils habitent encore aujourd’hui en communautés compactes,
voire même en clans.
Durant
notre voyage, nous avons eu l’occasion de visiter deux lieux de
résidence typiques de cette ethnie : Peitian, un village
d’anciens officiels durant les dynasties des Ming (1368-1644)
et des Qing (1644-1911) et le tulou Zhencheng, (une maison ronde en terre
battue, ressemblant à une forteresse, typique de cette ethnie)
à Hongkengkou dans le district de Yongding. Sans aucun doute,
ces deux endroits valent le déplacement!
Le
village de Peitian, qui porte le titre de « rareté architecturale
des Hakka », présente non seulement une beauté typique des villages
aux bâtiments anciens, mais aussi une richesse ethnographique
fort appréciée par les experts.
C’est
une immense noria en bois et un étang où nagent les canards qui
accueillent d’abord les visiteurs et donnent le ton du rythme
de vie du village. Mais il ne faut pas bien long pour voir apparaître
les visages souriants des villageois, fort conscients d’habiter
un lieu hors du commun.
Le
village comprend trente grands manoirs, vingt et une salles des
ancêtres, six académies, deux portes en arc et une ancienne rue
dallée qui s’étire sur un kilomètre. En raison du raffinement
de la conception et de l’art sculptural unique de ces bâtiments,
le village est considéré comme une véritable mine d’or pour quiconque
veut apprécier des architectures harmonisant savoir-faire et art.
Même les cours sont pavées de manière recherchée ; par exemple,
là où était située autrefois la porte d’entrée d’un manoir, les
galets avaient été arrangés de manière à illustrer un chevreuil
et une grue. Au détour des rues, on peut encore voir des sculptures
qui ornaient les maisons des officiels, d’anciens puits où les
contemporains vont encore puiser une eau claire comme on en trouve
rarement. À vrai dire, il faut parfois se pincer pour ne pas oublier
que, en dépit de ce paysage d’une autre époque, nous sommes toujours
au XXIe siècle!
Les
tulou, un univers de
vie hors du commun
 |
| Vue
intérieure et extérieure du tulou Zhencheng. |
Le
clou de l’étonnement revient toutefois à la visite d’un tulou, dont on compte plus de 20 000 exemplaires et 30 styles
dans le seul district de Yongding! La première question qui surgit
inévitablement est : « Mais pourquoi donc les Hakka ont-ils
choisi de bâtir ces maisons forteresses? » On dit que, dans les
temps anciens, l’ouest du Fujian aurait subi des guerres incessantes,
que le banditisme y faisait rage et que des luttes entre les clans
se déclaraient fréquemment. Ce contexte aurait donc forcé les
personnes qui s’étaient déplacées du nord à prendre des mesures
pour renforcer la sécurité de leurs habitations. En outre, les
migrations de grande envergure auraient également posé les conditions
préalables à la construction de ces complexes d’habitation collectifs
qui remonteraient à la dynastie des Tang (618-907). Ceux-ci se
seraient perfectionnés durant les Ming (1368-1644) et
les Qing (1644-1911), en raison de la prospérité du commerce
et de l’avancement des techniques.
Puis,
on se demande comment ces grandes forteresses rondes, dont la
plupart couvre 200 m2, ont pu être bâties. On apprend
d’abord que celles-ci n’ont pas toujours été rondes, mais qu’au
fil du temps, cette forme a été préférée à cause de l’économie
de matériaux, de la facilité de défense et de distribution entre
les familles qu’elle permettait.
Puis, que primait le choix du site.
En plus de la tradition de construire à flanc de colline
et devant une rivière ou un étang, ces bâtiments devaient être
construits sur un terrain sec, préalablement choisi selon les
principes de la géomancie (fengshui), dont le sol pouvait être facilement battu. Pour bâtir ces
forteresses de terre, la procédure la plus importante était de
bien compresser la terre. On creusait donc en profondeur pour
obtenir une terre collante que l’on mêlait bien à une terre sablonneuse.
Tout en édifiant la construction à partir de ce mélange de terres,
on utilisait des bambous et des branches d’arbres pour renforcer.
Durant les travaux, on portait une grande attention à la direction
dans laquelle frappaient les rayons du soleil, de manière à prévenir
un déséquilibre des murs durant le séchage. Si un mur avait séché
trop vite, le bâtiment aurait pu pencher du côté de la partie
la plus humide et causer un effondrement.
Il
semble que ces constructions s’harmonisent particulièrement avec
la nature : chaudes en hiver et fraîches en été, elles préservent
leurs habitants des dangers, du vent, du feu et même des tremblements
de terre, dit-on. En effet, une crevasse apparue dans la structure
de l’une d’elles après un tremblement de terre se serait refermée
d’elle-même immédiatement après.
Le
tulou Zhencheng que
nous avons visité est une construction de quatre étages, édifiée
en 1927, qui abrite actuellement huit familles et toutes leurs
générations. On pénètre
dans cette construction en forme de champignon par une entrée
carrée qui donne accès au complexe d’habitations comme tel. À
l’intérieur, tout autour, on peut voir des corridors en bois avec
toits en tuiles grises et rampe en fer. Au rez-de-chaussée, se
trouvent la cuisine, les douches des femmes à droite, celles des
hommes à gauche et au centre, le puits et l’étable. Partout, les
plantes et les fleurs s’épanouissent. Le deuxième étage sert d’entreposage
pour les céréales et il n’y a aucune fenêtre. Aux troisième et
quatrième étages se trouvent les chambres qui sont alignées comme
les alvéoles d’une ruche. Pour que chaque famille ait l’impression
d’avoir un chez-soi bien à elle, le complexe est divisé en huit
trigrammes et chaque famille occupe donc une section indépendante.
L’autel des ancêtres est toutefois le cœur commun de ce bâtiment
et, accroché au mur, trône le portrait de son concepteur. Dans ce lieu, on tient les discussions, les
mariages, les funérailles et les fêtes, on y accueille les invités.
Pour
des Occidentaux, habitués à une vie individualiste où la propriété
de chaque objet tient presque du sacré, il est vraiment inhabituel
de constater l’unité des occupants de cette maison multifonctions,
de les voir vaquer à leurs affaires comme le ferait n’importe
quelle famille ou bien prêter main forte, de bon coeur, à un «voisin
» qui a besoin d’aide dans sa tâche. Au moment de notre visite,
dans une des pièces du dernier étage, une famille célébrait une
noce : certains invités trinquaient, d’autres admiraient
les cadeaux de noce déposés sur le lit, d’autres encore avaient
les yeux rivés au téléviseur pour suivre les paroles d’une chanson
d’amour. Pour leur part, les mariés ont offert un verre à l’Occidentale
de passage que j’étais, et j’ai été bien contente de pouvoir leur
offrir mes vœux de bonheur.
Gulangyu,
un charme incontestable
 |
| Gulangyu,
une île où se marient l’esthétique occidentale et le charme
oriental. |
Avant
notre retour à Beijing, nous avons encore eu l’occasion de goûter
brièvement aux charmes de l’île de Gulangyu, située en face de
la ville de Xiamen. Notre passage y a été très court, mais suffisamment
long pour bien sentir que l’atmosphère de détente qui y règne
ne peut manquer de séduire. Rues qui sinuent et qui font découvrir
tantôt des architectures occidentales, tantôt des architectures
chinoises, bord de mer qui comble les goûts de chacun--solitude
ou animation des terrasses de cafés-- nombreux restaurants qui
accueillent les amateurs de poissons bien frais et essaims de
boutiques où abondent les souvenirs. S’ajoute la brise marine
qui ne manque pas de faire le bonheur de ceux qui viennent y chercher
le vent du large.
«
Pourquoi le Fujian quand la Chine est si grande et offre tant
à voir?», me direz-vous. Pourquoi pas le Fujian? , vous répondrai-je
maintenant sans hésiter.