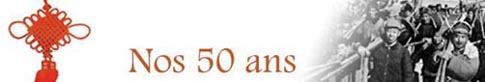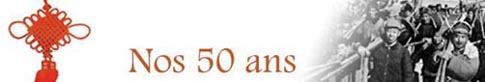L’adaptation
au quotidien
LISA CARDUCCI
 Dans
certains domaines de la vie quotidienne, la volonté de s’adapter
à l’autre cause parfois des ennuis. Ainsi, les Chinois savent
que dans plusieurs pays, on a l’habitude de donner d’abord le
prénom des gens, suivi de leur nom de famille. Qu’arrive-t-il
si un Français, dans le but de s’adapter à la situation chinoise,
se présente comme Sauvé Dominique, et que le Chinois refait la
conversion? J’ai même entendu sur les ondes d’une station de télévision
nationale d’un certain pays appeler le président de Chine « Zemin »,
tout simplement! J’avoue que, dans ce cas, il s’agissait d’ignorance
crasse…
Dans
certains domaines de la vie quotidienne, la volonté de s’adapter
à l’autre cause parfois des ennuis. Ainsi, les Chinois savent
que dans plusieurs pays, on a l’habitude de donner d’abord le
prénom des gens, suivi de leur nom de famille. Qu’arrive-t-il
si un Français, dans le but de s’adapter à la situation chinoise,
se présente comme Sauvé Dominique, et que le Chinois refait la
conversion? J’ai même entendu sur les ondes d’une station de télévision
nationale d’un certain pays appeler le président de Chine « Zemin »,
tout simplement! J’avoue que, dans ce cas, il s’agissait d’ignorance
crasse…
Quand on parle d’étages en Chine, il faut faire attention : le Chinois
qui dit habiter au sixième s’adresse-t-il à moi en tant que francophone,
donc présumée Française, ou compte-t-il à la chinoise? En Chine,
comme au Canada d’ailleurs, le rez-de-chaussée est appelé premier
étage, mais en France, le premier est le deuxième pour les Chinois
et les Canadiens.
Dans ce pays, quand nous pensons en termes de notre propre culture, il
peut nous arriver de commettre des impairs. Par exemple, je venais
d’arriver à Beijing quand se produisit cet événement auquel les
lecteurs occidentaux ne verront peut-être rien d’anormal dans
mon comportement mais qui était tout à fait hors des règles, comme
je l’ai compris peu après. Mes deux balcons fermaient à clef,
mais la clef qu’on m’avait donnée n’était pas la bonne. Je me
disais que cette clef devait bien servir à quelque chose.
 |
| Confucius
et ses disciples. |
D’autre part, je logeais à l’extrémité sud de notre bâtiment, tout en longueur,
tandis que la sortie se trouvait à l’extrémité nord. Chaque fois
que je voulais sortir, je devais effectuer exactement cent pas
vers la porte, puis les refaire à l’extérieur en sens inverse,
jusqu’à la grille. Pourquoi n’a-t-on pas pensé à percer une porte
également du côté sud?, me demandais-je. Pourtant, il y en avait
bien une, cachée derrière un rideau. À tout hasard, j’essayai
ma clef, et c’était la bonne! Fini, l’interminable corridor! J’avais
ma sortie privée, et surtout mon entrée privée au cas où m’aurait
pris la fantaisie de rentrer passé 23 h.
Je me croyais maligne, avec ma clef secrète. Eh bien! Je fus attrapée.
On ne doit pas passer par cette porte, un point, c’est tout! Ici,
tout est règlement. On ne sait jamais qui est au-dessus. L’autorité
n’est pas une personne mais un pouvoir moral impersonnel. Ce qui
est permis ou pas permis est dit, et on le sait ou doit le savoir.
Pas de discussion.
Une autre fois, je voulais apporter à mon appartement une chaise qui ne
servait pas (la poussière qui la couvrait le prouvait) près de
la cantine. Je demandai donc la permission (je commençais à « m’adapter »)
au préposé à la réception. Il me répondit qu’il allait demander
et que j’aurais la réponse le lendemain. Jamais personne ne prend
une décision immédiate; on vous répondra toujours qu’il faut consulter
d’abord. Si une personne s’était trompée en donnant une autorisation,
elle serait vertement blâmée. Deux têtes valent mieux qu’une,
c’est connu, mais c’est surtout la hiérarchie à respecter qui
impose l’anonymat des responsabilités.
Se faire des amis chinois n’est pas facile, contrairement à ce qu’en pensent
les visiteurs en se basant sur le sourire poli des Chinois et
sur leur généreux emploi de l’expression « amis étrangers ».
Pourtant, quand on a la chance de se faire un véritable ami, il
sera là pour la vie, entièrement dévoué à vous comme il attendra
que vous le soyez pour lui.
Entre Occidentaux, dès une première rencontre, on peut parler de religion,
de situation de famille,
d’engagement politique, de groupes dont on fait partie, de goûts
en matière de cinéma ou de musique, de mode ou de voyage. On ne
se demande pas à qui l’on a affaire. Tous les sujets de conversation
sont permis. On ne soupçonne personne. Si l’interlocuteur réagit
favorablement, on le trouve sympathique et on manifeste l’intention
de le revoir. Sinon, tout s’arrête au bout de quelques minutes,
quelques heures tout au plus, et l’on oubliera même avoir rencontré
cette personne.
 |
| Autres
pays, autres mœurs! |
Il n’en va pas de même en Chine. Le Chinois va d’abord vous sonder. Petit
à petit, par des questions superficielles et timides (mais que
vous trouverez sans doute fort indiscrètes), il va vous tâter
pour découvrir qui vous êtes. Si vous lui plaisez (dans certains
cas, s’il perçoit que vous pouvez lui être utile), il approfondira
la relation, peut-être même jusqu’à l’amitié, alors qu’en Occident,
on fait d’abord des confidences puis se retire sans gêne. En Chine,
créer un lien c’est créer un engagement, et on perdrait la face
en le rompant. D’où une extrême prudence!
Le manque de connaissance de la culture de l’autre est réciproque. Ainsi,
une Étatsunienne qui avait vécu longtemps dans le sud de la Chine
puis finalement à Beijing, invita-t-elle des amis au restaurant
où elle avait commandé le « banquet impérial ». Ce repas
comprend un grand nombre de plats qui arrivent sur la table selon
l’alternance des quatre saveurs : salé, sucré, piquant, amer.
Or, l’hôtesse enlevait tous les plats sucrés et les petits gâteaux,
qu’elle plaçait sur une table voisine, en souriant de « cette
mauvaise habitude qu’ont les Chinois de manger le dessert avec
le poulet ». Dans ce cas, c’est elle, et elle uniquement
qui était dans l’erreur. Elle avait pourtant passé quatorze ans
en Chine mais n’avait encore rien compris. De plus en plus d’étudiants
étrangers viennent apprendre la langue sur place. La langue étant
un véhicule de culture, il est à souhaiter que l’on apprenne à
se connaître mutuellement afin de s’apprécier et de s’entraider
davantage.
D’une tribune à l’autre
Lors de mon premier cours à l’Université des langues étrangères de Beijing,
après deux heures d’enseignement, je m’apprêtais à quitter la
classe au son du timbre, ramassant mes livres tout en continuant
à converser avec les étudiants. Dès que je terminais une phrase,
quelques-uns se levaient, puis se rassoyaient. Je me demandais
s’ils allaient me tenir sur place encore bien longtemps, quand
mon esprit s’éclaira : ils avaient sûrement un autre cours
dans cette même classe, voilà pourquoi ils ne quittaient pas les
lieux. Mais à ma question, ils répondirent que non. « Pourquoi
donc ne sortez-vous pas? », demandai-je alors directement?
« Ce n’est pas poli quand le professeur est encore dans la
classe. » Pourtant, il me semblait bizarre de sortir la première,
alors qu’au Canada c’est le professeur qui éteint la lumière et
ferme la porte. Ce fut ma première leçon de culture chinoise.
Au cours des semaines, des mois qui suivirent, j’en apprenais un peu plus
chaque jour sur tous les aspects de la vie. Parfois, je discutais
avec les jeunes de ce qui se faisait dans mon pays d’origine dans
telle ou telle situation. Même s’ils trouvaient parfois que « la
manière occidentale » était meilleure, ils étaient toujours
amorphes quand il s’agissait de se mettre en branle. S’agissait-il
d’une forme de paresse? C’est que, il me semble, ils étaient défaitistes
devant les changements à accomplir « parce que nous savons
que nos efforts seront inutiles », était la réponse.
Signer un contrat?
Lorsque, peu après l’ouverture de la Chine à l’étranger, en 1978, les Occidentaux
commencèrent à négocier avec les Chinois, ils étaient souvent
déconcertés par la « lenteur » avec laquelle procédaient
les négociations. De là à croire à un échec total après une première
rencontre, le pas était rapidement franchi. Les Chinois, pour
leur part, trouvaient bien vulgaires les Étatsuniens qui, de but
en blanc, parlaient d’engagements et de signatures. Maintenant,
on sait à l’Ouest que les Chinois procèdent par étapes :
d’abord, une rencontre de présentations, suivie d’une autre où
l’on parle des pays respectifs et un peu des produits; puis, on
commence à penser que peut-être on aurait mutuellement quelque
chose à retirer d’éventuels échanges. Mais, en quoi pourraient
bien consister ces échanges? Et pendant ce temps, on écrit des
lettres d’intention, un mémorandum, et l’on fait discrètement
enquête sur la fiabilité de l’entreprise étrangère. Ce n’est qu’ensuite
qu’on en arrive à une entente de principe, des accords, un contrat,
des signatures et des tampons.
Les deux parties sont, de nos jours, mutuellement mieux renseignées sur
la façon de fonctionner du partenaire; c’est ce qui permet d’éviter
des difficultés et des déceptions.
 |
| Manifester
des sentiments négatifs, une impolitesse pour les Chinois.
Caricatures Du Jinsu |
Jusqu’à très récemment, un contrat en Chine n’avait pas la même signification
ni la même valeur qu’en Occident. Si on le signe, c’est qu’on
a décidé de réaliser quelque chose avec quelqu’un en qui on croit
pouvoir placer sa confiance. Ensuite, seulement, on discutera
des modalités, des chiffres, des échéances, trouvant les solutions
aux problèmes au fur et à mesure qu’ils se présenteront. En avril
1992, le premier McDonald’s pékinois ouvrait ses portes. Huit
cents places sur deux étages. En octobre 1994, la partie chinoise
demanda à McDonald’s de déménager ses pénates : la rue Wangfujing
était en pleine restructuration. De richissimes entrepreneurs
de Hongkong avaient besoin de cet emplacement. Les plus sages,
habitués à négocier avec les Chinois, ne furent pas trop surpris;
ils savaient que cela était dans le domaine du possible.
Maintenant que le slogan « Un pays gouverné par la loi » n’est
plus simplement un slogan mais a été réalisé en Chine, et surtout
depuis que la Chine est devenue membre de l’Organisation mondiale
du commerce en décembre 2001, les contrats ont pris une autre
tournure.
Il arrive que des étrangers qui ne s’adaptent pas à leur poste de travail
en Chine pensent pouvoir quitter le pays sans problème pour la
simple raison qu’ils n’ont pas encore signé de contrat. Ce qu’ils
ignorent, c’est que même si les Chinois font depuis peu ce que
tout le monde fait – signer un contrat – l’engagement est encore
bien plus lié à la parole, dans leur esprit, qu’à un bout de papier.
Briser un contrat verbal les frappera plus profondément, sans
doute, que de voir déchirer un contrat écrit.
(Extrait de La Chine, telle que je la vis)