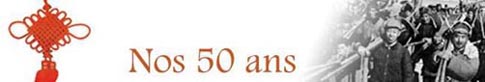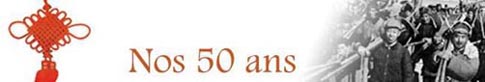Le
quotidien d’un expert étranger en Chine
LISA
CARDUCCI
 |
| Caricature : Du Jinsu. |
Pour la troisième fois, je
descendais à l’aéroport de Beijing en août 1991. La première,
c’était en 1985; je voyageais en touriste. Mon deuxième séjour
remonte à quatre ans plus tard. Je résidais alors à l’Institut
des langues de Beijing, et j’étais venue en Chine pour terminer
la rédaction de mon roman Stagioni d’amore dont une partie
se déroulait en Chine, comme j’avais écrit les trois autres parties
dans les pays qui servaient de cadre à l’action. Je partageais
une chambre avec une Hollandaise à l’Institut des langues de Beijing.
Il ne s’agissait pas d’une pension ouverte à tout venant ;
donc, afin de pouvoir y loger, j’avais dû m’inscrire aux cours
de chinois, payer la scolarité
et, bien sûr, aller en classe chaque avant-midi.
En 1991, cette fois, j’étais
invitée comme professeur à l’Université des langues étrangères
no 2. Je disposais d’un appartement de deux pièces
(12 x 3 m), avec une entrée, une cuisinette et une salle de bains.
Véritable orgie d’espace quand les « familles » chinoises
vivent parfois dans une seule pièce et partagent les services
avec les voisins de palier. Des meubles simples, mais le confort
et le nécessaire y étaient. Même la literie était fournie, et
changée chaque semaine. Chaque pièce d’ameublement portait une
étiquette numérotée fixée à vie par une généreuse application
de vernis. C’est dans le salon que je travaillais, aussi bien
que je m’y reposais ou que j’y recevais des visiteurs. J’y avais
installé mon ordinateur et mon chevalet.
Voici maintenant notre campus.
À côté de notre résidence, les dortoirs des étudiants chinois.
Ils étaient 1 400 seulement (notre université était petite)
à se partager 30 professeurs et huit langues. Le japonais et l’anglais
formaient des sections indépendantes. Nous avions aussi une soixantaine
d’étudiants étrangers. Notre université deviendrait bientôt l’université
d’Hôtellerie et de Tourisme. En général, les étrangers demeurent
deux ans à un poste d’enseignement, car on veut éviter, semble-t-il,
qu’ils deviennent trop familiers avec les Chinois.
Les visiteurs chinois étaient admis entre 8 h et 22
h 30, et devaient toujours laisser leur carte d’identité à la
réception, signer à l’arrivée et au départ. Bien entendu, personne
n’aurait pu passer la nuit chez un étranger. Nous, les étrangers,
n’étions jamais inquiétés quant aux visites que nous recevions,
mais souvent les Chinois avaient à répondre de leurs actes, pour
peu qu’ils fréquentassent des étrangers. Entre 1993 et 2000, les
choses ont progressivement changé. La confiance s’est établie,
le contrôle de la vie privée, autant des Chinois que des étrangers,
est devenu moins strict, et les mesures disciplinaires se sont
assouplies, jusqu’à disparaître dans certains cas ou endroits.
Si je raconte ces événements passés, c’est pour permettre
de constater combien rapidement et profondément la Chine a changé.
À la cantine des étrangers
(enseignants et étudiants), tous les plats coûtaient, en 1991-1992,
entre 2 et 6 yuans. Ce prix peut paraître très bas, mais était
plus élevé que dans bien des petits restaurants fréquentés par
les Chinois. L’on déjeunait à 11 h 30 et dînait à 17 h 30.
C’est tôt pour les Occidentaux, mais on s’y fait rapidement. Nous
avions de l’eau chaude de 6 h 30 à 8 h et de 18 h 30
à 21 h.
Deux ans plus tard, les prix
auront considérablement augmenté à la cantine. De plus, elle sera
ouverte jusqu’à 21 h et accessible à tous, Chinois comme
étrangers. Le développement économique s’effectue à un rythme
foudroyant, et toutes les institutions d’État ont dû trouver des
moyens de s’autofinancer. D’où le jaillissement, du soir au matin,
de restaurants, bars, cafés, cinémas, discothèques sur les campus
universitaires comme ailleurs dans la ville.
Je cuisinais souvent chez
moi, seule ou avec des étudiants. La première fois que j’ai reçu
des amis chinois, les invités ont goûté, par politesse. Beaucoup
plus tard, j’ai compris combien j’étais loin de la cuisine que
j’aurais voulu « chinoise ».
Tirer une leçon de ses erreurs
 |
| Le campus était situé
en banlieue. Les mulets étaient plus nombreux que les autos!
Photos : Lisa Carducci. |
C’est en faisant des gaffes
qu’on apprend. Je n’oublierai jamais cette aventure. J’allai au
marché et achetai six gros œufs qui faisaient plus d’un jin
(500 g); puis, je choisis une pièce de gingembre. Or, la marchande
à qui je demandai le prix me dit en souriant qu’il fallait acheter
au moins un demi-jin. « Je suis seule, lui répondis-je,
c’est trop. Je n’en ai pas besoin d’autant. » Tous les marchands,
des campagnards de la banlieue, se mirent à rire et l’un d’eux
me demanda si j’étais « Meiguo ren » (étatsunienne).
Après m’être identifiée comme canadienne, je revins à la charge :
un seul morceau me suffisait. Alors, ils tinrent conciliabule,
et l’un d’eux suggéra de me demander un mao (dans la langue
orale, pour jiao soit 1/10 de yuan), ce que je payai, glissant
mon acquisition dans mon sac.
Au moment de trancher le précieux
gingembre, je saisis l’astuce : c’était une minuscule pomme
de terre que j’avais achetée, d’une variété bizarre, des bulbes
tordus et crochus, copie conforme du gingembre, et comme je n’en
ai jamais revus. À croire que j’avais rêvé! Bon, le gingembre
n’était pas essentiel. J’entrepris de casser les œufs pour préparer
une omelette. Miracle! Ils étaient cuits dur et salés. J’avais
seulement pointé du doigt, le marchand n’avait donc pas fait erreur.
Il y a toujours une première fois. On apprend de ses gaffes.
Observer les
gens, la vie, la ville
Le campus, ce « petit village », serait mon espace de vie pendant
deux ans. Nous étions très loin du centre-ville, dans la banlieue
est, à deux heures ou plus en autobus à ce moment-là. Après quelques
jours, les environs de notre université me paraissaient moins
sauvages. Par la porte ouest, on accédait à une banque, un bureau
de poste (ouverts le dimanche), un magasin d’alimentation d’État
bientôt démoli pour faire place à un grand bâtiment moderne. Pour
la farine, le riz, l’huile et les œufs, les résidants de Beijing
bénéficiaient de coupons sans lesquels ils devraient payer plus
cher. Quelques années auparavant, quand lesdits produits étaient
rares, on ne pouvait les acheter que si l’on avait des coupons.
Les résidants d’abord, et s’il en restait, les autres. Parfois,
mes étudiants me donnaient des coupons pour que je puisse cuisiner
chez moi. Eux, au dortoir, n’en avaient pas besoin. En 1993, l’approvisionnement
étant assuré, les coupons de rationnement deviendront des objets
de collection.
En voyant dans les magasins tous les ustensiles domestiques que l’on vendait,
je me souvenais du temps où, en Italie, il y avait le « cinciaro »
(au Québec le « guenilloux »)*, qui une ou deux fois
par semaine traversait le village avec sa voiture tirée par un
mulet. Il ramassait bidons bosselés, cuvettes percées, meubles
infirmes, broche à clôture, roues de bicyclettes tordues, du métal
surtout, parfois des vêtements. En échange, il donnait un égouttoir
ou un pot en plastique, un tabouret ou une étagère.
Sa voiture était toute colorée de bassines, de bols, de saladiers, de verres,
tout en plastique, les mêmes objets que je retrouvais en Chine,
mais pour des prix infiniment plus bas. Je me demandais si c’était
la Chine qui avait découvert l’Italie ou l’inverse. Les nappes
brodées, les centres de table crochetés, les bijoux et les chaussures
« Made in Italy », je les ai vu de mes yeux fabriquer ici. Les investissements
et les matières premières sont italiens, mais la main d’œuvre
chinoise. En 1985, j’ai visité à Shanghai une manufacture de pantalons.
On y appliquait l’étiquette « Sears » (Canada). Vendus
à Toronto, ces pantalons coûtaient 45 dollars, tandis qu’à Shanghai
on les laissait pour 5 dollars.
Je remarquais aussi que pour attendre l’autobus, lire le journal ou jouer
aux cartes sur le trottoir, les Chinois ont en effet l’habitude
de s’accroupir sur leurs talons Cette position est très confortable,
dit-on, et permet à l’organisme de se reposer, tout en massant
les intestins pour préparer une meilleure élimination. Une habitude
pourtant en voie de disparition.
Si l’on fait partie des individus qui ont besoin d’un large environnement
libre, on fait mieux d’aller vivre ailleurs. Pourtant, à l’encontre
des Latins, le Chinois évite le contact physique. Il ne touche
pas son interlocuteur en lui adressant la parole. La poignée de
main est un geste occidental qu’il ne pratique qu’avec les étrangers,
et encore! Par contre, il n’est pas rare de voir des enfants marcher
enlacés, deux femmes se tenir par la main ou deux jeunes garçons
aller le bras de l’un sur les épaules de l’autre, tous gestes
qui seraient suspects en Amérique du Nord.
Après six mois à Beijing, je suis retournée au Canada quelques semaines.
J’ai été frappée par ce qui était auparavant ma réalité quotidienne
mais que je ne voyais plus, à force d’y être plongée. J’ai remarqué
les gens qui font respectueusement la queue dans les magasins,
les banques, mais surtout aux arrêts d’autobus, et la distance
de presque 1 m qu’ils laissent entre eux. J’en avais perdu
l’habitude, et la première fois que j’ai pris un autobus à Montréal,
dès que je l’ai aperçu à l’horizon, je me suis précipitée dans
la rue, devant tout le monde, par réflexe conditionné. Entendant
quelques « hum! », j’ai repris mas place dans la queue,
face à ces visages sévères qui me condamnaient froidement.
 |
| Vues de mon appartement
à l’Université des langues étrangères; tout cet espace pour
moi seule! |
De retour à Beijing, dans le noir de la banlieue entre l’aéroport et la
ville, déjà aux premières bicyclettes rencontrées, mon cœur s’est
senti à l’aise. Puis, quand j’ai aperçu l’arrêt de l’autobus 115,
il a bondi. Enfin! j’étais chez moi. J’aime la Chine, son peuple,
sa vie. Parmi mes collègues étrangers, peu nombreux sont ceux
avec qui je peux partager ce sentiment. Les Chinois font preuve
d’une sorte d’innocence attendrissante. Ils esquivent adroitement
les questions épineuses dont ils préfèrent ne pas discuter, et
ce, sans jamais offenser l’interlocuteur. Ils flattent sans mesquinerie;
curieux, ils interrogent subtilement; leur délicatesse de sentiments
et leur retenue dans l’expression passent parfois pour de la froideur,
mais quand on trouve un cœur ami, c’est un véritable ami, inconditionnellement
engagé. Par contre, ils sourient par politesse, même quand ils
sont offensés ou brûlent de colère, ce qui laisse souvent croire
aux étrangers ─ nous qui sommes habitués à manifester
nos sentiments quels qu’ils soient ─ que tout va bien,
que nous n’avons pas commis d’erreur, et que les Chinois sont
d’accord avec notre façon d’agir.
*Cinciaro et guenilloux réfèrent aux personnes qui ramassent des objets
usagés et des matériaux recyclables.
Extraits du livre La Chine telle que je la vis.