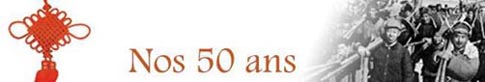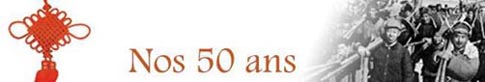Les
jardins de Suzhou
 |
| Le
Wangshiyuan (jardin du Maître des filets) |
Située
à l’extrémité sud de la province du Jiangsu et à une vingtaine
de kilomètres à l’est du lac Taihu,
la ville de Suzhou est proche de Shanghai, la plus grande
ville de Chine. Elle est séparée du lac par une série de petites collines,
dont la plus célèbre est la colline du Tigre. Le Grand Canal traverse
la ville. Fondée à l’époque des Printemps et Automnes (770-475
av. J.-C.) et ayant servi de capitale au royaume de Wu à l’époque
des Trois Royaumes (220-265),
cette ville ancienne a une histoire qui remonte à 2 500
ans. Grâce à son climat tempéré, ses pluies abondantes et son
sol fertile, Suzhou est riche en produits agricoles. Elle offre également des vues d’une beauté
champêtre et des paysages pittoresques de montagnes et d’eau.
Cependant, elle se distingue surtout par ses plus de 180 jardins,
dispersés dans la ville ou dans ses banlieues, qui attirent chaque
année un grand nombre de visiteurs.
Les
particularités de ces jardins
Si l’on
trouve partout en Chine de beaux jardins de style traditionnel,
ceux de Suzhou ont un charme et une originalité qui leur sont
propres. Leur construction remonte très loin dans l’histoire,
et leur tradition très ancienne s’est perpétuée sous les dynasties
successives. À l’époque des Printemps et Automnes, He Lü, roi
de Wu et son successeur
Fu Chai firent construire des palais et des jardins au bord du
lac Taihu et sur les montagnes de Lingyan et de Dongting. Bien
que ces constructions n’aient pas duré longtemps, cette tradition
se perpétua sous les dynasties suivantes. Des mandarins, des propriétaires
terriens et de riches marchands les firent reconstruire ou édifièrent
de nouvelles résidences et villas sur leur modèle ou à des dimensions
plus réduites.
À part
les architectures au style exquis, les jardins de Suzhou se caractérisent
par une disposition naturelle des plantes et des fleurs. La parfaite
harmonie des parfums, des couleurs et de la forme des arbres,
des fleurs et des bosquets de bambous rehausse l’éclat poétique
des jardins. Aux murs et sur les collines artificielles, des plantes
grimpantes ajoutent au goût rustique de l’environnement que troublent
à peine le crépitement de la pluie sur les feuilles de lotus et
de bananier, les battements d’ailes des oies et des canards mandarins
dans l’eau, le gazouillis des oiseaux et le chant des cigales
dans les feuillages.
Le paysagiste
dispose encore de plusieurs éléments : les bian, une
sorte de tablette horizontale suspendue au-dessus de l’entrée
d’un kiosque ou d’un pavillon, sur laquelle se trouve inscrit,
parfois calligraphié, un nom évocateur qui rappelle quelque allusion
littéraire ou suggère un paysage ; les hushi, pierres
érodées durant plusieurs dizaines d’années par les vagues dans
le lac Taihu et choisies avec soin pour composer la rocaille ;
les huachuang, fenêtres ajourées, ouvertures carrées, rondes,
rectangulaires ou polygonales, avec remplages parfois très compliqués
(dessins géométriques, parfois figuratifs) ; ces remplages
sont faits à partir d’éléments en terre cuite et peints à la chaux ;
les zhuandiao, briques en terre cuite gravée à reliefs,
représentant des scènes de la vie quotidienne (théâtre, festin,
pêche, jeux) des animaux (fables) ou des feuillages.
La création
de ces jardins est un art qui fait appel à des connaissances très
diverses. Les maîtres qui y excellent doivent être à
la fois architectes, peintres, poètes et plus encore. Le but est
de créer, dans un espace réduit, le plus de perspectives possibles :
tantôt des collines, toutes artificielles, tantôt des rochers,
soigneusement choisis, qui sont recouverts de terre arable et
où pousse la végétation. On pourrait croire à des collines naturelles.
Les eaux sont toujours à la disposition du paysagiste, car le
terrain est marécageux ; ce sont des eaux dormantes où poussent
des lotus et où s’ébattent des poissons; les bassins ont des formes
irrégulières et sont parsemés de petits îlots qu’on traverse grâce
à des ponts. On trouve parfois des sources, rarement des cascades,
jamais de jets d’eau. La végétation est disposée par touffes :
bouquets de bambous, petits bosquets d’arbres d’essences variétés,
piqués sur les collines ; les fleurs sont rares.
 |
| Fenêtre
à la chinoise et le bambou. |
Les
jardins les plus célèbres
Le
Zhuozhengyuan (jardin de l’Humble Administrateur)
Situé
à l’intérieur de la porte Loumen de Suzhou et couvrant près de
2 ha, ce jardin était à l’origine la demeure du poète Lu Guimeng
des Tang (618-907), devenue plus tard le temple de Dahong sous
les Yuan (1206-1368), puis transformée, vers 1522, en un jardin
privé par Wang Xianchen, un censeur impérial de la cour des Ming,
après sa démission. Le nom qu’il donna à sa résidence s’inspirait
d’une phrase de Pan Yue des Jin : « Cultiver son jardin
pour subvenir à ses besoins quotidiens, voilà ce qu’on appelle
la politique des humbles gens. » Les nappes d’eau occupent
la majeure partie du jardin. Les constructions, disposées pour
la plupart au bord de l’eau, communiquent soit par des galeries,
soit par des ponts en zigzags. Les collines artificielles, les
rochers aux formes bizarres, les bassins aux contours capricieux
et la végétation aux mille essences composent des tableaux remarquables
de relief et de profondeur. Tout est conçu pour la contemplation
du paysage. Le jardin se compose de deux parties, séparées par
un mur ; comme ce jardin fut tracé en terrain marécageux,
l’eau y occupe la majeure partie. Ce jardin, dont le plan s’inspire
de la peinture traditionnelle chinoise et utilise le plus rationnellement
possible l’espace et l’environnement naturel, offre au visiteur
une vue nouvelle à chaque pas. Il se classe parmi les plus typiques
de son genre.
Le
Shizilin (jardin de la Forêt du Lion)
Situé
à la rue Yuanlinlu dans le nord de ville et construit en 1350,
le Shizilin est une œuvre du bonze supérieur Tianru du temple
Huazhansi. Ce jardin doit son nom aux nombreuses rocailles en
forme de lion, qui se groupent en une véritable « forêt de
pierre ». Ce bonze était un adepte de l’école du Dhyana,
et il voulut commémorer le souvenir de son maître Zhong Feng,
qui avait longtemps vécu en un lieu dit « la falaise du Lion ».
Sous les Qing, le jardin, très endommagé, devint la propriété
de la famille Huang, puis plus tard, de la famille Bei, qui après
la Libération en 1949, en fit don à la ville. Le jardin n’a qu’un
hectare de superficie, dont la moitié est occupée par une colline
artificielle ; dans l’autre moitié, une nappe d’eau s’étend
au nord-ouest. La promenade la plus fascinante dans ce jardin
consiste à se laisser conduire, par un sentier aux mille méandres,
à travers un labyrinthe de grottes où défilent tour à tour les
« Dix-huit vues du jardin paradisiaque ». Des constructions
aux noms aussi fantaisistes que poétiques surprennent le visiteur
à chaque détour. L’architecture du jardin traduit à merveille
l’art des jardins de l’époque des Yuan.
 |
| Le
Liuyuan (jardin Attardez-vous) |
Le
Yiyuan (jardin agréable)
Le Yiyuan,
situé dans la rue Renmin au centre-ville, est un jardin plus récent,
aménagé sous le règne de l’empereur Guangxu des Qing (1644-1911)
par le grand fonctionnaire Gu Wenbin. L’architecte s’inspira des
jardins plus anciens de Suzhou dont il reprit certaines idées.
Les nombreux rochers accumulés dans le parc proviennent de trois
autres jardins qui étaient à l’abandon. On disait que quatre sortes
de choses étaient particulièrement nombreuses dans ce jardin :
les pierres de lac, les tablettes suspendues au-dessus des entrées
des édifices, les pins argentés et les animaux. Le jardin a été
ouvert au public en 1953.
Il est
divisé en deux parties par une galerie nord-sud dont les fenêtres
ajourées permettent une double vue à la fois vers l’est et vers
l’ouest du jardin. Dans la partie est, se trouve le Pavillon Shitingqinshi
(Les pierres écoutent le luth) où était conservé un luth qui aurait
appartenu au poète Su Dongpo des Song. On remarquera aussi, dans
le Pavillon Yuhongting (L’arc-en-ciel), une stèle gravée par le
peintre Wu Zhonggui de la dynastie des Yuan. Dans la partie ouest,
la plus vaste, se trouvent les pièces d’eau et les montagnes artificielles,
percées de grottes.
Le
Changlangting (Pavillon des Vagues)
Près
de Sanyuanfan, dans le sud de la ville, le Changlangting est un
des jardins les plus anciens de la ville. Il fut aménagé sous
les Song, sur l’emplacement de la résidence privée d’un mandarin
des Cinq Dynasties (907-960). Su Shunqin, un poète des Song du
Nord (960-1127) lui donna son nom actuel, inspiré d’un poème classique
du même nom : « Si l’eau de la rivière Changlang est
propre, j’y lave les rubans de mon bonnet, si elle est sale, je
m’y lave les pieds ». Changlang, qui signifie aussi vague,
devint ainsi le symbole d’une adaptation aux nécessités de la
vie et d’une certaine nonchalance. Ce jardin couvre une superficie
d’un hectare avec une colline artificielle qui en occupe la principale
partie. Le long de cette colline sont construits des bâtiments,
et les sentiers menant au sommet serpentent dans la verdure. De
chaque côté des sentiers poussent des bambous touffus. Le pavillon
Changlang est haut perché sur la colline, de sorte qu’il offre
une belle vue.
Ayant appartenu à différents propriétaires puis tombé
à l’abandon, le jardin fut refait en 1873, restauré et ouvert
au public en 1954.
Le
Liuyuan (jardin
Attardez-vous)
 |
| Le Changlangting
(Pavillon des Vagues) |
Situé
au nord-ouest de la ville, à un km de l’extérieur des remparts,
ce jardin fut construit sous le règne de l’empereur Wanli (1573-1620)
des Ming par un fonctionnaire nommé Xu Shitai. Il s’appelait alors
le Dongyuan (jardin de l’Est) par référence au Temple du Xiyuan
(jardin de l’Ouest), créé tout à côté et au même moment par le
même fonctionnaire. Mais d’habitude, les gens le désignait sous
le nom de jardin de Liu. Comme en chinois « s’attarder »
est homonyme du nom du propriétaire, on finit par l’honorer ;
dès 1900, le jardin prit son nom actuel. Sa beauté incomparable
fait que les visiteurs le quittent toujours à grand regret. Ce
jardin est celui ayant la plus grande superficie à Suzhou :
4 hectares. Il se divise en quatre parties. La partie centrale
est occupé en principe par une nappe d’eau, entourée de rocailles,
de kiosques, de pavillons, de terrasses et de galeries. La partie
orientale est un ensemble de constructions au style élégant et
raffiné. C’est là où se trouve la cime Guanyun (cime capuchonnée
de nuages), le plus gros rocher trouvé dans les jardins de Suzhou
en provenance du lac Taihu à l’époque des Song du Nord (960-1127).
La partie nord, avec ses bosquets de bambous et ses fleurs
de pruniers, offre un captivant paysage champêtre. La partie ouest
frappe par ses collines artificielles ingénieusement disposées,
au pied desquelles serpentent des ruisseaux limpides. Les ouvertures
multiformes aménagées dans les murs des édifices permettent d’entrevoir
les paysages de chaque coin du jardin. Ce jardin est un des jardins
les plus représentatifs de l’architecture des Qing.
Le
Wangshiyuan (jardin du Maître des filets)
Ce jardin
se trouve dans la rue Fengmendajie, à côté du Grand Hôtel de Suzhou,
au sud-est de la ville. C’est le plus petit jardin, construit
sous la dynastie des Song du Sud et reconstruit sous le règne
de l’empereur Qianlong (1736-1795) des Qing par un fonctionnaire
originaire de Yangzhou, Shi Zhengzhi, qui vint s’établir à Suzhou
après sa retraite. Il se nommait « pêcheur », d’où son
nom de jardin du Maître des filets.
Après sa mort, le jardin fut vendu, tomba à l’abandon et
passa de main en main. En 1958, il fut acquis par la ville.
Le jardin
est caractérisé par ses dimensions réduites et l’importance des
édifices qui s’y trouvent. Plus de la moitié de la superficie
est occupée par une succession de salles et de pavillons. L’entrée
principale est au sud, et l’on traverse du sud au nord l’antichambre,
la grande salle de réception, les appartements privés, la bibliothèque.
À l’ouest de ces appartements, se trouve un petit lac entouré
de rocailles et de pavillons.
Les
jardins de Suzhou traduisent à merveille le style et la tradition
de l’art et de l’architecture de Chine. En recourant à divers
procédés architecturaux, les concepteurs des jardins ont présenté
dans un espace réduit une profusion de perspectives charmantes
et créé une ambiance romantique qui rehausse la beauté de l’ensemble.
|
Concours
« La légende mystère »
 |
 |
| 1 |
2 |
C’est
amusant et instructif !
Il
suffit d’écrire la légende qui convient aux photos à partir
des informations que vous aurez tirées du texte.
Parmi
les légendes que nous aurons reçues et dont le texte est
juste et imaginatif, nous ferons, à chaque parution, un
tirage au sort pour déterminer la personne gagnante. Cette
personne recevra un petit cadeau « à la chinoise »
en guise d’appréciation. Participez en grand nombre !
Indices :
1. Couvre deux hectares. 2. Ces rocailles évoquent une « forêt
de pierre »..
Envoyez
à : M. Hu Chunhua, La Chine au présent, 24,
rue Baiwanzhuang, Beijing 100037, Chine
E-mail : courrierf@263.net
Nos
gagnants jusqu’à maintenant: M. Arnauld Beaurineau, France ;
Mme CHEVILLON, France ; Mme Nadine
Collette, France ; Mme CLARY Françoise, France, France ;
M. Jean Paul OSTIN,
France; Mlle ANGER Aurtrie, France ; ARNOULD BEAUVINEAU,
France ;
M. Jacques VILLEMINT, France ; M.
Serge Jose Corentin,
Mauritius.
Félicitations !
|