|

Les Moinba
et les Lhoba
I. Moinba
Les Moinba sont répartis dans la partie méridionale de la région autonome du
Tibet. La plupart de leurs quelque 7 500 membres vivent dans les
districts de Mêdog, Nyingchi et Co Nag. Ils ont forgé des liens
étroits avec les Tibétains grâce à des échanges politiques, économiques
et culturels. Comme les Tibétains, ils croient au lamaïsme et ont
des coutumes et un mode de vie semblables. Leur
langage, qui comporte plusieurs dialectes, appartient à la famille
des langues tibéto-birmanes, et beaucoup de Moinba parlent aussi
le tibétain.
Dans la région de Moinyu, située au pied de l'Himalaya, les précipitations
sont abondantes, le courant des rivières est rapide, la terre est
fertile et le paysage est magnifique. On y cultive le riz, le maïs,
l'orge de montagne, le sarrasin, le blé d'hiver, le soja et le sésame.
Dans les forêts de pins, on trouve des sangliers, des ours, des
renards et des rhinopithèques.
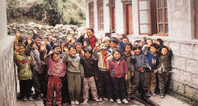 
Histoire
Au cours des siècles, les autorités tibétaines ont pris diverses
mesures pour consolider leur domination sur la région de Moinyu.
Au milieu du XIVe siècle, celle-ci est devenue le manoir héréditaire
de la faction Zhuba Geju des Tibétains. Au milieu du XVIIe siècle,
le Ve dalaï-lama a unifié tout le Tibet et y a établi la lignée
Gelug comme religion dominante. Il a envoyé deux de ses disciples
pour y établir un bureau. Ils ont agrandi le monastère Dawang et
commencé à intégrer la règle religieuse et politique dans la région.
Au milieu du XIXe siècle, le représentant
de la cour des Qing au Tibet et le gouvernement local tibétain ont
affecté deux officiels à Moinyu et ont donné au monastère des pouvoirs
administratifs spéciaux. Chaque année, le gouvernement local tibétain
imposait des impôts et administrait l'échange du sel et du riz.
Les officiels locaux étaient responsables de faire appliquer les
ordres, de régler les différends et d'administrer les affaires aux
échelons des villages.
Durant l'administration de la faction
Zhuba Geju au XIVe siècle, les Moinba se sont appauvris et vivaient
sous le régime du servage.
 Pendant
des siècles, ils ont appliqué le mode de culture sur brûlis et la
productivité est restée très basse. La chasse a fait partie de leur
mode de survie et les captures étaient séparées parmi les villageois
ou troquées contre des céréales et des nécessités courantes. Trois
échelons de seigneurs -gouvernement, noblesse et monastère- possédaient
de vastes étendues de terres, de forêts et de pâturages, ainsi que
les moyens de production. Parmi les Moinba, il y avait deux catégories
de serfs : les tralpa et les dudchhung. Les premiers louaient de
petites parcelles de terres des seigneurs et payaient le loyer en
liquide ou en espèces. Les autres, qui étaient pour la plupart des
immigrants du Tibet central et des régions frontalières, accomplissaient
le travail corvéable. Pendant
des siècles, ils ont appliqué le mode de culture sur brûlis et la
productivité est restée très basse. La chasse a fait partie de leur
mode de survie et les captures étaient séparées parmi les villageois
ou troquées contre des céréales et des nécessités courantes. Trois
échelons de seigneurs -gouvernement, noblesse et monastère- possédaient
de vastes étendues de terres, de forêts et de pâturages, ainsi que
les moyens de production. Parmi les Moinba, il y avait deux catégories
de serfs : les tralpa et les dudchhung. Les premiers louaient de
petites parcelles de terres des seigneurs et payaient le loyer en
liquide ou en espèces. Les autres, qui étaient pour la plupart des
immigrants du Tibet central et des régions frontalières, accomplissaient
le travail corvéable.
Aujourd'hui, il reste encore des traces
de ce type de société au sein de certains villages ou clans où une
partie de la terre, des pâturages et des forêts sont possession
commune. Les villageois peuvent couper du bois sans frais et défricher
avec l'assentiment du chef.
Us et coutumes
Habillement. Dans la région de Moinyu,
les hommes et les femmes aiment porter un genre de robe avec tablier,
ainsi qu'un chapeau en poil de yak. Ils portent des bottes à semelle
molle, décorées de rayures rouges ou noires. Les femmes portent
habituellement un tablier blanc, des boucles d'oreilles, des bagues
et des bracelets. Dans le district de Mêdog, l'habillement est différent.
Les hommes et les femmes portent une veste longue ou courte, et
les femmes, une jupe longue rayée et beaucoup de bijoux.
Alimentation. La nourriture de base des
Moinba inclut le riz, le maïs, le millet et le sarrasin. Le maïs
et le millet sont moulus et on le mange en bouillie. Comme les Tibétains,
les Moinba aiment aussi la tsampa (orge de montagnes rôtie), le
thé au beurre et le piment.
Habitation. Leur maison à chevrons est
construite en bois et en bambou et comporte un ou deux étages. Le
toit est en chaume. Les premier et deuxième étages sont utilisés
comme habitation et le rez-de-chaussée pour garder les animaux.
Mariage, Religion et Funérailles. Les
Moinba sont monogames. Certains croient en un chamanisme primitif,
d'autres au lamaïsme. Immersion dans l'eau, enterrement, funérailles
célestes et crémation sont les modes de disposer des personnes défuntes.
Folklore. Au cours des siècles, les Moinba
ont composé beaucoup de ballades et d'airs de toutes sortes. Parmi
les chants folkloriques les plus populaires, on compte le "
sama" et le " dongsanba " qui ressemblent beaucoup
aux chants tibétains. Leurs danses sont simples et dynamiques.
Les Moinba observent le calendrier des
tibétains et les mêmes fêtes qu'eux.
II.
Les Lhoba
Les quelque 2 300 Lhoba habitent principalement
dans les districts du sud-est du Tibet. Ils parlent une langue distincte
qui appartient à la famille des langues tibéto-birmanes du système
linguistique sino-tibétain. Peu d'entre eux savent parler le tibétain.
N'ayant pas d'écriture, les Lhoba avaient l'habitude de conserver
les registres en faisant des nœuds ou des entailles dans le bois.
Organisation socio-économique d'autrefois
Les Lhoba, dont la plupart sont des paysans,
sont habiles à faire des objets en bambou et autres types d'artisanat.
Autrefois, ils troquaient ces objets, des peaux d'animaux, du musc,
des pattes d'ours et des captures contre des outils de ferme, du
sel, de la laine, des vêtements, des céréales et du thé auprès des
marchands tibétains. Leur pèlerinage au monastère était l'occasion
idéale de faire du troc.
La chasse est une activité que les Lhoba
considèrent comme essentielle. Les jeunes garçons commencent très
tôt à participer à la chasse avec les adultes. Une fois adultes,
ils traquent les animaux au cœur des forêts, soit seuls ou en groupes.
Autrefois, ils distribuaient certaines de leurs captures parmi les
villageois et en troquaient une autre partie.
Au sein de la société lhoba, il y avait
autrefois deux classes : les maide et les nieba. Les premiers se
voyaient comme des nobles et considéraient les nieba comme des gens
inférieurs qui étaient à leur service. Les descendants des nieba
ne pouvaient jamais espérer devenir des maide, même si un jour ils
devenaient riches et propriétaires d'esclaves. Ils ne pouvaient
que devenir des wubu, un groupe de personnes dont le statut était
légèrement supérieur que les nieba. Les jeunes gens et jeunes filles
de groupes différents ne pouvaient se marier. Le statut des femmes,
que ce soit au sein de la famille ou de la société, était particulièrement
bas, et elles n'avaient pas le droit d'hériter.
Us et coutumes
Habillement. Les coutumes et l'habillement
des différents clans varient. À Lhoyu, les hommes portent des vestes
en laine de mouton, sans manche, sans bouton et qui descendent au
genou. Ils portent un chapeau qui ressemble à un casque, fabriqué,
soit en peau d'ours ou tressé avec des lanières de bambou ou de
rotin entrelacées avec de la peau d'ours. Ils marchent pieds nus,
portent des boucles d'oreilles en bambou, des colliers et transportent
un carquois et des flèches ou laissent pendre une épée sur le côté.
Les femmes portent une blouse à manches étroites et une jupe en
laine de mouton. Elles marchent également pieds nus. En plus de
leurs boucles d'oreilles, de leurs colliers et de leurs bracelets
en argent, les femmes portent à la taille une grande variété d'ornements
tels que coquillages, pièces de monnaie, chaînes en fer et cloches.
Les ornements lourds sont considérés comme un signe de richesse.
Alimentation. L'alimentation varie également
selon les endroits. La nourriture de base est des boulettes de farine
de millet ou de maïs, de riz ou de sarrasin. Près des communautés
tibétaines, on mange également de la tsampa, des pommes de terre
et des plats épicés. On boit aussi du thé au beurre. Les Lhoba aiment
aussi boire de l'alcool et fumer, et ils profitent des occasions
comme les récoltes pour chanter et danser. Autrefois, beaucoup de
Lhoba ont souffert de goitre, en raison du manque de sel.
|











