|
Quelques
réflexions sur Shaolin et ses arts martiaux
Daniel
Cogez
Des arts martiaux
jusqu’aux moines et aux jeux Olympiques, les réflexions de l’auteur
nous font découvrir l’étonnante singularité du
wushu
du temple de Shaolin.
 |
 |
 |
| Les
fusées saluent les visiteurs. |
La
cérémonie d’accueil des personnalités au temple de Shaolin. |
La
garde d’honneur des jeunes adeptes du wushu. |
 |
| Un vétéran harnaché
rejoint le temple de Shaolin. |
À Zhengzhou, capitale de la province du Henan, s’est
déroulé en octobre dernier le premier festival de wushu.
Non loin de cette ville se dresse le monastère de Shaolin qui est
le berceau du wushu et des arts martiaux en Chine. D’autres
festivals de wushu ont été organisés en Chine, notamment
à Hongkong, mais dans le Henan, c’était la première fois et l’événement
revêtait une valeur symbolique puisque cette province à l’histoire
millénaire est la mère patrie des arts martiaux.
Avant de faire un parallèle avec les sports de combat
pratiqués en Occident, nous allons d’abord soulever un point crucial :
l’inscription du wushu parmi les épreuves des futurs Jeux
olympiques de 2008 à Beijing. Lors d’une conférence de presse organisée
avant l’ouverture du festival à l’hôtel Songshan de Zhengzhou, nous
avons appris que 2100 athlètes venant de 62 pays différents
et représentant 160 associations de wushu allaient participer
à la compétition. Un journaliste va alors poser la question essentielle
et primordiale : « Est-ce que les arts martiaux deviendront
une discipline olympique? » C’est évidemment pour les autorités
chinoises un objectif et elles ont fait des démarches en ce sens.
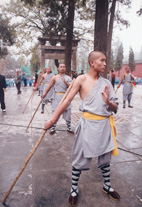 |
| Une allure martiale. |
Mais il convient de réfléchir au rapport de force
entre pays occidentaux et asiatiques, et l’on s’aperçoit très vite
qu’il existe un déséquilibre. Il suffit de compter le nombre de
représentants alignés dans la compétition par les pays occidentaux
et celui des pays asiatiques pour comprendre que le rapport de force
n’est pas le même. Si la Chine, avec Hongkong et Taiwan, peut aligner
deux à trois cents représentants, la délégation de la France ne
comptait que cinq représentants et celle de l’Allemagne, une dizaine
de spécialistes du wushu. Certes, en qualité, certains représentants
de l’Occident peuvent se mesurer à ceux des pays asiatiques et figurer
au palmarès final, mais le poids du nombre mettra toujours en difficulté
les sportifs occidentaux. Les seuls juges étant les membres du Comité
international olympique, nous ne pouvions préjuger de leur décision
au moment du festival, mais nous avons appris par la suite qu’ils
n’ont pas accepté l’inscription du wushu.
La méconnaissance du wushu
Nés en Chine et pratiqués depuis plus d’un millier
d’années dans ce pays, les arts martiaux, regroupés sous le terme
de wushu, comptent de très nombreux adeptes : la seule
province du Henan en recense 40 000; elle abrite aussi de très
nombreuses écoles, dont les principales sont regroupées autour du
monastère de Shaolin.
Il n’en est pas de même en Occident. Certes, les
films de gongfu ont popularisé les arts martiaux, mais les
clubs et associations où est enseigné le wushu sont peu nombreux.
En France, il existe beaucoup de clubs de judo, de karaté et de
taekwondo, mais le wushu à proprement parler est une discipline
rare et peu répandue. Les Occidentaux pratiquent d’autres sports
de combat qui ont un grand auditoire comme la boxe aux poings, le
catch et la lutte gréco-romaine. En revanche, on assiste très rarement
à des compétitions de wushu, et celles-ci ne rassemblent
que quelques « aficionados ».
Les moines guerriers
Autre différence notable, en Occident, les moines
se consacraient dans leurs abbayes et monastères au silence, à la
méditation, à la prière, mais ne pratiquaient aucun exercice physique
particulier ni a fortiori aucune activité guerrière. On mentionnera
une seule exception : lorsque Saint Bernard prêcha la deuxième
croisade pour la reconquête des lieux saints en Palestine au XIIe
siècle, des moines guerriers s’étaient engagés aux côtés des seigneurs
et des croisés. En dehors de cette exception, les moines s’occupaient
de la culture de vignes pour faire du vin ou du champagne, de la
fabrication de liqueurs, de bières ou de fromages, mais ils ne se
livraient pas à des sports de combat comme ceux de Shaolin.
C’est pourquoi les arts martiaux du monastère de
Shaolin constituent une singularité, car en dehors des rites religieux,
les moines pratiquaient la boxe, le maniement d’armes et faisaient
différents exercices physiques dont certains exigeaient une constitution
robuste.
Le patrimoine culturel
Entre les civilisations européenne et asiatique,
il y a cependant des convergences : d’abord celui des lieux
de culte, puis celui de l’héritage culturel, la foi d’une part et
le wushu transmis de génération en génération d’autre part.
En France, les monastères sont tous bien entretenus et parfois sont
inscrits à la liste du patrimoine mondial comme le célèbre mont
St-Michel sur la côte normande. Et dans ces lieux de culte, la foi
en Jésus-Christ avec son message d’amour de l’humanité y est, bien
entendu, propagée et préservée. Les moines veillent sérieusement
à la conservation des lieux de prières, qu’il s’agisse des abbayes
de Citeaux, de Sénanques ou de la Bénédictine, pour ne citer que
les plus célèbres.
Et de même en Chine, et surtout ces dernières années,
un gros effort de préservation des monastères et des lieux de culte
est entrepris. Au lieu d’être laissés à l’abandon, ils sont restaurés
et bien entretenus, et nous avons pu le constater en différents
endroits, tant aux abords de la capitale que d’autres grandes villes
en province. Bien entendu, Shaolin ne fait pas exception.
Ensuite, les arts martiaux tels qu’ils se pratiquent
en Chine, constituent un héritage culturel incontestable :
ils correspondent à un état d’esprit propre à la Chine où l’on désire
cultiver à la fois la bonne santé physique et mentale. Dans un pays
respectueux des valeurs comme la Chine, l’efflorescence et le regain
de vigueur des arts martiaux sont des signes de la vitalité d’une
population qui se projette dans l’avenir en s’appuyant sur des bases
très anciennes.
L’art martial du monastère de Shaolin, après avoir
acquis une réputation nationale avec son histoire millénaire, sa
diversité et sa perfection, devait acquérir une renommée internationale,
et c’était précisément le but du premier festival de wushu
organisé à Zhengzhou.
|
Situation
et origine de Shaolin
Pour présenter Shaolin, nous citerons quelques
extraits du Guide des arts martiaux édité à Beijing
en 1991 par la Société d’édition en langues étrangères.
La boxe de Shaolin tient son nom du monastère
où elle est née. Situé sur le versant ouest du mont Songshan,
à 15 km du nord-ouest du district de Dengfeng, dans la
province du Henan, au milieu d’une forêt de conifères sillonnée
de ruisseaux murmurants, le monastère de Shaolin est entouré
de montagnes. Sa situation sur le versant nord du mont Shaoshi,
couvert d’une forêt touffue, lui a valu le nom de monastère
de Shaolin, célèbre dans l’histoire aussi bien par ses sites
pittoresques que par ses exploits militaires, d’où sa réputation
de « premier monastère sous le ciel » et de « berceau
des arts martiaux ».
Le monastère de Shaolin a été construit en
l’an 495 sur l’ordre de l’empereur Xiaowen des Wei du
Nord pour recevoir le moine indien Bhadra (bouddha) venu en
Chine pour prêcher la religion. Ce temple a
connu bien des vicissitudes en près de quinze siècles. Incendié
et ravagé à plusieurs reprises, et notamment lors d’une révolte
paysanne vers la fin des Sui (589-618), vers la fin des Yuan
(1271-1368) et à une époque récente lors des conflits entre
les seigneurs de guerre en 1928, il fut à chaque fois reconstruit.
Le monastère de Shaolin, gravement endommagé au cours de son
histoire millénaire, a fait peau neuve après la fondation
de la République populaire de Chine grâce aux mesures de protection
prises par le gouvernement et aux travaux de restauration
effectués aux frais de l’État.
Des
faits d’armes
Pourquoi la boxe de Shaolin est-elle si réputée?
Parce qu’elle est liée à des faits d’armes du temps jadis.
Selon de nombreux documents, le monastère de Shaolin a commencé
dès les premiers jours l’entraînement aux arts martiaux. Son
premier bonze supérieur, Bhadra, recrutait des jeunes physiquement
aptes qui s’étaient initiés à ces arts, leur faisait raser
le crâne et les entraînait à la boxe en robe de moine. Le
second bonze supérieur, Chou, était à l’origine un petit bonze
faible et malingre, souvent malmené par son entourage. De
dépit, il se mit à s’entraîner à la boxe et acquit bientôt
une force suffisante pour soulever des poids énormes et mettre
à la raison ses offenseurs.
Les arts martiaux de Shaolin se firent connaître
dès la fin des Sui. À l’appel du prince de Qin, Li Shimin,
qui dirigeait alors une attaque punitive contre Wang Shichong
à Luoyang, les moines de Shaolin, tous de grands boxeurs,
se mirent à la tête de la population pour participer au combat.
Leur premier exploit -la capture du neveu de Wang Shichong-
aida Li Shimin à prendre Luoyang et à forcer Wang Shichong
à la capitulation. Le prince de Qin décréta de leur offrir
une récompense et d’inscrire leurs faits d’armes sur des stèles
de pierre. Le monastère reçut en outre 270 ha de terres
pour l’agrandissement des temples et organiser « les
troupes de moines ». Dès lors, la boxe de Shaolin profita
d’une renommée sans précédent et le monastère ne cessa de
développer ses activités en arts martiaux. Pour renforcer
leur capacité de combat, les moines-soldats de Shaolin se
livrèrent à des entraînements toujours plus variés :
boxe à mains nues, maniement d’armes, combat à cheval, combat
de fantassins. Les brillants faits d’armes accomplis par les
moines de Shaolin leur valurent l’honneur d’être recrutés
à maintes reprises sous les drapeaux impériaux. En dehors
des regrettables contributions à la répression des révoltes
paysannes, ils ont également accompli des exploits héroïques
dans la défense des frontières contre l’invasion étrangère.
Citons en particulier l’émouvante anecdote de la lutte des
moines contre les pirates japonais au XIVe siècle
et de leur sacrifice héroïque pour le pays.
Selon les annales, l’art martial cultivé et
vulgarisé par Shaolin comptait parmi les plus variés. En boxe,
il y avait le changquan caractérisé par la rapidité
des avances et des reculs, l’agilité dans le changement des
mouvements, l’usage simultané des mains et des pieds; il y
avait aussi des boxes de combat proches du genre de la boxe
du Sud qui se distinguaient par la force et l’ampleur des
mouvements, des coups de petite portée, mais vigoureux; des
boxes d’exercice de la force intérieure telles que le rouquan
(boxe souple) et le xingyiquan (boxe idéomorphologique)
qui mettent l’accent sur l’entraînement de la volonté et de
l’énergie vitale, les exercices respiratoires, l’usage simultané
de la force et de la souplesse; la boxe Luohan, le houquan
et autres figures variées, vivantes et dynamiques, aux
gestes expressifs... En dehors du célèbre bâton de Shaolin,
on s’entraînait à l’épée, au fouet, à la hallebarde et au
sabre qui comptaient parmi les 18 armes usuelles. En
même temps étaient pratiqués les exercices de zhuangong
(force équilibrée), de yingong (force violente),
de qinggong (force douce) et de qigong (force
du souffle).
|
|











