Un artiste expatrié, mais heureux
CHEN
JING
 |
| Charles
Chauderlot, avec son inséparable pipe |
Qui d’autre mieux que le Français
Charles Chauderlot pourrait contempler les habitations à la chinoise
du vieux Beijing et en extraire cette insaisissable beauté? Résidant
dans la capitale depuis sept ans, cet artiste des hutong (ruelles)
utilise le lavis à sa façon pour transmettre des messages éminemment
humains. Pendant une heure et demie, il m’a parlé de son art et
de son enthousiasme pour la Chine.
Une fumée génère un paysage pittoresque qui se concrétise sous
une clarté humide. La lumière fluide et tangible remue l’encre
de Chine, en barbouille la pierre et le bois, le pavé et la toiture…
L’auteur de ces dessins si sobres et si profonds des célèbres ruelles
de la capitale est un étranger, mais pas au lavis qu’il maîtrise
en expert.
N’en déplaise à ceux qui
rechercheraient de l’exotisme chez cet homme, Chauderlot n’a pas
les yeux bleus, ni les cheveux blonds, et n’est pas plus haut en
couleur que ses dessins en noir et blanc. D’ailleurs, il ne se distingue
pas trop dans une foule, et peut-être est-ce pour cette raison que
nous nous sommes attendus pendant une bonne demi-heure avant de
nous reconnaître. Mais le sourire sympathique qu’il a l’habitude
d’afficher a tout de suite réchauffé l’ambiance.
Les deux renaissances
 |
| Les
demeures le long de la douve, au pied de la Cité interdite. |
« Commençons sans détour, pourquoi
vivre en Chine? », lui ai-je demandé. Même si un Occidental
n’est plus un phénomène à Beijing, je me disais que chacun doit
bien avoir sa propre histoire sur sa vie en Chine. À cette question,
il répond que son arrivée en Chine correspond à une renaissance.
À cause d’un problème dans sa vie privée, il veut reléguer aux oubliettes
la France qu’il trouve déprimante, renaître comme un enfant, repartir
à zéro. Et voilà que, tel un enfant qui aurait franchi 8 000 kilomètres,
il vient s’émerveiller devant cette Chine qu’il trouve épatante.
Le mandarin est incompréhensible? Pas de problème. La peinture,
sa propre idéographie, sera aussi parlante que le chinois, elle
lui servira de langage. Cette première rencontre heureuse a eu lieu
en 1997, date où il a débarqué en Chine, sa lointaine terre d’inspiration.
Cette rencontre a été une merveille, car en matière
artistique, ce pays s’est révélé très enrichissant. Selon la consigne
paternelle, Charles Chauderlot a dû s’écarter pendant 18 ans
de sa vocation, sans pour autant l’abandonner. Juriste et directeur
de société, métiers « sérieux » qu’il a exercés à tour
de rôle, se verront supplanter par sa reprise d’une étude passionnée
de l’art. Le proverbe ne dit-il pas « Chasser le naturel, il
revient au galop » ?, souligne-t-il. Formé à l’occidentale,
avec en particulier l’assistance de sages professeurs comme Marcel
Vicaire, c’est dans l’empire du Milieu que cet artiste créera un
style à part, une sorte de fusion des techniques chinoise et européenne.
Sa maîtrise aisée de la magie du pinceau et de l’encre, instruments
dont il a découvert les vertus, y a contribué.
La Chine multiple
Il est vrai que pour Charles Chauderlot, en quête
d’une autre vie, la Chine n’a pas été décevante. Pendant son séjour
prolongé, les stéréotypes qu’entretiennent ses compatriotes sur
ce pays oriental se sont gommés au profit d’une Chine multiple.
Défaut du journalisme à son avis, car on y propose, non pas une
désinformation, mais une information trop généraliste. Seule une
intimité profonde avec la société chinoise permet de découvrir sa
multiplicité. C’est justement cette dernière qui l’a davantage impressionné
et qui l’oblige encore à procéder à davantage d’explorations.
Pour Chauderlot, cette multiplicité fait
penser aux « Huit Temples » qui se trouvent à Chengde
(Chengde Waibamiao), construits à la dynastie des Qing (1644-1911).
L’empereur y recevait les « ambassadeurs » des ethnies
d’antan. Parmi ces temples, il existe aussi un petit Potala, copie
de celui de Lhasa, parce que le Tibet, même à cette époque, était
considéré comme faisant partie de la Chine.
Voilà bien un des rares Français qui soulageraient
certainement des guides touristiques, les dispensant de tout effort
de persuasion… Point de vue trop chinois d’après ses copains ? Mais
il faut analyser selon l’Histoire, selon la véracité des faits,
rétorque-t-il. Le pays fait preuve d’un extraordinaire génie de
gouvernance administrative, d’une étonnante capacité à rester uni
malgré les différences, et le peintre s’en réjouit. Il a constaté
aussi que cette multiplicité s’ancre dans la diversité des dialectes
du pays, laquelle est compensée toutefois par une écriture unique.
Il s’émerveille par cette extraordinaire harmonisation entre diversité
et unité.
Ce contexte n’est-il pas favorable à la création
qui exige en permanence de sources renouvelées ? Les pérégrinations
de Chauderlot lui ont ouvert de vastes fresques provinciales, ses
tableaux en témoignent : les fermes et temples du Shanxi et
du Henan, les jonques de bois à Beidaihe est l’atmosphère shanghaïenne
de l’époque semi-coloniale…
Selon cet artiste, cette diversité architecturale
souffre cependant de ravages considérables : la volonté d’imiter
la superpuissance américaine conduit à reconstruire les villes sur
le même modèle, à en faire des reproductions sans caractéristique,
sans poésie. Les Chinois auraient tort de croire pouvoir s’unifier
en édifiant des bâtiments tous pareils, bien au contraire, regrette-t-il.
Les grands hôtels balaient sans état d’âme les quartiers historiques,
déracinent en même temps les bonnes traditions, et cette évolution
le chagrine. Peut-être est-ce la raison pour laquelle il n’assortit
pas ses œuvres de couleurs qui feraient preuve d’une extravagance
outrecuidante pour le patrimoine méprisé.
La mémoire des hutong
 |
| À Beijing,
le 8, Nanguanfang – le hutong Sud des Mandarins. |
Et quand Charles Chauderlot
montre quelques cartes postales qui présentent ses dessins, il est
fort difficile de résister à l’envie de contempler longuement sa
gamme du noir au blanc. Folie des herbes sortant des failles entre
les tuiles, blocs de pierre polis à force d’avoir été foulées à
l’entrée des demeures, sentences parallèles du Nouvel An collées
et déchirées, battants de porte fissurés… Ne vous figurez pas pour
autant un lieu déserté, car les humains y sont bien présents. Le
vélo ou le triporteur partiellement dissimulé, le bassin en émail
servant aux toilettes du petit matin, l’enseigne rudimentaire d’un
réparateur de bicyclettes, les plaques des numéros de portes, les
noms de rue en « signes » chinois, peints avec maladresse
et fidélité… L’attention méticuleuse de cet artiste sensible est
comparable à celle des architectes talentueux de l’époque qui ont
conçu ces habitations raffinées.
Patrimoine chancelant ? Œuvre désuète ? Bien au
contraire. Derrière le visage ridé d’un vieillard, c’est une tête
pleine de souvenirs et de sagesse qui se profile. L’intimité de
la vie s’expose au grand jour, riche d’un passé et d’une âme presque
palpable malgré la sobriété d’apparence. La photographie prétendument
réaliste ne pourrait rendre aussi bien cette réalité humaine.
Et Chauderlot invite aussi son public à
la découverte. D’abord, celle de la vie des habitants des siheyuan
(cour carrée entourée de maisons) de Beijing qui vivent au rythme
des saisons : au printemps, promenade avec la cage à oiseaux,
en été, échiquier sur une table basse qui rassemble les as
joueurs, en automne, récolte des jujubes. Et écoutez ! Le gazouillis
des moineaux et pies à l’aube, les rires des enfants qui courent
et jouent, la voix patiente du grand-père, donneur de leçons, les
cris chantants et le son des outils des vendeurs ambulants, ou encore
la dispute des voisins pour des broutilles… Et ce quotidien se passe,
en famille ou en réunion de plusieurs familles, sous l’ombrage rafraîchissant
du grenadier ou de l’abricotier. La cour se transforme alors en
place publique et Chauderlot, le spectateur, admire l’important
rôle social de cette cour, la grande solidarité qu’on y trouve l’impressionne.
Il déplore le silence étouffant des immeubles où le béton armé coupe
tout lien relationnel : les gens s’isolent, ne se parlent plus
et mourront seuls, sans joie, sans n’avoir jamais dit bonjour aux
inconnus du palier.
La passion de Chauderlot
envers ces trésors cachés ne nous incite-t-elle pas à formuler un
appel de plus en plus entendu : Touristes, ne vous intéressez pas
qu’aux sites « monumentaux » et ne croyez pas que les
ruelles n’ont rien d’exceptionnel ; reporters, consacrez davantage
de pages au charme secret de la mégalopole. Loin du modernisme,
du faste de la place Tiananmen, de la somptuosité des palais impériaux,
la vieille ville se replie dans sa tranquillité imperturbable depuis
bien des générations, une tranquillité aujourd’hui menacée par l’intrusion
de l’expansion urbaine.
Un chaleureux public
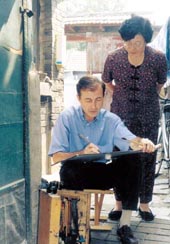 |
| Une
voisine observe la plume du peintre décrivant sa maison. |
On peut comprendre l’empressement de la presse locale
envers cet artiste. Avec son souci de sensibiliser à la préservation
du patrimoine culturel, la presse n’a pas tardé à faire de Chauderlot
une célébrité médiatique. Les gens du commun ne cachent non plus
leur curiosité envers cet étranger, venu du pays du « romantisme »,
qui les flatte par la passion qu’il voue à leur vieille ville.
Mais ceux qui entretiennent un contact direct avec
lui sont avant tout les gens ordinaires. La population des hutong
étend sa chaleur jusqu’à ce waibin, « hôte étranger
distingué », qui installe son chevalet aux environs. On lui
offre une pastèque pour le rafraîchir en été, une bouillote pour
le réconforter durant le froid hivernal, se rappelle-t-il. Au début,
les curieux le regardaient et riaient, mais ils ont ensuite cessé
de le « mépriser », et commencé à lui expliquer des choses,
à l’initier à la richesse symbolique de ces anciennes demeures.
On ne l’appelle plus laowai (cher ami étranger), mais lao
Qiao, « mon vieux Qiao », son nom chinois calqué sur
la syllabe Chau de son nom.
Chauderlot est également à l’honneur des autorités
municipales qui lui ont confié de dessiner, depuis octobre 2002,
l’intérieur de la Cité interdite. Elles ont compris son désir de
faire quelque chose de beau des monuments légués des ancêtres, et
l’artiste s’en réjouit. Il est le premier étranger à être autorisé
à se rendre dans les parties qui sont inaccessibles aux visiteurs
ordinaires du musée. Lao Qiao en est fier.
Pour ceux qui seraient tentés de faire partie des
inconditionnels de Chauderlot, l’album de dessins Pékin :
ultimes regards sur la vieille cité, est une œuvre remarquable.
Accompagnant les dessins de hutong, on y trouve des extraits
de textes de Lao She, écrivain de Beijing dont les écrits sont basés
sur la ville de la première moitié du XXe siècle et sur
celle de la Chine populaire d’avant la Révolution culturelle. Selon
Paul Bady, traducteur chevronné de cet auteur qui a aidé à choisir
les textes, ceux-ci s’harmonisent parfaitement à l’album. M. Chauderlot
suggère: vu l’ensevelissement des vieilles mœurs sous les ruines
des anciennes habitations démolies, ne serait-il pas temps que quelqu’un
avec des aptitudes littéraires comparables écrive sur les mutations
qui s’opèrent actuellement dans la société chinoise ?
|











