La
montée des villages de peintres
– singulier
phénomène des villes et des bourgs
ZHANG
HUA
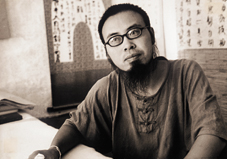 |
| Lü Xiao’er, un des
fondateurs du village de peintres. Photo
fournie par Lü Xiao’er. |
Un homme a su tirer parti de la vague des villages de peintres et offrir
un concept nouveau genre qui respecte à la fois les besoins des
peintres et le cadre naturel des lieux.
Un lit de briques chauffé par-dessous avec des bûches (huokang), un mur de briques à découvert
et non blanchi à la chaux où sont accrochées des calligraphies
et des photos en noir et blanc, des séchoirs en rotin pour abricots,
le linteau de la porte tapissé de vieux journaux… : aucune
trace des temps industriels modernes ne peut être décelée dans
cette maison au cœur du « village de peintres Koulou »,
fondé par Lü Xiao’er. D’apparence, cet endroit ne ressemble qu’à
une cour campagnarde on ne peut plus ordinaire, avec ses 14 maisons
à portes et fenêtres rouges. En fait, il ne ressemble guère au
regroupement de maisons de forme étrange, conçues par leur propriétaire,
que l’on trouve fréquemment dans les autres villages de peintres
et où des paysages exceptionnels se cachent derrière une haute
enceinte. Ici, seulement quelques chaises formant un salon de
thé avec terrasse, des blocs de bois laqués noirs avec motifs
de caractères chinois rouges, des tables recouvertes de nappes
à dessins abstraits offerts par des peintres coréens…
Un tel lieu, qui vous invite à découvrir la vie au naturel,
figure rarement parmi les villages de peintres très à la mode.
Pourtant, c’est justement la raison pour laquelle des artistes
viennent s’y réunir.
De l’idée à la réalité
« J’adore ce mode de vie tout simple. Mon objectif est de mettre
ce lieu d’études, d’échanges et d’hébergement à la disposition
des gens qui veulent faire de la peinture, mais qui n’en ont pas
les moyens », confie Lü Xiao’er, trente et un ans, lunettes à
monture noire et tenue de coton paysanne. Cet homme dit se sentir
très heureux et détendu en écoutant le murmure des sources et
l’aboiement des chiens non loin, en admirant l’ancienne Muraille
qui serpente dans les montagnes environnantes et en se posant
comme témoin du va-et-vient des peintres avec leur carton de dessins
sous le bras.
En effet, son village était auparavant un musée folklorique du district
de Huairou où il avait exposé des instruments agricoles comme
des rouleaux de pierre, des pioches, des anciens outils de pierre
excavés du terrain local, des canons de pierre des Yuan, des poteries
en faïence et des œuvres de calligraphie et de peinture de grands
auteurs faisant partie de sa collection. À l’époque, il voulait
faire connaître les vestiges et les us et coutumes locaux, mais
le public se montrait peu chaleureux. « Dans ce contexte,
un article sur la formation à Paris d’un village de peintres où
se réunit une dizaine d’artistes d’une même école picturale m’a
soudain éveillé. Moi-même, je suis peintre et j’ai des œuvres,
pourquoi ne serai-je pas capable de fonder un tel village? »,
se demanda-t-il
C’est ainsi que Lü Xiao’er a transformé son musée en un village de peintres
à la fin des années 1990, tout comme l’ont fait à la même époque
ses homologues des districts de Mentougou, Tongzhou ou Changping
en banlieue de Beijing. À ce moment-là, l’économie et l’informatique
se développaient à toute allure en Chine et les Chinois choisissaient,
à l’instar des artistes étrangers, le calme de la campagne pour
se consacrer à leur création dans de grands ateliers. Ils sont
alors venus acheter ou louer des maisons de paysans, et en raison
du bien-être qu’ils y ont tous trouvé, ont fondé un regroupement
de peintres dans cet Éden culturel, profitant d’une vie alliant
le traditionnel et le moderne, l’art et le naturel. Sans doute,
ces gens étaient des artistes à succès, mais les jeunes débutants,
dont la carrière artistique venait à peine de débuter, se rassemblaient
à Beijing, ce centre d’informations culturelles et d’occasions
commerciales, afin de trouver une vie professionnelle artistique
libre. Tiraillés entre leur aspiration spirituelle et la réalité,
ces jeunes artistes menaient une vie vagabonde, cherchant leur
pied-à-terre. L’éclosion des villages de peintres a justement
répondu à leurs attentes.
Sur la route principale menant au district de Huairou, Lü Xiao’er a érigé
un panneau indiquant aux habitants de la capitale l’existence
de son village situé au bourg Jiuduhe, à 80 kilomètres de la ville.
Les peintres, tout curieux, ont suivi la piste et ont finalement
découvert l’endroit. Dès le début, Lü a respecté strictement son
principe : son village ne recevrait que les peintres, en
raison de leur penchant commun. Ici, on fournit aux peintres démunis
le vivre et le couvert, mais on refuse les touristes qui veulent
y prendre un repas. Lü leur recommande plutôt d’aller dans les
familles paysannes du voisinage qui peuvent les accueillir. S’il
agit ainsi, c’est que Lü, né dans une famille nécessiteuse et
ayant eu une expérience particulièrement difficile lors de ses
études de peinture, a connu la précarité des relations humaines.
« Quand j’étais très pauvre, en grande difficulté, personne
ne me prêtait assistance, alors que maintenant que j’ai une vie
plus aisée, bizarrement, je dépense moins. Avant, j’utilisais
le recto et le verso du papier, mais aujourd’hui, alors que je
n’ai plus besoin de me soucier du côté pécunier pour acheter mes
papiers, tout le monde m’en donne pour que je dessine! Voilà comment
le monde fonctionne. » Il pense que cela n’est pas raisonnable
ni équitable et, au moins pour cette raison, il a bien l’intention
d’aider les peintres.
 |
| En
banlieue de Beijing émergent des villages de peintres. Sur
la photo, un de la banlieue ouest. |
De bouche à oreille, le village a peu à peu acquis la renommée. Bon nombre
de professeurs et d’étudiants des instituts des beaux-arts s’y
rendent, attirés par cette réputation. Le professeur Jia de l’École
des beaux-arts de Fengtai a comparé les villages de peintres connus
et il a choisi celui de Lü pour y organiser un cours de peinture
sur le vif pour ses élèves. Selon lui, on y trouve non seulement
des paysages idylliques, la Muraille ancienne et des vieilles
maisons, mais aussi ce village de peintres n’est pas touché par
la culture commerciale moderne et est imprégné de la simplicité
antique des intellectuels. Souvent le professeur Jia et les étudiants
échangent des expériences avec Lü.
À part ces peintres, les personnalités du milieu de la culture fréquentent
également le village. L’auteur Mo Yan, qui a connu la célébrité
après l’adaptation, par Zhang Yimou, de son roman Le sorgho rouge, croit
que sa création actuelle est inférieure à celle de ses vingt ans;
il avoue toutefois avoir retrouvé sa source d’inspiration en se couchant sur le huokang de la maison de Xiao’er et en humant
l’odeur des bûches qui brûlent. La mémoire ne peut donner
ce bonheur indicible de retrouver les sensations d’autrefois.
Lü est en accord total avec
les dires de Mo. Il voue toujours un culte à la nature. D’après
lui, le lever du soleil dans les montagnes est beaucoup plus beau
que celui en ville. « C’est au bout de longs voyages que
les grands peintres comme Zhang Daqian ont pu créer des œuvres qui sont passées à la postérité. Si un peintre ne se confine qu’à la ville, tout au
plus fera-t-il la fresque des personnages de la petite bourgeoisie,
rien d’exceptionnel pour le reste. » Lü
souhaite que les artistes puissent puiser leur inspiration
dans ce village de peintres et y trouver leur vocation.
La vie n’est plus la même…
Cette nouvelle mission a valu au village Koulou, reculé et solitaire,
quelques changements. Les villageois envoient maintenant leurs
enfants apprendre la peinture chez Lü; celui-ci leur distribue
gratuitement pinceaux, encre et cahiers de modèles d’écriture,
tout en les encourageant à étudier cet art. En compagnie de Lü,
les enfants vont au pont pour y dessiner et pratiquer la calligraphie;
on accroche les œuvres aux balustres, ce qui forme un site fort
coloré. Lü bénéficie également du contact avec cette jeunesse : « Il
n’existe pas de frontière ni de hiérarchie pour l’art. Auprès
des enfants, j’ai appris leur façon d’écrire et en ai fait des
œuvres qui se sont avérées bien populaires. Par l’imitation répétitive,
mes œuvres ressemblent finalement aux leurs. »
Par ailleurs, Lü demande à ses parents et aux villageois de servir de
modèles pour les peintres. Ainsi il peuvent vivre de près l’art
pictural. Le village de peintres attire des touristes de la capitale,
et Lü ne manque jamais de leur recommander
de visiter les anciennes maisons et les vestiges de la tour,
datant de la dynastie des Yuan, et de partager la joie de vivre
des paysans. C’est ainsi que, mine de rien, il encourage
le tourisme local.
Aux yeux des villageois, Lü est une personne hors du commun; il a en effet
facilement renoncé à la vie de citadins à laquelle, eux, aspirent
depuis des générations. Mais Lü n'est pas de leur avis. Ayant
avec succès ouvert et exploité des bars, des salons de thé et
des compagnies de publicité en ville, il désapprouve la vanité
et la vie luxueuse de certains citadins, et il ne veut pas se
laisser gagner par l’abrutissement
ambiant. Toutefois, il ne peut pas nier le rôle des expositions
qu’on y organise souvent, telles la Biennale internationale des
beaux-arts de Beijing, de même que les salons de l’auto qui lui
ont permis de mieux connaître le monde et qui lui ont servi d’inspiration.
C’est pourquoi, chaque mois, il se rend à Beijing pour y visiter
les expositions qu’il estime importantes.
Pour agrandir son actuel village de peintres, Lü Xiao’er compte en construire
un nouveau qui couvrira une superficie de 11 mu (1mu = 0,15ha). Pour ce faire, il s’est spécialement
rendu au village Shangyuan et dans d’autres villages de peintres
pour y mener des enquêtes et des recherches. Selon ses dires,
il veut rompre avec les anciennes
habitudes des peintres de se séparer de la vie ordinaire des
gens par de hauts murs; il prône un environnement plus ouvert
et plus convivial où les artistes communiquent librement entre
eux.
La
nouvelle de l’élargissement de son village s'est tout de suite
répandue dans le milieu, et nombreux sont ceux qui veulent s’inscrire
auprès de Lü Xiao’er. Mais ce dernier a ses propres critères.
Par exemple, il propose de restreindre à quinze le nombre de peintres
et de permettre à chacun des inscrits d’acheter au plus 200 m2
de terrain. Il se pose aussi comme le jury de sélection. « C’est
comme choisir vos voisins. Si la tenue morale est médiocre, refus
catégorique! », dit Xiao’er, avec entêtement.
Avec contentement, il confie : « Le nouveau village se
basera sur le goût des paysans et j’y ajouterai leur conception
de la nature. De l’extérieur, on dira que c’est un dé tout carré,
et à l’intérieur, il y aura des ateliers avec éclairage sur cinq
côtés pour ceux qui font de la peinture à l’huile, des ateliers
à éclairage de trois côtés pour ceux qui font de la peinture traditionnelle
chinoise et des ateliers communs pour tous, cloisonnés au milieu
par un rideau. »
Sans doute, des histoires singulières vont encore se dérouler au village
Koulou…











