Étrangers,
mais moins que moi
LISA
CARDUCCI
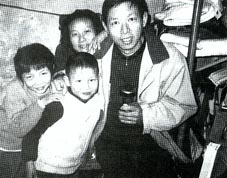 |
| « Prenez une photo de notre famille
heureuse, s'il vous plaît! » |
Un mot qu’on entend souvent
à Beijing, c’est « waidiren »
ou « personne extra-territoriale ». Le territoire, dans
ce cas, n’est pas le pays, ni même la province, mais la ville
et souvent même l’arrondissement. Dans l’arrondissement Shunyi,
au nord-est de Beijing et adjacent à l’aéroport international
de la Capitale, j’ai fait la connaissance d’une famille de « waidiren ».
Liu Shaqing et sa femme, Fu Youxiao, respectivement 41 et 34 ans,
sont arrivés à Beijing en 1998. La sœur cadette de Fu, Xuexiang,
29 ans, s’y trouvait déjà, avec son mari, depuis deux ans. Comme
tous parlent avec un très fort accent du Jiangxi, je n’ai pas
pu mener une entrevue ordinaire. Ce n’est qu’après plusieurs rencontres
et séances de causerie que j’avais accumulé suffisamment d’information
pour « faire mes devoirs ».
Liu et son beau-frère fabriquent
et posent des fenêtres aux maisons neuves, ou les restaurent aux
maisons déjà construites. C’est alors que Liu travaillait chez
des gens où j’étais en visite que j’ai fait sa connaissance. Sa
femme est arrivée quelques minutes après lui, car ils travaillent
ensemble. L’entreprise n’a pas d’appellation commerciale, ni de
siège, ni de carte professionnelle. Comment se passent les choses
en ce qui concerne les taxes? On le devine, mais tel n’est pas
mon propos aujourd’hui.
Le couple avait donc terminé
l’ouvrage au premier des deux étages de la résidence en question.
Quand Fu Youxiao est montée, elle se parlait à elle-même, juste
assez fort pour que je saisisse :
« Ah!
Que d’espace! Quelle grande maison pour
deux personnes seulement! Et la dame est seule pour entretenir
tout ça! »
J’ai terminé ma visite en même
temps que ces ouvriers terminaient leur travail. Nous avons donc
quitté les lieux en même temps, et avons marché ensemble jusqu’à
mon arrêt d’autobus qui se trouvait justement devant chez
eux. Je les avais vus travailler toute la journée, et avais admiré
leur courage et leur diligence.
Avec la plus grande simplicité
et la chaleur des Chinois du peuple, ils m’ont invitée à dîner
en disant que je pourrais prendre un autre bus et, comme ils m’étaient
sympathiques, j’ai accepté.
Je croyais entrer dans leur
atelier, ce qui n’était pas faux en fait, mais l’unique pièce
était aussi la « maison familiale ».
Liu et Fu ont deux enfants :
une fille de 9 ans, Liu Xixi, et un garçon de 8 ans, Liu Chenghui,
qui vient tout juste de commencer sa première année scolaire.
Sachant que les Chinois, les paysans surtout, ont une façon bien
particulière de calculer l’âge, je n’ai pas insisté quand la mère
a dit 7 ans et que le père a repris : 8 ans.
Les sœurs Fu n’ont fréquenté
que l’école primaire. Elles avaient une autre sœur et trois frères.
Aujourd’hui, les six enfants ont quitté le village natal, près
de Nanchang, et gagnent leur vie ailleurs au pays. Ils ont tous
des enfants. Leurs vieux parents sont restés au patelin, avec
les enfants infirmes de la famille.
Il y a environ trois mois, les
habituelles calamités inondation-sécheresse ont fait des leurs
à Nanchang et des maisons ont été détruites. Mais celle des parents
des sœurs Fu est restée intacte. Pris d’envie et de colère, des
voisins ont battu les deux septuagénaires. Monsieur Fu avait déjà
subi plusieurs opérations à un bras, et avait fini par être amputé.
Leurs fils et filles s’inquiètent, au loin, et téléphonent souvent.
Mais les sœurs Fu de Shunyi ne pouvaient pas rentrer voir ce qui
se passait. Habituellement, Fu Youxiao retourne au village natal
une fois l’an, pour la fête du Printemps, sauf les deux dernières
années. Quant à Fu Xuexiang, au moment de « l’attaque »
de ses parents, elle était enceinte et ne pouvait voyager. Tout
ce qu’elles ont pu faire, c’est de s’informer auprès d’un avocat
à Beijing, des droits légaux de leurs parents, et de trouver quelqu’un
à Nanchang qui portera cette affaire en cour. Ce qui est fait
à l’heure actuelle. J’ai demandé si je pouvais publier ces événements,
car je craignais à des représailles pour elles. « Au contraire,
a dit l’aînée, cela pourrait nous aider si les médias répandaient
cette histoire. »
Chaque fois que nous conversons,
je me demande si elles s’appellent Fu ou Hu; les gens du Sud ne
font pas la distinction. J’étais mal à l’aise d’insister, mais
je m’y suis obligée; peine perdue : j’ai toujours l’impression
qu’elle prononce les deux noms à la fois.
 |
| Lisa et Fu: « Une
photo avec vous, c'est trop d'honneur ». |
Je suis retournée plusieurs
fois visiter cette famille, toujours à l’improviste afin d’éviter
qu’on se donne la peine de préparer un repas. Mais quelle que
soit l’heure, il y a toujours un poulet qui mijote, des légumes
frais de la campagne voisine, des œufs, et – délices de mon palais!
– des piments forts comme je les aime.
Je vous entends, Lecteurs, vous
demander pourquoi le couple Liu-Fu a deux enfants, puisque la
loi chinoise n’autorise qu’une naissance par famille. D’abord,
ce couple a un hukou (carnet de famille) rural. Les fermiers qui donnent naissance
à une fille ont le droit d’avoir un second enfant, car avant que
l’agriculture ne soit entièrement mécanisée, elle comporte des
travaux qu’une femme ne peut faire.
– Mais, vous vivez dans la
capitale et ne faites pas de travaux agricoles, ai-je dit.
– Non, mais nos enfants sont
nés alors que nous étions à Nanchang. Nous ne pouvons tout de
même pas les « jeter », a répondu
Fu, en riant.
Quant à sa sœur, l’enfant qui
est né il y a huit jours est son troisième. Des voisines qui ont
aperçu un poupon dans les bras de la « tante » étrangère
se sont approchées pour voir. Entendant que c’était le troisième,
elles se sont exclamées comme prises de désespoir. Le premier
garçon de Fu Xuexiang est sourd-muet et a de la difficulté à marcher.
Dans ce cas, la loi – qui n’est pas aussi draconienne qu’on le
croit souvent à l’étranger, permet un « nouvel essai »,
lequel a donné une fille. Fu a voulu tenter sa chance d’avoir
un garçon sain, et c’est fait. Elle n’aura plus d’enfants. Le
bébé porte le prénom de Shunkang, Shun parce qu’il est né à Shunyi,
et Kang qui signifie santé.
– Qu’en est-il des études des
enfants, puisque leur hukou n’est pas à Beijing?
–
Ils fréquentent l’école locale, avec
les enfants locaux. Pour les deux, les frais sont de 800 yuans
par année, parce qu’ils ne sont pas de Beijing. On ne peut pas
dire que c’est très cher, mais j’ai hâte que le gouvernement applique
sa décision récente de lever ces frais pour que les enfants des
waidiren reçoivent une éducation de qualité. À l’école
où ils vont, s’ils ne travaillent pas bien, on les renvoie à la
maison, tout simplement. On ne prend pas la responsabilité de
faire avancer les élèves.
–
Réussissent-ils?
– Pas toujours. Ils s’amusent…
– Vous arrive-t-il de les frapper?
– Bien sûr, que je les frappe.
Quand je vois une note de 58… Il faut qu’ils apprennent.
 |
| « Shunkang, n'est-ce pas un prénom
bien choisi? » |
Dans la pièce minuscule, des
lits superposés (la mère avec la fille en bas et le père avec
le fils en haut), une table pliante qu’on ferme, sauf pour le
repas et les devoirs, un petit téléviseur noir et blanc sur le
frigo, un évier et une plaque électrique tassés dans un coin.
Par terre, les provisions du marché. Le sol en béton, au niveau
de la rue, est recouvert d’un mince revêtement. À la fin d’octobre,
il faisait déjà froid à Beijing, et le chauffage ne se met en
marche qu’à la date « officielle » du 15 novembre. Peu
importe pour ces gens. Il n’y a pas de chauffage central chez
eux, mais une mini-fournaise au charbon qu’ils allument au besoin.
À ma dernière visite, il faisait donc plus chaud chez eux que
chez les riches. Chaud dans leur cœur aussi, et dans leurs yeux
souriants.
Les deux premiers enfants de
Fu Xuexiang sont restés au Jiangxi. Avec son mari, elle a loué
pour 100 yuans par mois, à quelques mètres de chez sa sœur, une
chambre meublée d’un grand lit et d’une chaise. La famille de
Liu paie quatre fois plus pour une pièce plus petite, mais on
peut y faire la cuisine et il y a l’eau courante. Les toilettes
publiques desservent les deux familles.
–
Pensez-vous retourner à Nanchang,
un jour?
– Nous le pensions quand nous
sommes arrivés. Bien sûr, là où l’on est né, c’est toujours chez
soi… mais malgré tout, notre vie est meilleure à Beijing qu’à
Nanchang.
– Je croyais qu’après avoir
fait des économies, vous seriez retournés acheter une grande maison?
– La maison familiale est grande.
Là-bas, ce sont les conditions de vie qui n’évoluent pas. Et puis,
à la campagne, on n’achète pas de maison; on la construit soi-même.
Quand j’ai frappé à la porte,
tout à l’heure, les enfants faisaient leurs devoirs. Dès qu’ils
m’ont aperçue, ils se sont levés comme des ressorts, et se tenant
bien droit, ont salué : « Bonjour, Tante! Veuillez entrer. »
Ils se montrent toujours polis, sans façon, et sans que les parents
soient obligés de leur dire « Saluez votre tante »,
« Remerciez votre tante », « Invitez votre tante
à s’asseoir », etc.
Contrairement à ce que je pensais,
lorsque j’ai demandé quels rapports les citoyens de Beijing entretenaient
avec les waidiren, les
deux sœurs ont affirmé à l’unisson :
– Très bien! Nous nous entendons
très bien, les gens sont sympathiques et gentils. Bof… peut-être
un peu moins les véritables Pékinois de plusieurs générations…
Fu Youxiao, qui me raccompagnait,
verbalisa son étonnement : « C’est incroyable que vous nous
ayez choisis, nous, des waidiren sans instruction,
pour votre entrevue. Et des photos! Je n’ose pas le demander,
mais que nous nous fassions photographier en compagnie d’une étrangère…
Nous ne sommes que des laobaixing (le commun du peuple).
La prochaine fois, peut-être. Excusez-moi. »
– Tante, comment devient-on
journaliste? lance impromptu le petit
Liu Chenghui.











