Les
Xibe
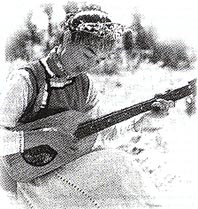 |
| Jeune
fille xibe. |
L’ethnie xibe compte une population de 172 900 habitants qui est surtout
répartie en Chine du Nord, de Ili, dans la région autonome ouïgoure
du Xinjiang, à l’ouest, jusqu’aux régions du Nord-Est. La langue
xibe appartient à la branche mandchoue-tungu de la famille des
langues altaïques. On dit que l’ethnie xibe aurait eu jadis une
écriture mais qu’elle l’aurait perdue après la dynastie des Qing
(1644-1911). Un grand nombre de Xibe auraient alors appris la
langue des Mandchous et celle des Han. Toutefois, au Xinjiang,
certains Xibe connaissent la langue ouïgoure et kazakhe. Autour
de 1947, certains intellectuels xibe auraient réformé la langue
mandchoue qu’ils utilisaient, en laissant tomber certains symboles
phonétiques et en y ajoutant de nouvelles lettres de la langue
xibe. L’écriture xibe était utilisée comme langue officielle par
les organes du pouvoir de la région autonome.
Histoire
Les
Xibe croient qu’ils sont les descendants des anciens Xianbei,
et il existe de nombreuses versions de leurs origines. Les Xianbei
formaient une branche de l’ancienne ethnie donghu de la Chine
du Nord, et ceux-ci vivaient en nomades dans les vastes régions
situées entre les versants orientaux des Grands Hinggan en Chine
du Nord-Est. En 89, les Xiongnu du Nord, défaits par le général
Dou Xian de la dynastie des Han, se sont déplacés vers l’ouest
et ont abandonné leurs terres aux Xianbei. De 158 à 167, les Xianbei
ont formé une alliance tribale puissante sous l’ordre du chef
Tan Shihuai. Du troisième au sixième siècle, les Murong, Tuoba,
Yuwen et autres tribus puissantes des Xianbei ont établi des régimes
politiques dans le bassin du fleuve Jaune où ils se sont mêlés
aux Han. Toutefois, quelques Xianbei ne se sont jamais éloignés
de la terre natale, le long des fleuves Chuo’er, Nenjiang et Songhua.
Ils sont probablement les ancêtres des Xibe.
Avant
la dynastie des Ming (1368-1644), les Xibe vivaient dans la vaste
région située à proximité du district de Fuyu, dans la province
du Jilin, région qui s’étendait aussi loin que la ville de Jilin
dans l’est, Hulunbuir dans l’ouest, le fleuve Nenjiang dans le
nord et le fleuve Liaohe dans le sud. À la fin du XVIe
siècle, les nobles mandchous se sont soulevés pour prendre le
pouvoir. Afin d’agrandir leur territoire et de renforcer leur
régime, les dirigeants mandchous ont essayé à maintes reprises
de conquérir les tribus voisines en leur offrant de l’argent,
des postes élevés et des liens matrimoniaux, et le plus souvent,
ils ont tenté de le faire par la force armée. Les unes après les
autres, les tribus xibe se sont soumises aux dirigeants mandchous.
À la fin du XVIIe siècle, toutes les tribus xibe des différentes
régions étaient incluses aux Huit Bannières mongoles et mandchoues.
Selon le système des Huit Bannières, les soldats des bannières
travaillaient la terre durant
les périodes de paix et livraient bataille durant les périodes
de guerres. En moins de 150 ans après la fondation de la dynastie
des Qing (1644-1911), les Xibe furent chassés de leurs terres
dans la Chine du Nord-Est et ils durent se déplacer aussi loin
que le Xinjiang et le Yunnan. La cour des Qing accorda un traitement
différent aux diverses tribus xibe, selon l’époque et leur niveau
de soumission, afin de témoigner de degrés différents de faveurs
et de les classer de manière différente.
Au
milieu du XVIIIe siècle, le gouvernement des Qing réprima
la rébellion à Junggar et dans d’autres endroits du Xinjiang.
Pendant soixante ans, des officiers et des soldats xibe furent
affectés, avec leurs familles, dans les régions frontalières du
Nord-Ouest. Ils y affrontèrent bien des difficultés et leur population
connut une nette diminution. Voilà pourquoi les Xibe en vinrent
à vivre séparés, certains dans le Nord-Est et d’autres dans le
Nord-Ouest. Les anciens Xibe vivaient de la chasse et de la pêche.
Dès le milieu du XVIe siècle, l’organisation sociale de cette
ethnie est passée d’une relation de sang à une relation géographique.
Les liens des groupes à filiation paternelle devinrent moins serrés.
Dans chaque village xibe, il y avait des membres portant différents
noms. Toutefois, les membres du village ont conservé des liens
relativement étroits en production, et pour l’essentiel, ils respectaient
le principe de travail en commun et de distribution égale. Le
système des Huit Bannières a également apporté des changements
draconiens dans la structure économique et sociale.
En dépit des difficultés, les Xibe étaient déterminés à
demeurer autosuffisants, et au XIXe siècle, ils construisirent
un canal d’irrigation de 200 km pour amener l’eau du fleuve Ili,
ce qui incita beaucoup de familles à s’y installer. En 1911, les
Xibe du Xinjiang appuyèrent la révolution, peu après l’éclatement
de celle-ci. Ceux du Nord-Est se joignirent aux Han et aux Mandchous
en 1931 pour lutter contre les Japonais qui occupaient cette région
du pays. En 1944, les Xibe du Xinjiang luttèrent contre le Guomindang
dans les régions de Ili et de Tacheng. Ils formèrent leur propre
force armée. Après la Libération, le district autonome Qapqal
xibe fut établi en 1954 sur le site du district de Ningxi du Xinjiang
où les Xibe vivaient en communautés compactes. Encore aujourd’hui,
les Xibe s’adonnent à la culture et à l’élevage, mais le rendement
de leur production a augmenté beaucoup. De petites entreprises
industrielles ont aussi vu le jour : charbon, machinerie
de ferme, fourrure, transformation alimentaire.
Us
et coutumes
 |
| On
prépare un arc et des flèches, un cadeau de bon augure qui
sera offert au nouveau-né. |
En
raison de l’histoire, les Xibe du Nord-Ouest et du Nord-Est ont
développé des caractéristiques différentes qui leur sont propres.
La langue et l’alimentation, l’habillement et les habitudes de
vie des Xibe du Nord-Est ressemblent à ceux des Han et des Manchous.
Ceux du Xinjiang, vivent en communautés plus compactes et ont
préservé davantage de caractéristiques de leur écriture et de
leurs habitudes de vie.
Religion. Les Xibe du Xinjiang étaient autrefois
polythéistes. En plus des dieux des insectes, du dragon, de la
terre, les Xibe vénéraient les dieux protecteurs du foyer et des
animaux. En outre, certains autres croyaient au chamanisme et
au bouddhisme. Les Xibe vénèrent pieusement les ancêtres à qui
ils offrent du poisson au troisième mois lunaire et du melon au
septième mois lunaire.
Habillement. Les femmes xibe du Xinjiang aiment
les longues tuniques bien ajustées qui touchent pratiquement le
sol. Le bas de la jupe et des manches est garni de dentelles.
Les hommes portent une veste courte, boutonnée à l’avant, et un
pantalon resserré autour de la cheville. Ils portent une grande
tunique en hiver. Dans le Nord-Est, l’habillement des Xibe est
le même que celui des Han.
Alimentation. Le riz et la farine forment l’alimentation
de base. Les Xibe du Xinjiang qui élèvent du bétail et des moutons
aiment le thé au lait, le beurre, la crème, le fromage et les
autres produits laitiers. Le dix-huitième jour du calendrier lunaire
marque la fête des Xibe. Pour l’occasion, ceux-ci feront de la
farine ou de la sauce aux fèves pour souligner la fin de la migration
de leurs ancêtres vers l’ouest. À l’automne, ils marinent du chou,
du poireau, des carottes, du céleri et du piment rouge. Les Xibe
aiment chasser et pêcher durant la saison morte. Ils marinent
également le poisson pour le manger durant l’hiver.
Habitation. Il y a habituellement cent à deux
cents ménages dans chaque village xibe, lequel est entouré d’un
mur de deux ou trois kilomètres. Une maison xibe comprend habituellement
trois à cinq pièces et possède une cour dans laquelle on plante
des fleurs et des arbres fruitiers. Les portes des maisons font
face au sud. Les femmes xibe sont habiles à découper le papier,
de sorte que les fenêtres sont souvent décorées de leurs œuvres.
Autrefois, un ménage xibe comprenait trois générations, parfois
quatre ou cinq. Dans la plupart des cas, les mariages étaient
arrangés par les parents. Les femmes bénéficiaient d’un statut
peu élevé et n’avaient pas le droit d’hériter. La famille était
dirigée par le membre le plus vieux qui jouissait d’une forte
autorité. Les fils n’avaient pas le droit de quitter la famille
pour vivre ailleurs, tant que le père était vivant. Au sein de
la famille, les vieux et les jeunes avaient une position qui obéissait
à un ordre strict d’importance, et on portait beaucoup d’attention
à l’étiquette. Le Hala, un conseil formé des chefs masculins
du clan, réglait les questions importantes et appliquait la loi.











