|
Le
bambou et l’esprit chinois
HUO JIANYING
 |
|
La chaumière de Du Fu,
poète des Tang (618-907), à Chengdu (Sichuan), dans la forêt
de bambous.
|
EN 1974 et en 1983, alors que le Sinarundinaria
nitida, aliment des pandas géants, était en pleine floraison,
le monde suivait la situation de près, car de cette plante
dépend la survie du « trésor national » de Chine. Fleurir
régulièrement et monter en graines est une loi naturelle pour le
bambou. Toutefois, à la différence d’autres plantes, le bambou
ne fleurit que tous les 60 à 80 ans, puis il meurt. Il faut de 10
à 30 ans à ses graines pour germer et constituer une nouvelle
forêt. Les deux dernières floraisons ont occasionné la mort par
inanition de 250 pandas géants. Ce fut une catastrophe pour
cette espèce animale dont il ne reste que 1 000 spécimens environ.
 |
|
Une
œuvre de Xia Gui, peintre des Song. Les sterculiers, les bambous
et la chaumière constituaient une résidence idéale pour les
anciens lettrés.
|
Depuis plus de trois millions d’années, le bambou s’est renouvelé
50 000 fois par de tels cycles, et c’est grâce à la
migration que les pandas géants ont survécu. Cependant, le processus
de développement social de l’humanité, la croissance démographique
et le développement économique ont réduit la surface des forêts
de bambous; la migration est donc devenue plus difficile aujourd’hui.
Cette situation est très déplorable, non seulement pour cet
animal, mais aussi le peuple chinois en éprouve de la nostalgie,
puisque le bambou revêt une signification particulière dans la culture
traditionnelle.
Un objet culte depuis des milliers d’années
 |
|
Bambous,
pierres et neige, un tableau de Gao Fenghan, peintre des
Qing (1644-1911).
|
Le bambou a un lien étroit avec la vie sociale
des humains, que ce soit sur le plan de l’habillement, de
l’alimentation, de l’habitation ou des déplacements. Dans l’histoire
chinoise, pendant quatre ou cinq cents ans, on a écrit sur les lamelles
de bambou. Les anciens instruments de musique joués à la bouche
étaient presque tous fabriqués en bambou. Mais le plus important
est peut-être que ses propriétés naturelles et ses caractéristiques
s’accordaient avec l’éthique et la morale féodales des bureaucrates
et des lettrés. Le bambou était considéré comme le symbole du
gentleman.
Dai Kaizhi, un savant sous les Jin (265-420), estimait dans
son ouvrage Zhupu (Registre généalogique du bambou) que le
bambou était une plante qui n’était ni herbe ni arbre et qu’il se
distinguait beaucoup des autres herbes et des autres arbres.
Il est modeste, ferme, fin, inflexible et ne craint pas la neige;
tous ces caractères ressemblent aux qualités morales que l’on prête
aux humains.
 |
|
Portrait de l’empereur Qianlong (1736-1795) des Qing (1644-1911),
accompagné de bambous et de pruniers, objet d’art conservé
au Palais impérial.
|
Les anciens Chinois donnaient
le surnom de « quatre gentlemen » au prunier,
à l’orchidée, au bambou et au chrysanthème, et celui
de « trois amis qui poussent en plein hiver » au
pin, au bambou et au prunier. Bai Juyi (772-846), grand poète des
Tang, résuma ainsi les mérites du bambou : résolu, honnête,
modeste, pur et intègre. Il tira la conclusion que le bambou
est digne de son titre de gentleman, puisqu’il réunit toutes
ces nobles qualités.
Selon les Anciens, en plus de posséder la vie
et la vertu, le bambou est doté d’âme et d’émotion et comprend les
gens.
 |
|
Les pandas géants vivant
sur les bambous.
|
Au sud du Yangtsé, il existe
une sorte de bambou tacheté; il est connu sous le nom de Banzhu,
puisque ses tachetures sont semblables à la trace que laissent
des larmes. Il s’appelle aussi Xiangfeizhu (bambou des concubines
impériales). Selon la légende, dans la Haute Antiquité, l’empereur
Shun serait mort de fatigue durant son inspection dans le Sud et
aurait été enterré à Cangwu. Ses épouses E’huang et Nüying se seraient
alors hâtées de le pleurer jusqu’à la rivière Xiangjiang (Hunan),
et leurs larmes seraient tombées sur les bambous, y laissant
ainsi des taches. Tout comme le dit un poème : « Les brindilles
du bambou tacheté de larmes transmettent les sentiments. »
Depuis des milliers d’années, ces bambous tachetés sont toujours
aimés des gens et sont considérés comme des produits précieux du
genre.
 |
|
Une
œuvre de Zheng Banqiao.
|
Le Menzongzhu, une autre
sorte de bambou, a tiré son nom d'un fils pieux. Meng Zong
était un lettré de l’époque des Trois Royaumes (220-280). Son père
est mort alors que Meng était encore petit. Un jour, sa vieille
mère tomba dangereusement malade et les remèdes n’avaient pas d’effet.
Le docteur lui suggéra donc de préparer un bouillon en faisant cuire
des pousses de bambou. Mais il était impossible d’en trouver en
plein hiver. Désespéré, Meng Zong embrassa un bambou et sanglota.
Sa sincérité toucha le ciel, la terre se fendit et des pousses de
bambou en sortirent. Après avoir bu de ce bouillon, sa mère se rétablit.
La nouvelle de la piété filiale de Meng Zong se répandit tout de
suite et Meng devint plus tard un mandarin. On surnomme aussi ce
genre de bambou Mengzongzhu (bambou Mengzong) ou Mengzongsun
(pousse de bambou Mengzong). Aujourd’hui, dans des supermarchés,
on peut trouver le Mengzongsun, produit par des entreprises
de traitement du bambou.
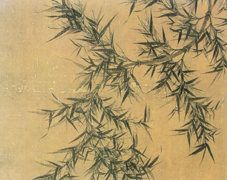 |
|
Peinture
de bambous de Wen Tong (1018-1079), peintre célèbre des Song
(960-1279).
|
La piété filiale occupe une position très importante
dans la morale traditionnelle chinoise. Selon Confucius, elle était
l’essence de toute vertu humaine. De la société à la famille, la
piété filiale était la règle morale à respecter. Certaines dynasties
adoptèrent même comme politique d’État de « gouverner le pays
avec piété ». Sous les Han (206 av. J.-C. -220), une
loi de piété et d’honnêteté fut promulguée comme l’une des manières
pour évaluer les fonctionnaires. Dans la société féodale, on croyait
que les gens pieux avaient certainement un cœur bienveillant et
que les gens honnêtes étaient intègres et loyaux. La piété filiale
jouait un rôle irremplaçable pour maintenir la stabilité familiale
et sociale.
Xiaogan du Hubei est le pays natal de Meng Zong
et de Dong Yong, tous deux cités dans les 24 Exemples
de piété filiale, le premier recueil du genre de l’Antiquité
chinoise. Dong Yong était louangé parce qu’il se vendit lui-même
pour payer les funérailles de son père.
L’alter ego des lettrés
Les lettrés chinois anciens nourrissaient un amour
profond pour le bambou. Cela peut expliquer pourquoi il y a tellement
d’écrits et de peintures en faisant l’éloge, tout au long de l’histoire.
La peinture sur bambou était même une catégorie importante
dans la peinture traditionnelle chinoise. Les gens cultivaient des
bambous partout dans les montagnes et dans les cours.
Sous les Jin de l’Est (317-420), Wang Huizhi, fils du grand calligraphe
Wang Xizhi, était réputé pour adorer le bambou. Lorsqu’il séjournait
dans une nouvelle résidence, il ordonnait de planter des bambous
dans la cour, avant même de décorer les chambres, en disant :
« Comment puis-je supporter un jour sans ce gentleman? »
Su Shi (1037-1101), écrivain de génie des Song et disciple du célèbre
peintre de bambous Wen Tong, possédait un talent non seulement en
poésie mais encore en peinture de bambous. Selon Su Shi, pour dessiner
le bambou, le plus important était de captiver les instants pouvant
révéler ses caractéristiques et ses différentes formes, et cela
devait être fait sur la base d’une observation minutieuse et de
la compréhension de la qualité qu’il incarnait. Son célèbre dicton :
« Je peux vivre sans viande, mais ne peux habiter une maison
sans bambou » en témoigne. Il insistait : « Avant
de dessiner un bambou, on doit en avoir une image définie en tête. »
C’est ainsi que Xiongyouchengzhu (avoir un plan bien arrêté)
est devenu un idiome populaire même aujourd’hui.
Parmi les innombrables grands maîtres, Zheng Banqiao
(1693-1765), qui a vécu sous les Qing, est le plus admiré pour le
dessin de bambous. L’un des « huit excentriques de Yangzhou »,
il possède un caractère et une maîtrise incomparables sur le plan
de l’art et de la culture.
Né dans une famille pauvre du district de Xinghua de la préfecture
de Yangzhou, Zheng Banqiao perdit sa mère alors qu’il était encore
très jeune, et il apprit à dessiner auprès de son père. Grâce à
l’assistance d’un ami, il eut l’occasion d’étudier. Il passa les
examens impériaux des échelons régional, provincial et national,
mais il ne put obtenir un poste de chef de district qu’à l’âge de
49 ans. Pendant qu’il gouvernait le district de Weixian du Shandong,
il fit preuve de diligence et était consciencieux au travail; il
dénonçait impitoyablement la corruption des dignitaires et les gens
riches mais cruels. Il témoignait de la sollicitude envers la misère
du peuple, et ses peintures et ses poèmes exprimaient bien ses sentiments.
Plus tard, pour aider les sinistrés dans l’impasse, il décida de
distribuer des réserves de grains du gouvernement au mépris du danger;
on l’accusa faussement et il fut destitué.
En fait, il avait l’esprit préparé à cette conséquence.
Éprouvant autant de chagrin que de colère, il quitta son poste et
retourna à Yangzhou, vivant de la vente de ses peintures.
Zheng Banqiao a aimé le bambou, l’a dessiné et
lui a confié ses sentiments durant toute sa vie. Dans son enfance,
il y avait une forêt de bambous à côté de sa maison. Il avait appliqué
un papier blanc sur la fenêtre et se passionnait à observer jour
et nuit les ombres des bambous. Quand l’envie lui venait, il peignait.
D’après lui, le plus important pour peindre le bambou est de traduire
son esprit et sa vitalité : élancé, mais fort et vigoureux,
hautain et distant. Sur l’une de ses peintures de bambou, il a écrit :
« Tenir fermement la montagne verte, s’enraciner dans les précipices,
pousser plus vigoureusement après les tribulations et se moquer
de l’attaque du vent soufflant dans toutes les directions. »
C’est en réalité la peinture vivante du peintre lui-même.
La poésie, la calligraphie, la peinture et la
gravure de sceau font partie de l’art traditionnel chinois. Dans
l’histoire, de nombreux lettrés connus ont tenté de les combiner
parfaitement. Quant à Zheng Banqiao, il était expert en ces quatre
genres d’art, et il les a harmonisés dans ses œuvres avant d’en
faire un art polyvalent de haut niveau. Cette situation explique
son statut particulier et important dans l’histoire de l’art chinois.
Au fil des siècles, il n’y a pas que les hommes
qui se sont passionnés pour le bambou. Sous les Tang (618-907),
la poétesse Xue Tao laissa une bonne réputation grâce à ses poèmes
et à son amour pour le bambou. Ses 88 poèmes ont été sélectionnés
dans le Quantangshi (Recueil de poèmes des Tang). Restée
toujours célibataire, Xue prit le bambou comme compagnon et s’est
inspirée des caractères de celui-ci. Après la mort de cette femme,
on a planté des bambous partout dans le parc où elle avait vécu
pour la commémorer, et au fil des générations, cet endroit est devenu
un parc de bambous. C’est le parc Wangjianglou, sur les rives de
la rivière Jinjiang de Chengdu, qui couvre une superficie de 12
000 m2 et qui abrite quelque 150 espèces de bambous.
Aujourd’hui, les gens ne se contentent plus seulement
de transformer le bambou, de le chanter en poème ou de le dessiner.
Comme ils sont plus conscients des relations entre l’homme et la
nature, ils utilisent les sciences et techniques modernes pour surveiller
la situation écologique des bambous, construire des réserves naturelles
et multiplier les surfaces plantées de cet arbre. Toutes ces mesures
prouvent que l’homme a pris conscience de l’importance de protéger
les bambous, car non seulement elles peuvent permettre de protéger
les pandas géants, le bon environnement écologique et les ressources
naturelles, mais encore de maintenir et de protéger la vertu traditionnelle
de la nation chinoise.
|











